Politique
25 ans après : l’État toujours aussi paradoxal ?
16.08.2021
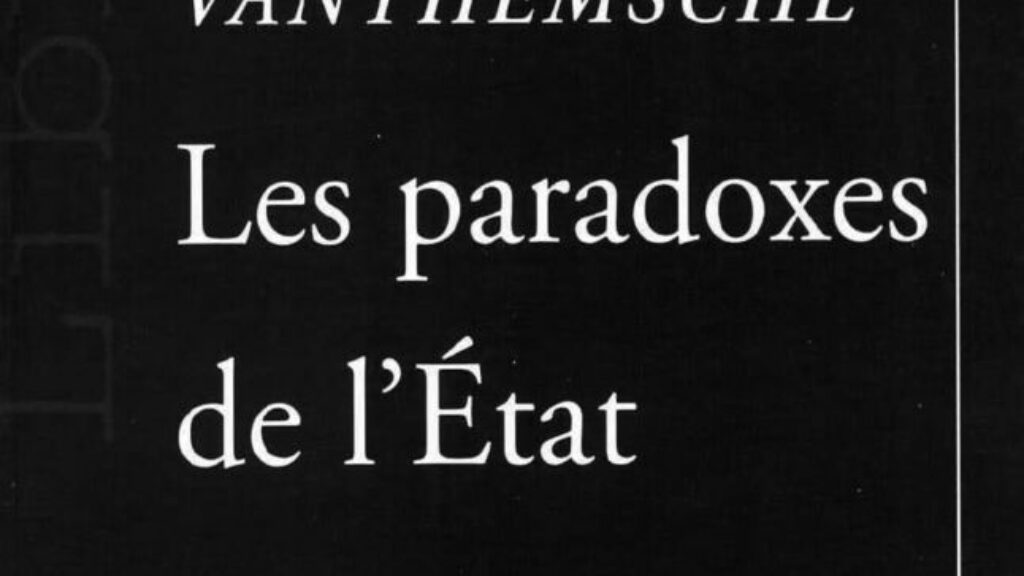
Cet article a paru initialement dans notre n°116 (juin 2021).
Les Paradoxes de l’État[1.G. Vanthemsche, Les Paradoxes de l’État. L’État face à l’économie de marché (XIXe-XXe siècles), Bruxelles, Labor, collection « Quartier Libre », 1997, 96 p. (2e édition 1998).], petit livre écrit fin 1996 et paru au début de l’année suivante, est donc vieux d’un quart de siècle. À l’époque, le world wide web venait à peine de naître ; l’usage des micro-ordinateurs était peu répandu et le smartphone n’existait pas encore ; les Belges payaient toujours en francs belges et les Allemands en Deutsche Mark ; à peine trois ans auparavant, en 1993, la Belgique s’était officiellement proclamée « État fédéral » et Guy Verhofstadt, jeune et remuant auteur des Burgermanifesten (« manifestes citoyens ») néolibéraux (1989-1994), devrait encore attendre quelques années avant de devenir Premier ministre. De toute évidence, la société a profondément changé depuis la parution de cet essai. En revanche, les écrits restent… et peuvent être méchamment contredits par les faits. En me proposant de revenir sur une réflexion publiée il y a vingt-cinq ans, la rédaction de Politique me lance donc un aimable mais redoutable défi. Je le relève toutefois bien volontiers en livrant quelques brèves observations, évidemment dénuées d’ambition scientifique, et essentiellement axées sur le cas belge.
Des États multiples
L’action économique de l’État ne peut être comprise qu’au prisme de sa multiplicité. Pour en saisir les principales évolutions au cours de ce dernier quart de siècle, nous passerons donc en revue quelques-uns des qualificatifs habituellement accolés à la notion « d’État ». Ils expriment les différents rôles inter-connectés que joue la puissance publique.
L’État entrepreneur était, sans conteste, l’une des cibles favorites de l’offensive néolibérale lancée dès le début des années 1980. En Belgique, les privatisations des entreprises publiques (ou contrôlées par l’État) se sont essentiellement produites dans les années 1990. Pour des raisons encore à établir, ce processus s’est ensuite arrêté tout au début du XXIe siècle. L’État a donc gardé la haute main, voire le contrôle total, sur un certain nombre de grandes entreprises, essentiellement dans le domaine des communications. Le désengagement entrepreneurial de la puissance publique a-t-il porté les fruits que certains espéraient ?
La Sabena fit faillite fin 2001, six ans après avoir été confiée aux « bons soins » de la Swissair (malgré une majorité publique dans le capital). La compagnie aérienne qui prit sa relève (sur une échelle bien plus modeste), Brussels Airlines, fait à présent partie du groupe privé Lufthansa mais son avenir ne tient qu’à un fil. La CGER – son appellation complète, « Caisse générale d’épargne et de retraite », fleurait bon le XIXe siècle paternaliste – a été privatisée complètement en 1997-1998 et intégrée, avec la SNCI (Société nationale de crédit et d’investissement, une autre entreprise parastatale privatisée), au groupe privé Fortis. Ce dernier a également absorbé la Générale de banque, première banque du pays, mais s’est effondré de façon retentissante en 2008. Un autre fleuron de l’initiative économique publique, le Crédit communal, a subi une mésaventure similaire. Après sa privatisation et sa transformation en Dexia en 1996, cette institution financière s’écroula, à son tour, en 2011, par l’effet d’une gestion mégalomaniaque et imprudente.
Manifestement, ces privatisations majeures n’ont donc pas été couronnées de succès. Les grandes entreprises qui sont entièrement ou partiellement restées aux mains de l’État (essentiellement Proximus, BPost, Belgocontrol/Skeyes, les Tec et De Lijn, la SNCB et Infrabel) ont pour leur part connu, et connaissent toujours, des hauts et des bas. Jusqu’à présent, elles ont su répondre tant bien que mal aux défis constants lancés par les incessantes mutations technologiques et réglementaires – mais leur avenir est loin d’être garanti, surtout au vu des nouvelles étapes de la libéralisation des réseaux qui s’annoncent, notamment en matière de transports ferroviaires et de distribution postale. On notera toutefois que dans le sillage de la débâcle de Dexia les pouvoirs publics se sont paradoxalement réengagés en tant que fournisseurs de services financiers. Sur les ruines de Dexia fut en effet créée la banque Belfius en 2012, propriété de l’État à 100 %. Ce développement semble une anomalie du point de vue néolibéral prônant le « retrait de l’État » unidirectionnel et irrévocable ; il n’a en revanche rien de surprenant au vu de la nature mouvante des soi-disant « frontières » qui séparent l’État et le marché, et surtout du caractère extrêmement poreux de ces dernières.
Contrôler, guider
La création de Belfius – pied-de-nez bien involontaire à la doctrine de privatisation – est directement liée à une autre fonction essentielle de la puissance publique : l’État sauveteur, variante cruciale de l’État dispensateur d’aides financières (ou, plus irrévérencieusement, de l’État « vache à lait »). À la suite de la violente crise de 2008, qui menaçait les fondements mêmes de l’économie capitaliste, l’État belge a largement ouvert les vannes de la subsidiation. Certes, la perfusion financière reliant le Trésor public au secteur privé n’avait jamais cessé de couler – même vers des entreprises saines, qu’elles soient petites ou grandes, et même en pleine période de prospérité. Mais en 2008-2009, les opérations de sauvetage prirent des proportions véritablement inédites, suite au phénomène angoissant du too big to fail. Certains acteurs privés, trop grands pour être abandonnés à leur sort, devaient donc être sauvés coûte que coûte par la collectivité. Nouveau paradoxe : cet impératif vital est en contradiction avec le précepte néolibéral qui assigne à l’État une attitude passive face à des acteurs privés qui sont censés être entièrement et seuls responsables de leurs actes. Clairement, au-delà d’une certaine échelle, le « privé » devient donc « public », qu’on le veuille ou non – sans toutefois que l’autorité publique soit en mesure de guider ou même de contrôler sérieusement ces mastodontes privés. Voilà un bel exemple de l’entrelacs complexe entre le secteur public et le secteur privé (ou entre marché et État) sur lequel j’insistais dans les Paradoxes de l’État.
« Contrôler », « guider » : cela nous amène logiquement à l’État régulateur. Le gigantesque krach financier de 2008-2009, stoppé à coups de milliards d’euros d’argent public – et donc au prix d’une nouvelle envolée de l’endettement de l’État –, était dû, entre autres, à la défaillance et/ou à l’insuffisance patentes des mécanismes de contrôle et de prévention. La Commission bancaire et financière belge (CBFA) n’avait pas vu venir et/ou n’avait pas su empêcher la débâcle des principales institutions bancaires du pays. À la suite de ce pénible échec, l’État réforma le système de contrôle des institutions et marchés financiers en 2011, d’une part en créant la Financial Services and Markets Authority (FSMA) et de l’autre en transférant le rôle de surveillance des banques à la Banque nationale. Mais le contrôle des banques dites « systémiques » se fait dorénavant en étroite collaboration avec l’Autorité bancaire européenne, établie en 2011. En outre, dès 2002, l’État belge s’était déjà défait d’un autre instrument de régulation économique de tout premier ordre, feu le franc belge.
Ces importantes manettes économiques publiques, comme tant d’autres, ont en effet été transférées à une entité étatique d’un genre nouveau – une structure en pleine construction (faudrait-il plutôt dire « bricolage » ?) : l’Union européenne. Graduellement, l’État-nation belge perd son autonomie en matière d’action économique. Se transformant lentement en État succursale, réduit à un rôle d’exécutant, la puissance publique nationale est de plus en plus éclipsée par un pouvoir étatique supranational. Ce processus, qui n’a évidemment pas débuté en 1996-1997, est encore loin d’être achevé, car la lutte entre les États-nations et l’État supranational européen se déroule sous nos yeux. Il s’agit d’un des enjeux essentiels des décennies suivantes, dont l’issue est loin d’être établie d’avance. L’audience de partis comme le Rassemblement national en France, l’AFD en Allemagne et la Lega en Italie est là pour nous le rappeler – sans oublier le Brexit et l’America First trumpien.
Trois défis à venir
Dopé aux amphétamines – c’est-à-dire par les effets conjugués du néolibéralisme, de la financiarisation et des technologies digitales –, le capitalisme du XXIe siècle a légué à la planète trois problèmes cruciaux qui, d’une façon ou d’une autre, soulèvent la question du rôle économique de l’État.
Premièrement, nous sommes confrontés au dérèglement climatique, à la déplétion des ressources et à la rupture des équilibres naturels (dont découle notamment la pandémie actuelle). Ces menaces ont été générées par le capitalisme dès ses débuts, mais elles revêtent désormais une urgence et une gravité qui incitent l’État régulateur à se développer, à défricher de nouveaux terrains et à inventer de nouveaux mécanismes de contrôle et de guidage (donnant naissance à la variante de « l’État climatiseur » ?). Mais dans ce domaine, l’obsolescence et l’impuissance de l’État national sont patentes. En outre, l’immensité de la transition énergétique et écologique implique des moyens financiers publics d’une ampleur inconnue jusqu’ici. Les coûts liés aux ravages économiques et sociaux du covid-19 ne sont sans doute qu’un avant-goût des dépenses futures induites par le problème écologique. En 2021, l’appel au soutien financier des pouvoirs publics résonne de toutes parts et fait oublier (temporairement ?) les dogmes de l’équilibre et de l’austérité budgétaires dominants depuis près de quatre décennies. Nouveau paradoxe donc : plus que jamais, les réalités se trouvent en porte-à-faux avec des doctrines économiques et financières officielles, encore fortement teintées de néolibéralisme.
Deuxièmement : tout en rejetant les politiques keynésiennes de stimulation des revenus, le néolibéralisme prônait des mesures d’austérité salariale afin d’augmenter le taux de profit des entreprises. Ces mesures étaient accompagnées d’une politique fiscale ultra-favorable aux détenteurs de capitaux. Grâce à la passivité ou l’impuissance des autorités publiques, et surtout à la complicité de certains États qui se sont résolument engagés dans la voie de la concurrence fiscale, les grandes sociétés multinationales et leurs actionnaires éludent quasiment tout impôt depuis des décennies. Cette politique, qui s’est généralisée à partir de la fin des années 1970, a creusé les inégalités de revenus et de patrimoines. D’un côté, les couches sociales intermédiaires sont soit laminées soit menacées par la pauvreté et la précarité ; de l’autre, les super-riches s’enrichissent toujours davantage. Ce phénomène est certes plus accentué dans certains pays que dans d’autres (la Belgique, par exemple, ne figure pas parmi les contrées les plus « inégalitaires »), mais partout il menace la cohésion sociétale, notamment en sapant le consensus démocratique. Ainsi se pose de façon toujours plus aigüe la question de l’État redistributeur : la redistribution « à l’envers » pratiquée depuis quarante ans sera-t-elle remplacée par une redistribution « à l’endroit » ? Cette dernière permettrait à la fois une plus grande mise en commun des richesses (par le biais des pouvoirs publics) et une réduction des inégalités matérielles, comme cela fut le cas lors des Trente Glorieuses (1945-1975). La question fiscale est d’autant plus urgente que l’appel aux moyens financiers augmente de façon apparemment irrésistible, comme nous venons de le noter. Mais comme pour le problème écologique, le contraste est criant entre les possibilités (limitées) des États-nations individuels et les dimensions planétaires que revêt désormais la fiscalité.
Troisièmement : ces dernières décennies, la physionomie du capitalisme s’est profondément transformée, produisant des distorsions menaçantes. Certaines institutions financières ont pris des proportions et des formes dangereuses, nous venons de le rappeler. Les sociétés internationales de consultance et de rating exercent partout une influence énorme et quasi souveraine. Les entreprises du Gafam et les plateformes numériques à la Uber se sont transformées en (quasi-)monopoles et/ou s’avèrent profondément destructrices, tant pour le travail que pour le tissu économique « classique ». Certaines d’entre elles assument même des fonctions tellement cruciales qu’elles revêtent de facto un caractère presque public (en particulier la gestion de l’information et des big data). Des instances non-gouvernementales d’un type nouveau, émanant (du moins partiellement) des intérêts privés, se multiplient pour réguler et arbitrer des échanges économiques internationaux, délestant ainsi les États d’une partie de leur pouvoir de contrôle, de juridiction et de contrainte. Tous ces développements de la sphère privée génèrent donc de nouvelles et dangereuses formes d’interpénétration du marché et de l’État. Ils peuvent même, en fin de compte, aboutir à des situations de State capture, c’est-à-dire de sujétion, de direction et d’exploitation des instances publiques par des acteurs économiques privés. Voilà autant de défis pour les pouvoirs étatiques au sens propre, du moins si ceux-ci veulent maintenir une autonomie significative face aux grands intérêts privés. Pour rééquilibrer la situation en leur faveur, les États-nations devraient donc d’urgence développer, voire réinventer, leurs pouvoirs régulateurs (les lois anti-monopoles figurant parmi les formes les moins innovantes) et financiers (via une fiscalité plus vigoureuse), car la notion de propriété publique mondiale relève hélas encore de l’utopie…
Pour un retour en force de l’État
Ces considérations nous mènent évidemment bien au-delà du minuscule cas belge. Elles permettent toutefois de souligner que l’État se trouve toujours au cœur du fonctionnement du système capitaliste, même après quatre décennies de néolibéralisme. Ce dernier a certes modifié le fonctionnement et la physionomie du pouvoir public, mais il est loin d’avoir rendu l’État obsolète. Bien plus : selon toute probabilité, seule une action étatique à la fois vigoureuse et novatrice permettra d’écarter les dangers qui nous menacent – alors même que l’État est profondément marqué par la pratique néolibérale (détricotage des services publics, fiscalité défaillante, anémie ou disparition des entreprises publiques, priorité donnée à la notion de propriété privée par rapport à celle de « bien commun », etc.).
Ce n’est donc pas le moindre des paradoxes soulevés par l’État au seuil de cette troisième décennie du XXIe siècle : l’État (national, mais surtout supranational) devrait être plus vigoureux, alors qu’il sort affaibli de quatre décennies de transformations néolibérales. Qu’il y ait là un sérieux problème, même certaines voix jadis « critiques », voire hostiles, envers l’État commencent à s’en rendre compte. J’en veux pour preuve, par exemple, l’évolution des idées de Paul De Grauwe, un économiste belge bien connu. En 1987 paraissait son ouvrage intitulé La main visible. L’État dans l’économie moderne (Gembloux, Duculot). Il y affirmait que les forces bénéfiques du « marché libre » étaient souvent bridées par un État trop actif, trop entreprenant, trop contraignant, trop redistributeur, trop soumis aux oukases des groupes d’intérêts. Près de trente ans plus tard, il exprime des craintes radicalement différentes, dans un livre intitulé cette fois-ci (de façon significative) Les limites du marché. L’oscillation entre l’État et le capitalisme (De Boeck, 2015). Il termine sur ces paroles qu’il qualifie lui-même de « pessimistes » : « On peut dès lors conclure que si ces deux conditions [mentionnées ci-dessous] ne sont pas remplies, le système du marché libre court au-devant de ses deux limites : celles des coûts externes [= les limites écologiques] et celles de l’insoutenable inégalité interne de revenus[2.Voir p. 154 de l’édition anglaise (Oxford UP, 2017, ma
traduction) et p. 153 pour la citation suivante.]. » Pour éviter cette catastrophe, il préconise un « scénario réformiste » dans lequel les États affronteraient à la fois l’inégalité des revenus et les dangers environnementaux – « mais cela exige que les pays soient préparés de travailler ensemble ». La théorie néolibérale de l’État, tonitruante à la fin du siècle passé, perdrait-elle de sa crédibilité et de son audience ?
