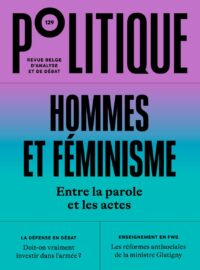Education
Concertation : faut-il entendre l’avis des élèves et de leurs parents ?
05.05.2025

La déclaration de politique communautaire (DPC) 2024 de la Fédération Wallonie-Bruxelles entend mener « une véritable culture de l’évaluation des politiques publiques ». On s’en réjouit. Mais la concertation ne suit pas. Alors, faut-il ou non écouter les usagers de l’enseignement quand on est ministre de… l’enseignement ? Véronique de Thier et Joëlle Lacroix, co-directrices de la Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (FAPEO ASBL) nous expliquent.
En 2017, au travers du Pacte pour un enseignement d’excellence, les trois acteurs institutionnels de l’École (Fédérations de Pouvoirs organisateurs, organisations syndicales des enseignants, fédérations des associations de parents) négociaient un avis commun qui donnait le feu vert pour une réforme fondamentale du système scolaire, après trois années de diagnostic partagé et de pistes de changements évaluées sous toutes les coutures. L’une des évolutions majeures était de reconnaître (même de façon imparfaite) la place de chacun·e dans l’école, en ce compris celle des parents des usagers du service public d’enseignement que sont les élèves.
Un virage autoritaire
Cependant, en 2024, un virage est pris par le nouveau gouvernement, qui inquiète les élèves et leurs parents. La réforme systémique programmée en 2017 pour asseoir un nouveau paradigme est détricotée. Elle perdra de sa force par l’affaiblissement de sa logique interne. Valérie Glatigny souhaite passer d’un « Pacte d’excellence » pour tous et toutes à un « Pacte de confiance pour une école de l’exigence ». Ce nouveau discours est celui de la réhabilitation d’un récit de l’ « autorité » de l’enseignant·e qui de ce fait, replace à la périphérie l’attention portée aux élèves et à leurs vécus.
Même si les témoignages continuent de se multiplier sur ces écoles qui dysfonctionnent et ce système scolaire qui violente massivement des élèves en prise avec les difficultés, la nouvelle ministre veut « rétablir l’autorité », ramener la discipline et interdire les smartphones aux élèves. Mais en un même temps, à ce stade, elle laisse faire les pratiques numériques anormales d’enseignant·es qui demandent aux élèves de rester connectés aux plateformes numériques scolaires après la fin de la journée d’école, ou encore, souhaitent imposer aux parents un « contrat avec l’école » leur rappelant leurs « devoirs », contrat qui ne peut être qu’un pacte léonin – un de plus.
Nos craintes ne naissent pas seulement des conceptions mises en avant quant au rôle de chacun·e et aux récits avancés : nous constatons que ceux-ci ont des influences sur les décisions prises. Valérie Glatigny ne semble pas suffisamment attentive aux signaux qui émanent des usager·es et de leurs réalités. Les conséquences des politiques mises en place reviendront pourtant immanquablement dans la figure du système éducatif. Et si la ministre les écoutait ?
Une liste de réformes qui fragilisent le parcours de nombreux élèves
Les fédérations représentatives de parents d’élèves, FAPEO, et UFAPEC, ont relayé les inquiétudes et les craintes dans les organes de concertation institués. Mais ce que nous avons mis en avant ne semble pas avoir été suffisamment entendu. Sept points d’alerte apparaissent ainsi particulièrement importants.
Premièrement, de nombreux élèves fragiles de l’enseignement secondaire qualifiant (élèves majeurs décrocheurs de 3e et 4e secondaire, élèves porteurs d’un CESS qui voulaient terminer leur formation par une 7e année) sont réorientés vers la promotion sociale, bientôt renommée « enseignement pour adultes ». La décision fauche ainsi les élèves qui sont actuellement déjà engagés dans leur parcours. L’enseignement de promotion sociale – pour adultes, que fréquentent aujourd’hui les 30-40-50 ans et plus, va-t-il pouvoir apporter l’attention spécifique dont ces jeunes, de 18 ou 19 ans, ont besoin ? Comment seront-ils accompagnés vers cette nouvelle voie qu’ils n’ont pas choisie, après avoir renoué avec le système scolaire, malgré les déboires qu’ils y ont connus ? Comme nous le disions, les élèves usagers et leurs parents n’ont jamais été concertés au sujet de cette décision.
Deuxièmement, les pouvoirs publics ont décidé une diminution du financement public de l’enseignement. En parallèle, d’autres décisions auront pour effet d’augmenter le coût à charge de nombreux parents. Outre des coupes budgétaires dans l’enseignement qualifiant, le gouvernement a réduit les budgets prévus pour la rénovation d’infrastructures déjà en mauvais état, élèves et parents le constatent dans des établissements. En parallèle, une hausse de 100 € de la facture de rentrée est à prévoir, en moyenne, pour les parents d’élèves qui entreront en 4e primaire l’an prochain, du fait du gel de la gratuité des fournitures scolaires. « Pacte de confiance » oblige, la ministre a enfin décidé de suspendre les contrôles vérifiant le respect par les écoles de la législation encadrant les frais scolaires. Si les écoles ne sont ni contrôlées préventivement ni sanctionnées, les frais demandés illégalement aux parents vont encore augmenter.
Troisièmement, le développement du tronc commun est bouleversé, puisque les élèves n’ayant pas obtenu leur CEB seront obligatoirement orientés vers une nouvelle version de l’encadrement différencié, dans les seuls établissements secondaires qui l’organisent. Avec un seuil de réussite à cette épreuve réhaussé maintenant à 60%, quel impact aura l’augmentation du seuil pour le nombre de redoublements ? Il y a de quoi redouter le retour d’une vision sélective, et non pas de service public, du système scolaire, une conception ordonnée à deux actions : trier et orienter.
Quatrièmement, l’introduction du test CLÉ (Calculer Lire Écrire), portant sur les compétences à acquérir à la fin de la troisième primaire, ajoute une période d’évaluation au début du tronc commun. Cette épreuve qui aura lieu en début de 4e primaire fait fait fi des pratiques d’évaluation et d’accompagnement des enseignant·es au quotidien. Comment éviter que ce test général ne crée une pression scolaire supplémentaire ? Quel message sera transmis aux enfants et aux parents ? Quelles conditions de passation seront mises en place ?
Cinquièmement, les élèves les plus fragiles seront aussi moins soutenus que prévu. Les souffrances scolaires et de santé mentale ont tellement augmenté depuis la fin de la pandémie, que nous sommes passés de 50 000 à 90 000 élèves en décrochage scolaire ces quatre dernières années. Un dispositif de suivi préventif du décrochage en secondaire devait être mis en place à la rentrée scolaire. Mais la ministre Valérie Glatigny veut le reporter de deux ans en secondaire, et renforcer plutôt les sanctions envers les parents des élèves en souffrance. La ministre envisage de plus d’appliquer ce dispositif à l’enseignement fondamental d’abord alors qu’on est passé en secondaire de 24 525 à 61 252 élèves en décrochage de 2018-19 à 2023-24. Ces jeunes ont besoin d’un suivi et d’un accompagnement bienveillant renforcé de manière urgente. Pourquoi le reporter et pourquoi ne pas l’organiser prioritairement en secondaire vu les signaux alarmants ?
Sixièmement, autre problématique essentielle : les exclusions scolaires sont, elles aussi, en forte hausse. Face à ce phénomène, des chambres de recours devaient être mises en place, mais là aussi le système est reporté. Les élèves et leurs parents n’auront toujours pas droit à un traitement identique dans le fonctionnement des procédures et le respect de leurs droits.
Un septième point est celui du calendrier scolaire, qui va être à nouveau bousculé. La ministre envisage toujours de revoir le décret relatif à l’adaptation des rythmes scolaires annuels afin que les élèves francophones, néerlandophones et germanophones aient une semaine de vacances commune à partir de 2026 entre les mois de janvier et de juin.. Les familles qui ont décidé d’inscrire leurs enfants dans plusieurs systèmes d’enseignement ne sont pourtant que 5% à l’échelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce changement annoncé aurait pour conséquence qu’un élève ait, lors de certaines années, des périodes de cours très allongées sans période de congés – jusqu’à 9 ou 10 semaines – alors que les études montrent qu’il ne faut pas dépasser 7, maximum 8 semaines pour éviter qu’il ou elle ne s’épuise. Les conséquences sur la qualité des conditions d’apprentissages, mais aussi la fatigue et le bien-être de l’enfant se feraient rapidement ressentir.
Pourquoi remettre en cause le tronc commun ?
Vendredi 8 février, la ministre de l’Enseignement Valérie Glatigny a annoncé dans la presse qu’elle souhaiterait mettre en pause le tronc commun, alors que celui-ci est en cours d’implémentation. Mais le tronc commun polytechnique de 3 à 15 ans est justement l’une des mesures structurantes du Pacte pour un enseignement d’excellence. Son but est de s’attaquer enfin à la question des inégalités scolaires. Ce parcours de cours, communs à tous les élèves jusqu’à 15 ans, permet d’éviter la relégation précoce, et donne à tous les élèves un même bagage de base.
Ce nouveau tronc commun se veut polytechnique, c’est-à-dire qu’il n’y a pas seulement des cours dits “théoriques” – mathématique, français, sciences… -, il y a aussi des cours manuels, techniques, technologiques et numériques. Des activités d’éveil aux différentes possibilités ultérieures de choix de filières sont fixées dans ces nouveaux programmes de cours, dépoussiérés et mis au goût du 21e siècle – tout au long du parcours de l’élève. L’élève sera orienté·e de façon progressive. L’objectif attendu est ainsi d’éviter, la sélection et la relégation précoces, comme c’est le cas hélas actuellement dans notre enseignement.
Veut-on vraiment en finir avec le système de relégation ?
Lorsque des difficultés étaient rencontrées à l’école, la solution de l’ancien système scolaire était de proposer très précocement à l’élève un changement d’option ou de filière, pour diminuer la quantité de cours posant problème. “Des difficultés en maths ?” On propose alors à l’élève de choisir une option avec moins d’heures de mathématique. Ce fonctionnement signifiait une stratification de notre enseignement, qui faisait du qualifiant une filière de relégation, et de notre système scolaire l’un des plus inégalitaires au monde. De ce fait, l’enseignement qualifiant est aujourd’hui très majoritairement une orientation contrainte, choisie trop souvent par dépit, en raison de difficultés scolaires précédentes.
En revanche, le nouveau système prévoit désormais un même socle d’activités communes, pour tous les élèves, jusqu’à la fin de leur troisième année d’étude secondaire. Ce socle présente un parcours d’activités orientantes continu, mêlant des cours généraux et techniques. Le but est qu’après le tronc commun, le choix d’orientation de l’élève soit éclairé et libre, fondé sur le fait qu’il et elle ait pu essayé les diverses matières et activités proposées. . Pour les élèves en difficulté, c’est donc la logique inverse à la précédente : des budgets dégagés pour permettre un renforcement de l’accompagnement personnalisé et des pratiques éducatives de différenciation scolaire, qui mettent plus l’accent sur les élèves ayant besoin de renfort scolaire. “Des difficultés en math ?” On lui proposera de prendre un temps personnalisé pour l’aider à les surmonter. Ce système est à peine en train de se déployer et, malgré le choc induit par la crise covid sur notre système éducatif et les effets délétères de la pénurie d’enseignant·es, il produit des effets positifs !
Une “mise en pause” peu judicieuse
En juillet 2024, le nouveau gouvernement avait déjà annoncé la concentration d’activités orientantes en 3e secondaire. Mais le tronc commun est un tout, un parcours cohérent. Modifier les programmes de cours en 3e secondaire pour y concentrer les activités d’orientation pourrait entrainer la nécessité de modifier les activités déjà planifiées en 1re et 2e secondaire. Cette orientation concentrée (alors qu’elle avait été pensée comme progressive et continue sur l’ensemble du parcours) suscitait déjà les inquiétudes de nombreuses organisations syndicales et des défenseurs des parents. Or le 8 février, la ministre est allée plus loin, en menaçant d’une pause, voire d’une remise en cause du projet. Il s’agirait concrètement d’arrêter abruptement le tronc commun après la 2e secondaire, pour une période transitoire indéterminée. Ce qui – un comble pour une ministre qui déclare vouloir alléger le train des réformes – obligerait les équipes éducatives à revoir en urgence les référentiels de 1re et 2e secondaires !
Mettre “en pause” cette feuille de route se ferait sans tenir compte de tous les élèves. Effectivement, il y a aujourd’hui plus ou moins 400 000 élèves qui sont déjà engagés dans ce nouveau parcours. Les élèves les plus âgés qui ont toujours connu ce nouveau tronc commun sont aujourd’hui au milieu de leur 5e année primaire. Ces jeunes ont connu des programmes de cours tout nouveaux : ce ne sont pas les mêmes jeunes, et ils n’ont pas les mêmes acquis d’apprentissage. Ils et elles n’ont d’ailleurs pas eu non plus les mêmes grilles horaires de cours, que ceux que les enseignant·es du secondaire avaient connus jusqu’ici. L’ensemble de leur parcours a été construit de façon à ce qu’ils et elles achèvent le tronc commun à l’âge de 15 ans. Dans un an et demi, ces élèves arrivent en première secondaire. Les règles du jeu, préparées, travaillées, concertées depuis tant d’années, ne peuvent changer abruptement.
Ce changement poserait de multiples questions. En effet, plus globalement, si l’on déstructure le tronc commun, quelle autre réforme éducative la ministre de l’Enseignement compte-t-elle mettre en place pour soutenir les élèves les plus fragiles, travailler à la réduction des inégalités scolaires et à la réalisation du plein potentiel de chaque élève ?
Conclusion ? Une fois de plus, nous l’affirmons : pour faire évoluer la qualité du système éducatif et améliorer le service public, au bénéfice premier de ses usager·es, la première chose est… de les écouter et de décider après avoir compris leurs réalités.
Cet article a paru en version abrégée dans le numéro 129.