Féminisme
Contre le féminisme punitif, pour un féminisme transformateur
26.01.2023

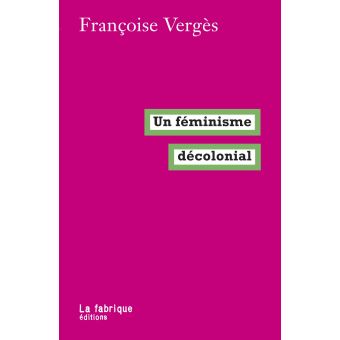
L’apparition du concept de féminisme carcéral (ou punitif) dans le vocabulaire militant francophone est récente. L’accentuation de son utilisation s’est manifestée suite au mouvement #metoo. Vous l’abordez dans votre ouvrage. Comment le définissez-vous ?
FRANCOISE VERGÈS : Je ne pense pas que le mouvement #metoo puisse se résumer à un appel au féminisme carcéral. Rappelons que pour Tarana Burke, la militante noire qui a lancé ce mouvement en 2006, il s’agissait de permettre à des jeunes femmes noires victimes de viols et de violences de trouver des espaces de recours, d’écoute, de respect, de dignité et de reconstruction. Mais il est vrai que, dès l’affaire Weinstein, le mouvement a été associé à des inculpations, des enquêtes judiciaires et des procès. La notion de féminisme carcéral – on parle aussi de féminisme punitif – est alors entrée dans le vocabulaire. Si le mouvement #metoo constitue une demande de justice, il n’est pas exclusivement lié au féminisme carcéral.
La notion de féminisme carcéral, qui est d’abord apparue aux États-Unis, a été rapidement critiquée par des féministes noires ou radicales et des LGTBQI+ antiracistes. Ces mouvements ont rappelé qu’on ne pouvait pas penser l’incarcération sans intégrer l’histoire de la prison, de la racialisation de la criminalisation, des lynchages, de l’incarcération massive des hommes noirs, du fait que les viols et les violences contre les femmes noires n’ont pratiquement jamais été conçus comme des crimes, que les hommes blancs ont très rarement été punis mais que l’inculpation d’hommes noirs et latinos, comme leur incarcération, ont été systématiques. Je partage entièrement cette analyse.
Le féminisme carcéral choisit d’ignorer cette histoire ou de la marginaliser. Il n’intègre pas dans sa demande de rétribution le fait que tribunal, police et prison sont des institutions racistes. Les féministes noires ne disent pas que viols et violences ne sont pas des crimes ou qu’il ne faille pas concevoir une « punition », mais elles disent que l’appel à la loi, dans une société raciste/sexiste qui utilise la loi pour maintenir le racisme et le sexisme, a des conséquences sur les communautés racisées. Ces féministes, dont la plus connue en France est Angela Davis, plaident pour l’abolition de la prison et veulent que nous réfléchissions aux processus de criminalisation dans une société capitaliste, patriarcale, sexiste et raciste.
Alors, comment protéger les femmes ?
FRANCOISE VERGÈS : Je lisais récemment sur un blog féministe un texte qui résume bien les idées du féminisme carcéral. J’en cite quelques lignes : « Le fait que les appels à une “justice réparatrice” ou à une abolition de la police viennent habituellement d’une gauche centrée sur les hommes, est peut-être un indice significatif. Les féministes, après s’être dissociées de la gauche – où leurs enjeux étaient ignorés et où elles-mêmes étaient sujettes à une misogynie continue des gauchistes – se sont battues pour faire criminaliser des agressions comme la violence conjugale et le viol marital. Certains en ont alors profité pour dénoncer ce qu’ils ont appelé un “féminisme carcéral”. Voilà une injonction contradictoire à laquelle les femmes ne peuvent échapper : soit on nous qualifie de “pro-flics” et de traîtres à la gauche, soit nous devons rester muettes, sans recours face à la violence et aux agressions des hommes ». Déjà, ces arguments sont venus en premier de féministes racisées, radicales ou anarchistes, et non pas d’hommes d’extrême gauche. Ensuite le débat ne porte pas sur choisir entre être « pro-flics » ou rester silencieuses, mais sur la confiance que l’on fait à l’État, au point d’en faire le gardien des libertés des femmes, des queer, des trans et des travailleuses du sexe, toutes des cibles de la violence sexuelle.
Le féminisme carcéral est complice de l’État carcéral, qui se présente depuis quelque temps comme le protecteur des libertés des femmes, multipliant les lois de « protection ». Mais cette protection exige que les femmes obéissent aux normes imposées par le protecteur en question, celui qui dans le même temps criminalise les femmes voilées, les hommes noirs et arabes, et protège l’impunité de la police. Le féminisme carcéral est à l’opposé du féminisme qui a toujours dénoncé les politiques de criminalisation et d’incarcération de l’État. Le terme même de protection induit une faiblesse, le besoin d’un protecteur. Et ces deux positions – protecteur et protégée – sont très souvent genrées : on imagine aussitôt un homme dans la position du protecteur du faible, du vulnérable (l’enfant, la femme, la personne âgée, le queer blanc). Or la protection ne s’exerce pas exclusivement dans cette paire, du fort au faible, mais aussi dans l’élaboration de solidarités et de réseaux d’écoute et de protection : protection de militant∙e∙s, de témoins, de migrant∙e∙s, de femmes qui fuient la violence, d’enfants. L’histoire des luttes abonde d’exemples de ce genre, que ce soit des luttes politiques ou de co-protection des travailleuses du sexe, des trans, des personnes rendues vulnérables par un régime répressif et normatif. Personne ne doit rester seul face à la violence : voilà l’objectif.
On ne pourrait plus porter plainte ?
FRANCOISE VERGÈS : Attention : cela ne signifie pas que l’appel à la police et au tribunal soit exclu! Ces institutions existent, leur mission est de faire appliquer des lois souvent obtenues à la suite de luttes. Leur faire appel est donc légitime. Si ces institutions ne font pas bien leur boulot, il faut les y forcer. Mais on ne répond pas pour autant aux injustices de classe, de genre et de race. La société n’est pas structurée que par le genre, et le genre est racisé comme la classe. Police, justice, prison sont des institutions de l’État et du patriarcat, intimement liées au capitalisme racial. N’oublions pas le rôle de la prison dans l’esclavage, l’impunité du viol des femmes esclaves, le viol comme arme de la guerre coloniale, le rôle du fascisme et de la répression policière. Refouler cette histoire, dont les conséquences sont encore visibles aujourd’hui, c’est se rendre complice de l’appareil répressif. Et criminaliser sans se poser la question de ce qui vient après – la prison, la rétribution, la vengeance –, c’est trop facile. Poser le problème en ces termes : « Si vous n’êtes pas pour la criminalisation (donc l’incarcération), c’est que vous êtes pour l’oppression des femmes », c’est mal poser le problème.
Quand on se penche sur le scénario dominant dans des films traitant de la violence contre les femmes (des films hollywoodiens, mais aussi venant d’autres centres du cinéma), on voit comment sont mis en scène les liens entre ordre patriarcal/masculin et vengeance meurtrière. Le criminel est souvent un homme racisé, ou étranger à la norme patriarcale. Soit un homme jusqu’ici paisible (père de famille, mari, amant) est poussé à prendre les armes pour défendre « sa » femme et sa famille et tuer en toute légitimité – le crime répond au crime –; soit, si c’est une femme qui occupe la position de vengeresse, elle doit prendre le rôle de l’homme vengeur pour blesser, torturer, tuer celui qui l’a kidnappée, torturée, violée. Une femme violée est soit vengée par son compagnon, époux, etc., soit obtient vengeance en devenant une tueuse. Le scénario peut aussi intégrer de longues scènes de procès où l’avocat, le procureur ou le juge occupent la place du protecteur (ce personnage peut être féminin). Être protégée ou se protéger revient à se faire justice ou à faire confiance aux institutions policières et judiciaires. Pas de recours, donc, en dehors de l’appel à des institutions qui ont prouvé qu’elles pratiquaient une justice raciale, genrée et de classe. Je ne nie pas l’attraction de ces scénarios, le plaisir de voir le violeur puni – j’ai eu en tête ces scénarios dans des situations de violence, j’ai imaginé ma vengeance. Mais s’accrocher à ce scénario, ne pas imaginer d’alternative, viser de plus en plus l’obtention de lois qui criminalisent, souhaiter que les prisons s’agrandissent, ce n’est pas le féminisme que je défends.
Le féminisme carcéral penche de ce côté : punir, criminaliser, emprisonner. Il ne s’attaque ni à la militarisation de la société, ni au capitalisme, ni à l’extension de la criminalisation. Je ne pense pas que tout soit causé par le capitalisme, mais je ne vois pas comment nous allons surmonter les effets de pouvoir et de violence masculine en augmentant la criminalisation et le pouvoir de la police, du tribunal et de la prison. Il faut imaginer une politique féministe décoloniale de la protection. Il faut oser aller au-delà de la rétribution et de la vengeance qui ne mettent pas fin à la violence. Le féminisme transformateur (transformative feminism) va dans ce sens : il analyse le crime dans le contexte sociopolitique et culturel qui autorise le crime et imagine un monde où la sécurité ne repose pas sur la prison.
Le concept de « justice réparatrice » fait partie des solutions alternatives proposées contre le recours à la police et au système carcéral lors de violences sexuelles. Comment définissez-vous ce concept ? Existe-t-il des expériences concrètes de ce modèle pour traiter des cas de violences sexuelles ?
FRANCOISE VERGÈS : Les concepts de justice réparatrice ou de justice restauratrice sont très importants (la justice restauratrice dit mettre plus l’accent sur la restauration de la vie en commun). Ces deux formes de justice incluent auteur∙e, victime et société; elles insistent sur le travail que doit faire celui ou celle qui a causé un tort ou un crime pour prendre conscience de la portée de son crime, du dommage occasionné, non seulement à la personne victime et à lui-même/elle-même, mais aussi à la communauté. Ces deux formes visent les trois mêmes objectifs, peut-on dire : la réparation de la victime, la responsabilisation de l’auteur, le rétablissement de la vie commune paisible. Ces deux notions sont à mes yeux inséparables du débat sur l’abolition des prisons. Angela Davis, qui a connu la prison, pose la « désincarcération comme postulat » et défend un « système judiciaire posé sur la réparation et la réconciliation et non pas sur la rétribution et la vengeance ». Il y a aussi l’immense travail de Ruth Wilson Gilmore : son ouvrage Golden Goulag est formidable[1. R.W. Gilmore, Golden Goulag: Prisons, Surplus, Crisis and Opposition in Globalizing California, Oakland, University of California Press, 2007.].
Ce mouvement existe aussi en France et il va de pair avec la justice restauratrice. Il faut lire L’abolition de la prison de Jacques Lesage de La Haye[2. J. Lesage de La Haye, L’abolition de la prison, Paris, Libertalia, 2019.], ancien détenu, psychanalyste et animateur de l’émission Ras les murs, qui définit la prison comme un lieu de destruction systématique de l’individu. Il donne l’exemple de sociétés qui traitent le crime autrement que par l’emprisonnement. Il cite le cas des peuples autochtones dans l’État de Guerrero au Mexique. Ayant fait le constat que non seulement la police de l’État était complice des criminels mais aussi qu’elle était indifférente aux crimes commis contre leurs communautés, ils ont décidé d’appliquer leur propre forme de justice, et ils ont réussi. Les Kanaks[3. Peuple indigène de la Nouvelle-Calédonie (NDLR).] aussi ont leur propre forme de justice restauratrice – elle prend son temps, ça fait partie du processus. On sait qu’il a fallu plusieurs années pour que les deux tribus kanakes – celle de Tjibaou et celle de son assassin[4. Jean-Marie Tjibaou, leader du mouvement indépendantiste kanak FLNKS, a été assassiné en 1989 par Djubelly Wéa, membre d’une fraction dissidente, le FULK, opposé aux accords avec la France (NDLR).] – se retrouvent autour d’une cérémonie de restauration, d’une entente. Pas de vendetta qui se transmet de génération en génération, mais une restauration.
On ne peut pas parler de criminalisation et de punition sans tenir compte de l’histoire de la prison en Occident. À commencer par le système punitif sous l’esclavage colonial, la transformation des Noir∙e∙s en objets à torturer, à emprisonner et à tuer en toute impunité, sans aucune possibilité de faire entendre leur voix, car leur témoignage ne comptait pas. Et sous le colonialisme, pas de justice. En France, les prisons sont depuis toujours des lieux exécrables, aujourd’hui condamnés par l’Observatoire international des prisons et par le Conseil de l’Europe pour leur violation des droits des prisonniers et des prisonnières, les violences, les viols, la saleté, l’isolement, le racisme, l’islamophobie. Je ne peux défendre, au regard de cette histoire, une politique féministe qui encourage la criminalisation, donc le recours à l’incarcération.
Pour en revenir à des exemples de justice non répressive, si je ne prends que la France, il y a, outre le travail de Jacques Lesage de La Haye, celui de Catherine Baker[5. Autrice française, animatrice d’émissions sur France Culture (NDLR).] qui a dit : « Nous voulons détruire la prison, à la fois parce que la société où nous sommes est une prison et parce que la prison où nous sommes est une société. » Ou encore celui de Stéphane Jacquot, qui a fondé l’Association nationale de justice réparatrice, ou celui de Marie-Cécile et Jean-Paul Chenu, les parents d’un jeune homosexuel assassiné par trois jeunes néonazis : ils ont voulu les rencontrer, seul l’un d’eux a accepté et un lien réparateur s’est créé. On a aussi des exemples en Italie, en Suède…
En France, bien que la justice restauratrice soit entrée dans le Code de procédure pénale (par la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales), c’est plutôt la peine de prison qui est revendiquée dans les cas de violences sexuelles, dont on sait qu’elles sont en grande majorité commises par des proches, des membres de la famille. La Fédération France-Victime a organisé des séances de justice restauratrice dans des cas de violences sexuelles. Selon les mots de sa porte-parole Olivia Mons : « Il y a deux types de mesures possibles. Les premières sont les rencontres directes entre auteur et victime. Un tiers peut également être présent. Les secondes consistent en des rencontres anonymes : les personnes ne se connaissent pas mais sont visées par des faits qui se ressemblent. » Ces réunions nécessitent une longue préparation des personnes. Les premières réunions ont eu lieu à la prison de Poissy en 2010. La Belgique et l’Irlande sont parmi les pays les plus avancés en la matière. De manière très contextuelle, aujourd’hui, la montée de partis néofascistes et du capitalisme néolibéral en Europe est une menace pour les mouvements abolitionnistes, car ces idéologies prônent la criminalisation des femmes, des LGTBQI+, des migrant∙e∙s, des Roms, des dissidents, des racisé∙e∙s, répandent la haine des musulman∙e∙s, encouragent l’incarcération des racisé∙e∙s et défendent l’impunité de la police et sa militarisation.
Dans le contexte francophone, une des caractéristiques inhérentes à ce que vous définissez comme le féminisme carcéral demeure une assignation raciale (arabe, noir, latino, etc.) aux comportements produisant des violences sexuelles. À quoi est due cette fixation ?
FRANCOISE VERGÈS : Il existe une série télévisée, When They See Us d’Ava DuVernay, sur l’inculpation de cinq adolescents noirs et latinos par la ville de New York en 1989. Ils étaient accusés d’avoir violé et battu une femme blanche dans Central Park. Trump acheta une pleine page de publicité pour demander le retour de la peine de mort contre eux. Leurs aveux leur furent extorqués par la police qui les terrorisa. Ils avaient entre 14 et 15 ans; seul l’un d’eux avait 16 ans et ne fut donc pas considéré comme mineur. L’avocat général ne présenta aucune preuve, aucune! Mais la victime était une jeune femme blanche qui travaillait à Wall Street, eux venaient de Harlem et avaient osé entrer dans la partie de la ville réservée aux Blancs. Ils furent animalisés par l’accusation, décrits comme une « meute » dont le but était de terroriser les Blancs. Bien que l’accusation ne présentât aucune preuve, ils furent condamnés. Pourquoi ? Parce qu’ils étaient noirs et latinos, donc leur sexualité (à 14 ans !) était aux yeux de la police et du tribunal inévitablement « bestiale », ils ne pouvaient que désirer la « femme blanche » pour la violer et la battre à mort. Ça avait été la justification du lynchage, ça pouvait encore marcher, se dirent toutes ces institutions. Ces très jeunes adolescents n’avaient aucune humanité aux yeux des médias, de la police, du tribunal, parce que noirs et latinos. La communauté noire s’organisa mais elle ne put contrecarrer un racisme si ancré, car indispensable au confort social de la société blanche. Je vivais alors aux États-Unis et je me souviens très bien du déferlement de haine raciste contre eux.
Et quant à la spécificité française…
FRANCOISE VERGÈS : Je n’oublie pas votre question. Mais si j’ai commencé par ce cas emblématique, c’est parce que je pense que le contexte est comparable : la France a été une des grandes puissances esclavagistes européennes, elle a eu des colonies esclavagistes et, dès lors, il y a eu invention du Blanc et de la Blanche, et donc des Noir∙e∙s. Les femmes blanches furent construites comme fragiles, prudes, ne pouvant faire de grands efforts physiques, et dont la virginité jusqu’à leur mariage devait être absolument préservée, alors que les femmes noires devaient, elles, être « disponibles » pour les hommes blancs. Elles étaient vues comme dépourvues d’instinct maternel, elles étaient violées par des Blancs dès leur enfance, devaient travailler jusqu’à la dernière minute quand elles étaient enceintes, étaient renvoyées au travail aussitôt, séparées de leurs enfants.
Les hommes blancs étaient des patriarches respectés, les droits de paternité et de propriété leur étaient réservés, la violence leur était non seulement permise mais était encouragée. Par contre, les hommes noirs étaient construits comme sauvages et bestiaux, avec une sexualité qui ne pouvait être maîtrisée, désirant la femme blanche. N’oublions pas que le plus grand interdit a été les relations sexuelles entre hommes racisés et femmes blanches, un des premiers décrets dans les colonies esclavagistes a légiféré cet interdit. Femmes et hommes blancs avaient droit de mort sur les esclavagisé∙e∙s, les femmes blanches n’avaient aucun droit civique sauf celui de posséder des êtres humains et dès lors de les traiter en objets. Je cite dans Le ventre des femmes[6. F. Vergès, Le ventre des femmes : capitalisme, racialisation, féminisme, Paris, Albin Michel, 2017] le cas, dans la colonie de La Réunion, d’une enfant noire de 12 ans que son propriétaire veut violer. Elle résiste, il la fait fouetter puis lui fait brûler le sexe. Un autre cas : un jeune Blanc viole une petite fille noire, il n’est pas puni. Alors, on pourrait dire que ça a changé et que c’est pour que ça ne se reproduise plus qu’il faut un féminisme carcéral, mais la société hérite de tout ça. Après l’esclavage, masculinités et féminités noires, arabes, ou asiatiques, sexualités noires, arabes, asiatiques, ont été construites par le pouvoir colonial comme sortant de la norme occidentale patriarcale.
Seule la sexualité des hommes blancs était « normale ». Le cinéma n’a fait que renforcer ces représentations aux conséquences très concrètes. Toutes les sociétés européennes ont fonctionné sur cette base.C’est l’effet-retour dont parle Aime Césaire[7. A. Césaire, Discours sur le colonialisme, Tunis, Présence africaine, 2000.] dans Discours sur le colonialisme : une société qui esclavagise et colonialise connaîtra un effet-retour, toutes ces lois racistes reviendront chez elle ; les politiques de dépossession, de mépris, de transformation de cultures, de peuples en structures inférieures, ça ne restera pas « là-bas ». Le féminisme décolonial refuse d’avoir à choisir entre la protection par l’État raciste et pères et frères racisés.
On peut me répondre qu’il n’y a plus de colonies. Ça se discute, mais admettons. Pour autant, pouvons-nous croire que ces siècles n’auraient rien laissé? Que la fin de l’Algérie française en 1962 aurait sonné en France la disparition de l’idéologie coloniale/raciale ? Ça serait vraiment la seule idéologie qui aurait disparu comme par miracle! C’est ne rien comprendre à la manière dont fonctionnent les idéologies et les sociétés. Il ne s’agit donc pas simplement de changer les imaginaires, mais bien de changer les structures. Tant que la société sera raciste, le féminisme carcéral contribuera à la marginalisation des luttes des femmes racisées et à l’incarcération des hommes racisés et pauvres.
Propos recueillis par Hamza Belakbir.
