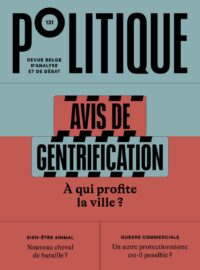Education
En débat. Une place garantie dans une école, pour en finir avec la ségrégation ? (2/2)
12.11.2025
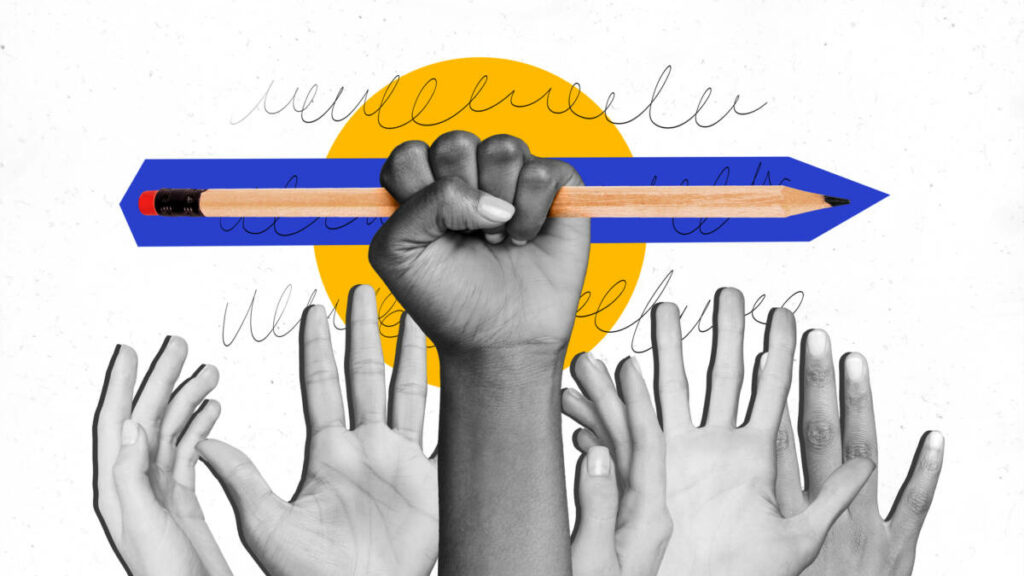
Le système éducatif belge figure parmi les plus ségrégués d’Europe, où, plus qu’ailleurs, les élèves sont confinés dans des « ghettos » de riches ou de pauvres. Cette ségrégation sociale, ethnique et culturelle est contraire à l’éducation commune qu’exige une citoyenneté démocratique. Pour la contrer, plusieurs pistes sont proposées. Parmi celles-ci : la pré-affectation grâce à un algorithme qui prend en compte, notamment, la distance domicile-école. Que permettrait un tel dispositif ? Et, surtout, règlerait-il réellement le problème de ségrégation sociale ?
La proposition de l’APED visant à refondre le système d’inscription scolaire met en lumière une possibilité théorique de parvenir à une meilleure répartition des élèves de l’enseignement secondaire. L’idée d’assigner à chaque enfant une école plus proche de son domicile tout en favorisant une mixité scolaire accrue grâce à une méthode et un algorithme prometteurs offre une alternative séduisante à un système actuel largement critiquable. Cette proposition a le mérite indéniable de poser clairement les termes techniques d’une alternative possible et de forcer la réflexion sur des bases nouvelles.
Néanmoins, pour que cette démonstration mathématiquement convaincante puisse inspirer une action concrète, il est essentiel d’en examiner les implications et les hypothèses sous un angle sociologique. L’approche semble parfois abstraire la complexité des comportements humains, laissant implicitement croire à une manipulation des individus comparable à celle de curseurs dans un logiciel statistique. Il est regrettable que la réflexion sur ce qu’implique d’agir sur un système humain soit peu présente, d’autant que plusieurs hypothèses sous-jacentes semblent sociologiquement fragiles.
La peur de « perdre au change »
Le pari central de l’APED selon lequel une proposition d’école à la fois proche et socialement mixte suffirait à dissuader les parents de changer d’établissement apparaît particulièrement audacieux et soulève d’importantes questions quant à son réalisme sociologique. Ce postulat semble ignorer que l’évaluation parentale de la composition d’une école repose souvent davantage sur des indicateurs visibles, comme la composition ethnique perçue, que sur des indices socio-économiques abstraits.1 De plus, même si l’on garantissait une similarité statistique entre écoles, l’influence de la « connaissance chaude » – informations subjectives récoltées via les réseaux personnels – risque fort de l’emporter sur les données objectives fournies par l’administration qui façonne des représentations tenaces de la hiérarchie scolaire. Réduire les différences ne les élimine pas, laissant potentiellement la porte ouverte aux demandes de changement des plus stratèges.
En effet, l’enjeu principal n’est peut-être pas tant une non-adhésion massive au dispositif que la réaction des « perdants » du nouveau système. Actuellement, la pénurie ne concerne pas tellement le nombre de places scolaires, mais plutôt celui des places perçues comme de qualité, massivement captées par les familles à haut capital culturel et social.
L’évaluation parentale de la composition d’une école repose souvent davantage sur des indicateurs visibles, comme la composition ethnique perçue, que sur des indices socio-économiques abstraits.
Cette qualité perçue est, pour une part non négligeable, liée à la mixité ou « composition » scolaire (le niveau général des élèves) plus encore qu’à la seule composition sociale. Toute modification de cette composition via une mixité accrue sera donc scrutée de près. Si, avec la proposition de l’APED, les parents de milieux défavorisés acceptaient massivement l’école proposée, « bloquant » ces places, ceux des milieux favorisés assignés à des écoles dont la composition scolaire leur semblerait dégradée pourraient se retrouver sans les options de choix qu’ils espéraient, celles-ci étant déjà prises. La contestation la plus vive viendrait alors de ceux dont le privilège d’accès aux bastions de l’entre-soi des milieux privilégiés serait remis en cause.
Valeur scolaire, motivation première
Cette approche sous-estime aussi la forte valorisation du principe de choix par les familles, qui pourraient percevoir une telle réforme comme une intrusion étatique et une diminution de leur rôle parental. Un autre postulat risqué consiste à croire que la composition sociale est le critère prédominant dans le choix d’une école, ce qui reste à démontrer et néglige d’autres facteurs essentiels tels que le projet éducatif, la dimension pédagogique, la réputation du quartier d’implantation (souvent liée à la ségrégation résidentielle) ou encore l’importance des réseaux d’enseignement.2 Comment, par exemple, un système centralisé prendrait-il en compte les choix légitimes de parents pour des écoles confessionnelles, des pédagogies alternatives spécifiques (Steiner, Freinet, Decroly…), ou l’immersion linguistique ?
Le critère déterminant pour les parents reste la qualité globale de l’école, largement médiatisée par sa réputation.
Mais au-delà de ces préférences, souvent citées, mais parfois minoritaires, le critère déterminant reste la qualité globale de l’école, largement médiatisée par sa réputation. Cette qualité repose sur des éléments très concrets : le niveau pédagogique réel, la qualification et la stabilité des équipes enseignantes, ou encore l’état des infrastructures. Or, et c’est un point crucial que la proposition de l’APED néglige, le service éducatif est, par nature, co-produit par ses usagers.3 Cela signifie que cette « qualité » est intimement liée à la composition sociale, mais surtout à la composition scolaire de l’établissement, c’est-à-dire au niveau académique moyen des élèves (Duru-Bellat, 2003). Les « bons élèves » (quel que soit leur milieu social d’origine) créent un environnement d’apprentissage stimulant et tirent le niveau d’une classe vers le haut. Bien que souvent corrélées, la composition sociale et la composition scolaire ne se superposent pas. Il existe des élèves de milieux populaires très performants et inversement. Les parents, notamment ceux des milieux privilégiés, en sont souvent conscients. Ils peuvent même valoriser une certaine mixité sociale, à condition que la présence d’élèves issus d’autres milieux ne soit pas perçue comme une menace pour le niveau scolaire global de l’école et, par conséquent, pour la réussite de leur propre enfant (Ball et al., 2004 ; van Zanten, 2009). L’enjeu pour eux est moins l’origine sociale des camarades de classe que leur « valeur scolaire » et leur capacité à contribuer à un environnement d’apprentissage sécurisé et exigeant.
L’enjeu pour les parents est moins l’origine sociale des camarades de classe que leur « valeur scolaire » et leur capacité à contribuer à un environnement d’apprentissage sécurisé et exigeant.
On le voit, la théorie de l’action qui sous-tend la proposition de l’APED mériterait une discussion approfondie, à la lumière des travaux existants sur les motivations des parents en matière de choix scolaire (Deceuninck et al., 2020). Dans ce contexte, proposer une réforme d’ampleur sans une compréhension fine des logiques d’action des différents milieux sociaux en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) semble prématuré.
L’idée qu’il suffirait d’informer les parents des avantages de la mixité et de la proximité pour emporter leur adhésion apparaît naïve.
De plus, l’idée qu’il suffirait d’informer les parents des avantages de la mixité et de la proximité pour emporter leur adhésion apparaît naïve. Si la proposition de l’APED considère pertinemment les liens entre marché scolaire, ségrégation et inégalités, elle omet l’analyse des travaux de recherche portant sur la mise en œuvre des réformes et les résistances rencontrées sur le terrain (Dupriez, 2015). Ignorer ces aspects conduit à une approche que l’on pourrait qualifier de positiviste ou d’« ingénierie sociale », où la simple accumulation de preuves scientifiques suffirait à engendrer le changement.4
Or, le marché scolaire ne se limite pas à produire de la ségrégation ; il génère également de la différenciation entre écoles. Ainsi, des « niches », des « écoles spécialisées » dans l’accueil de certains types de publics se forment.5 L’idée répandue d’un adéquation nécessaire entre l’enfant et son école, ainsi que la perception par les acteurs scolaires que cela fait partie de leur rôle (maintenir une congruence entre leur public et leur projet spécifique), témoignent de cette réalité historique et profondément ancrée. Le problème majeur perçu sur le terrain est souvent moins le marché que l’hétérogénéité scolaire elle-même, ce qui nécessite une réflexion du point de vue des acteurs scolaires et un travail sur les représentations et les pratiques pour démontrer les bénéfices de la mixité.
Un tel système impactera les stratégies résidentielles et la ségrégation urbaine, puisque les familles aisées pourraient se permettre de déménager pour contourner une affectation non désirée.
Les difficultés rencontrées par l’actuel décret et ses moutures successives, pourtant superficielle, devraient inciter à la prudence quant aux réactions qu’un projet aussi ambitieux ne manquera pas de susciter. De plus, l’hypothèse d’une diffusion automatique de la mixité du primaire vers le secondaire est discutable, tant les enjeux et les motivations des parents évoluent avec le niveau scolaire, avec une recherche d’« entre-soi » plus marquée au secondaire. Enfin, il est crucial de s’interroger sur les potentiels effets pervers d’un tel système. Il impactera certainement les stratégies résidentielles et la ségrégation urbaine, puisque les familles aisées pourraient se permettre de déménager pour contourner une affectation non désirée. D’autres stratégies d’évitement (recours au privé, scolarisation hors région ou dans le réseau flamand) existent et seraient probablement mobilisées, renforçant les inégalités, car moins accessibles aux familles défavorisées. Peut-on vraiment raisonner à distribution résidentielle inchangée ?
Pour une mixité mieux anticipée
Concernant les arguments en faveur de la mixité, il convient de souligner qu’elle peut être défendue au nom d’un principe de justice, indépendamment de ses effets concrets. Cependant, le postulat selon lequel la mixité scolaire est intrinsèquement et automatiquement bénéfique pour les performances et la socialisation mérite une approche plus nuancée. Des travaux, notamment anglo-saxons sur les effets psychosociaux (particulièrement de la mixité ethnique), invitent de longue date à la prudence : une mixité décrétée, sans réflexion approfondie sur ses conditions de déploiement au sein des micro-sociétés que sont les écoles, pourrait paradoxalement renforcer les préjugés et les discriminations au lieu de les réduire.6
Le principal apport de cette proposition de l’APED est de prouver qu’une alternative au système actuel est techniquement concevable.
La proposition de l’APED offre une démonstration technique impressionnante et constitue une base de discussion précieuse pour repenser la lutte contre la ségrégation scolaire. Son principal apport est de prouver qu’une alternative au système actuel est techniquement concevable.
Toutefois, le passage de cette théorie à la pratique soulève d’importantes questions d’ordre sociologique : la complexité des choix parentaux, le poids des représentations sociales et des réseaux, la question centrale de la qualité scolaire et des conditions matérielles d’accueil, les stratégies d’adaptation des acteurs (niches scolaires), l’inertie des habitudes institutionnelles ou encore les risques d’effets pervers .
Reconnaître ces défis n’invalide pas l’objectif poursuivi, bien au contraire. Cela souligne plutôt qu’une réforme ambitieuse, pour avoir une chance d’atteindre ses buts louables de mixité et d’équité, ne peut se contenter d’une ingénierie technique, aussi sophistiquée soit-elle. Elle exige une compréhension fine des mécanismes sociaux à l’œuvre et une prise en compte rigoureuse des conditions humaines, culturelles et contextuelles de sa mise en œuvre, notamment les conditions matérielles qui favoriseraient l’adhésion du plus grand nombre, afin d’anticiper les obstacles et de construire des solutions véritablement adaptées et acceptées.