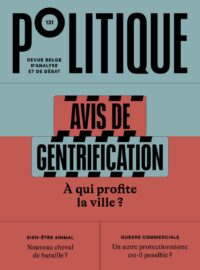Société
Entretien. Peut-on revitaliser sans exclure ?
13.11.2025

Longtemps, Charleroi a rimé avec déclin. Le centre-ville s’est peu à peu vidé, laissant place à la paupérisation. Toutefois, depuis une dizaine d’années, la ville s’est engagée dans une profonde métamorphose : redéploiement urbain ou gentrification déguisée ? Pour interroger les choix politiques qui sous-tendent à ces dynamiques, rencontre avec le bouwmeester de Charleroi, qui revient sur le rôle de l’architecture dans les dynamiques sociales et sur une décennie passée à redessiner le cœur du Pays Noir.
Quelle est l’histoire urbaine de Charleroi ?
Charleroi s’est construite par grandes étapes, chacune marquée par une vision territoriale différente. À sa création, en 1666, la ville était avant tout une forteresse : une vision militaire. Au début du XIXe siècle, elle entre dans une phase industrielle avec l’essor des charbonnages et des manufactures. Puis, vers 1860, on élabore ce qu’on pourrait appeler le premier masterplan, pour organiser l’urbanisation et accueillir les nouveaux travailleurs et travailleuses. Après la fermeture des charbon nages, dans les années 1970, c’est une vision plus régionaliste qui domine : on développe les infrastructures routières pour relier Charleroi à sa périphérie et aux autres grandes villes du pays. Et depuis 2012, nous sommes entrés dans une nouvelle phase, celle d’une vision métropolitaine, celle d’une ville qui se repense à l’échelle de tout son bassin de vie et en relation avec les grandes villes européennes.
Bouwmeester signifie « maître architecte » en néerlandais. Pouvez-vous nous expliquer quelle est cette fonction ?
La fonction de bouwmeester consiste à veiller à la qualité architecturale et urbaine des projets portés par la ville. C’est à la fois une mission de conseil, de coordination et de garantie de cohérence entre les différentes politiques d’aménagement. L’objectif, c’est de créer du tissu urbain, de la continuité et du sens dans la manière dont la ville se transforme.
Notre action dépend de la volonté des élu·es : elle peut être soutenue, mais aussi remise en cause à tout moment.
J’ai souvent eu ce débat avec d’autres bouwmeesters qui n’en ont pas forcément la même lecture, mais, pour moi, c’est une fonction éminemment politique. Notre action dépend de la volonté des élu·es : elle peut être soutenue, mais aussi remise en cause à tout moment. On le voit très bien à Bruxelles, où l’absence de coalition bloque aujourd’hui une grande partie du développement urbain.
Comment êtes-vous arrivé à ce poste ?
En 2013, la ville de Charleroi a lancé un marché pour désigner un bouwmeester, comme à Anvers ou à Bruxelles. C’était sous l’ère de Paul Magnette et c’est important de le rappeler, car c’est lui qui a eu l’initiative de créer cette fonction, restée depuis unique en Wallonie.
Lorsque vous êtes arrivé, quelle était la situation ?
Quand on arrive aux commandes, on hérite d’une ville dysfonctionnelle, presque à terre. Un territoire à genoux, sans horizon. Il n’y avait plus d’espoir, plus de vision urbaine, plus de vision politique de ce que devait être Charleroi. La ville sortait d’une succession de crises : une crise industrielle avec le déclin des charbonnages, une crise politique marquée par des scandales comme « la Carolo » et une crise sociale et culturelle profonde après l’affaire Dutroux.
Au niveau socioéconomique, quelle était la situation du centre-ville ?
À l’époque, le problème majeur, c’était l’exode. Un départ massif et continu depuis plusieurs décennies. Les cerveaux partaient, les commerçant·es fermaient, les travailleurs et travailleuses s’en allaient et, surtout, les habitant·es quittaient la ville. Charleroi s’appauvrissait, économiquement et socialement, à un rythme alarmant. Notre priorité, c’était de redonner aux Carolos la ville qu’ils et elles méritent. Une ville, c’est une multiplicité d’expériences concentrées dans l’espace et dans le temps.
Le cœur de notre projet, c’était de réconcilier les habitant·es avec leur propre ville.
Les gens doivent pouvoir y vivre pleinement : travailler ici, étudier ici, aller au théâtre, dans un musée, dans un bon restaurant… Bref, vivre la ville dans toutes ses dimensions. Quand on paie des impôts, il est légitime d’attendre un cadre de vie agréable. C’était ça, le cœur de notre projet : réconcilier les habitant·es avec leur propre ville.
Quelles ont été vos priorités ?
La première chose qu’on s’est dite, c’est qu’on avait un vrai problème d’image et d’identité. Les habitant·es et les commerces avaient déserté le centre-ville pour s’installer dans des zonings périphériques. Toutes les fonctions urbaines s’étaient déplacées en dehors de la ville. Nous avons donc repris l’ensemble des projets hérités du passé et nous les avons réinscrits dans une nouvelle vision : une politique urbaine centrée sur la rénovation du cœur de ville et le retour des grandes fonctions métropolitaines.
Le bouwmeester, ce n’est pas une personne, c’est une équipe, qui marque des buts.
L’idée, c’était de ramener dans le centre les activités qui s’étaient éparpillées en périphérie, pour redonner à Charleroi un véritable cœur battant, un centre métropolitain. C’était précisément la mission principale de la cellule bouwmeester : développer cette vision métropolitaine à travers une série de projets cohérents et fédérateurs. Paul Magnette, à l’époque, avait bien compris l’intérêt d’une telle cellule, qui avait déjà fait ses preuves dans plusieurs grandes villes flamandes. Le travail s’est donc structuré autour de la notion de projet – une approche chère aux architectes. Et j’y tiens beaucoup : le bouwmeester, ce n’est pas une personne, c’est une équipe, qui marque des buts. C’est cette équipe qui a permis à Charleroi de se doter d’une vision urbaine ambitieuse et métropolitaine.
Et comment « marquer des buts » ?
Très vite, en faisant la liste des pro jets à venir, nous avons compris que la construction « matérielle » de la vision prendrait du temps, plus de dix ans. Mais les Carolos n’avaient plus envie d’attendre. Ils et elles avaient besoin de signes visibles, de preuves que la ville se relevait. Il fallait donc faire aboutir des projets rapidement. Nous avons lancé plusieurs types de chantiers en parallèle. D’abord, un travail sur l’image et l’identité : redonner une fierté, une cohérence visuelle, une histoire commune. Ensuite, une restructuration événementielle, en phase avec cette nouvelle image.
L’idée était simple : que les habitant·es revivent leur ville, qu’ils et elles reviennent y participer, y célébrer, y croire à nouveau. À l’époque, les Carolos préféraient aller à Namur, Mons ou Bruxelles pour leurs activités de fin d’année. Le village de Noël de 2012-2013, par exemple, était désert. Il fallait réanimer Charleroi à travers ce qu’elle proposait. Et pendant ce temps, en parallèle, nous avancions sur la vision architecturale et urbaine de la ville, celle qui prend du temps, mais qui inscrit durablement le changement dans le territoire.
Comment prioriser parmi tous ces objectifs ?
Nous avons élaboré une stratégie métropolitaine ambitieuse, composée de centaines de projets. La grande majorité a abouti. Je le dis avec humilité, mais ce qui a été accompli à Charleroi est, objectivement, phénoménal. On entend souvent les cabinets de consultance dire « attention, il faut prioriser » ou « voici la recette pour réussir ». Mais en 2012, tout était prioritaire ! La ville était à terre. Si nous n’avions pas tout pris en main en même temps, nous n’aurions rien redressé du tout. C’était du sept jours sur sept, sans pause. Notre méthode, c’était justement de ne pas appliquer de recette. De construire une vision à partir de l’existant, avec les forces vives du territoire. De créer notre propre trajectoire, sans copier-coller ce qui avait fonctionné ailleurs et qui n’aurait aucun sens ici. Nous devions travailler sur nous-mêmes avec beaucoup de discernement.
Si je devais employer une image footballistique, je dirais que nous avons mené une attaque ambitieuse et volontariste. Bien sûr, tout n’a pas été parfait. Mais nous avons mis une énergie considérable dans cette ville pour la trans former et qu’elle devienne ce qu’elle est aujourd’hui : le nouveau Charleroi.
Où avez-vous trouvé l’argent ?
Nous avons réussi à attirer près de trois milliards d’euros d’investissements, dont un milliard et demi rien que pour le centre-ville. C’est considérable. Il y a eu des investissements publics, bien sûr, mais aussi privés – et c’est ce mélange qui a redonné de l’activité. Les citoyen·nes, ce ne sont pas des Sims dans SimCity. On ne les déplace pas à volonté. Ils et elles reviennent quand il y a la confiance, quand ils et elles sentent que la ville se reconstruit avec sincérité et cohérence. Il a fallu les convaincre, pas par des slogans, mais par des actes. Nous avons semé petit à petit, projet après projet. Et aujourd’hui, on le voit : la population recommence à croître.
Il a fallu convaincre les citoyen·nes, par par des slogans, mais par des actes.
Charleroi redevient une ville où l’on a envie de vivre. 3 milliards, c’est beaucoup et, en même temps, c’est peu. C’est moins que le prix du Métro 3 à Bruxelles.
Vous êtes les premiers à me dire que ce n’est pas beaucoup ! D’habitude, quand j’annonce trois milliards, ça impressionne. Mais vous avez raison : au regard de tout ce qui a été réalisé, c’est finalement assez peu. Nous avons énormément rationalisé les moyens disponibles, et les chiffres réels sont sans doute encore plus élevés.
Vous avez beaucoup piétonnisé. Était-ce important pour vous ?
Oui, nous avons piétonnisé le boulevard Tirou et les quais. Mais la piétonnisation, ce n’est pas une fin en soi. Derrière, il faut un vrai projet, sinon ça ne prend pas. On l’a vu avec la rue de la Montagne : nous avons dû la rouvrir à la circulation après un certain temps, faute d’adhésion. Quand vous êtes dans un espace public occupé par des véhicules d’une tonne, vous ne pouvez pas vraiment vous sentir bien ni en sécurité. La voiture en ville ne pollue pas seulement l’air : elle génère aussi une pollution sonore, visuelle, spatiale. Si l’on veut recréer un cadre de vie agréable, il faut libérer de l’espace et reléguer les véhicules en périphérie. Et, honnêtement, ça fait du bien à tout le monde. Évidemment, cela ne veut pas dire supprimer les voitures ou les parkings.
Veut-on vraiment continuer à penser la ville comme un endroit où l’on ne marche plus, où l’on ne respire plus ?
Mais quand j’entends certaines critiques sur la piétonnisation, je me demande où est le vrai débat. Est-ce qu’on veut vraiment continuer à penser la ville comme un endroit où l’on ne marche plus, où l’on ne respire plus ? Si on dégrade la qualité de vie en ville, les gens continueront à fuir vers la campagne pour retrouver du temps et de l’espace de qualité. L’expérience urbaine ne peut être positive que si elle est vécue dans un cadre apaisé, sûr et accueillant. Pour moi, le meilleur indicateur de cette qualité de vie, ce sont les enfants. Si vous avez peur de laisser votre enfant jouer dans le centre-ville, c’est qu’il y a un problème.
Récemment, le nouveau bourgmestre de la ville, Thomas Dermine, a décidé de rouvrir le bord des quais aux voitures. Qu’avez-vous à dire de cela ?
Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. C’est lui le bourgmestre et j’imagine qu’il sait ce qu’il fait. Il en prendra la responsabilité politique, en bien ou en mal…
Que répondez-vous aux critiques qui disent que vous avez gentrifié la ville ?
Je ne trouve pas cohérent de parler de gentrification à propos de ce que nous avons fait à Charleroi. Le projet prioritaire n’était pas d’attirer de nouvelles personnes, mais de prendre soin de celles qui sont là. De leur redonner une ville où il fait bon vivre, où elles se sentent considérées. Les Carolos méritent des espaces publics de qualité : des lieux où l’on peut se rencontrer, marcher, lire un livre, boire un café, simplement être bien. C’est pour cela que nous avons concentré nos efforts sur les espaces extérieurs – parce qu’ils touchent tout le monde.
Pour vous, qu’est-ce que la gentrification ?
Pour moi, la gentrification consiste à concevoir des projets pensés pour une certaine classe sociale. Or, à Charleroi, nous n’avons pas travaillé pour un public particulier, mais pour tout le monde. Ce serait de la gentrification si cette intention avait existé dès le départ, ce n’était pas le cas. Notre démarche était d’améliorer la qualité de vie collective, pas de la réserver à quelques-un·es. Parler du projet carolo en termes de gentrification me semble relever davantage d’une lecture idéologique que d’une analyse de terrain. Cela ne correspond ni à l’esprit du travail accompli ni à la réalité sociale de Charleroi.
Notre démarche était d’améliorer la qualité de vie collective, pas de la réserver à quelques-un·es.
Certain·es pointent du doigt notamment le café « Quai 10 » sur le bord des quais, qui serait le symbole d’une volonté d’embourgeoisement du quartier.
Je ne comprends pas cette critique. Gentrifier, c’est transformer un quartier entier en espace réservé à une certaine classe sociale, en quelque sorte un ghetto de riches. Ce n’est clairement pas ce que nous avons fait ici. Le Quai 10 est un lieu ouvert à tous et toutes. On peut y aller boire un café, voir un film, manger une pâte à la brasserie. N’importe qui peut y accéder, et les prix sont les mêmes qu’ailleurs. C’est justement un espace public dans l’esprit carolo : accessible, convivial et vivant.
Propos recueillis par Anaïs De Munck