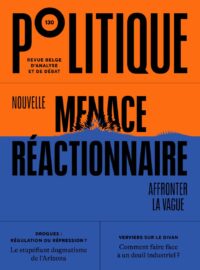Société
« Fake news ! » La politique contre les faits
10.10.2025

Depuis le Brexit et l’élection de Donald Trump, les algorithmes et la « désinformation » hantent le débat public. Cause ultime de droitisation ? Ce diagnostic est cependant peu convaincant, tant il repose sur une lecture technocratique du combat politique, malheureusement répandue à gauche.
Quelques jours après l’inauguration du second mandat présidentiel de M. Donald Trump sous le regard bienveillant des oligarques de la Silicon Valley, le pape François alertait contre la « désinformation ». « Trop souvent, notait alors le souverain pontife, la communication simplifie la réalité pour provoquer des réactions instinctives »1. Si l’on ne peut s’empêcher d’esquisser un sourire a l’idée que l’Église catholique parte en guerre contre les « fausses informations », le diagnostic prononcé par le représentant terrestre de l’homme ayant transformé l’eau en vin n’en est pas moins partagé par de larges franges du monde intellectuel et médiatique. Depuis la victoire du Brexit, les livres et publications à propos d’une « épidémie de désinformation » et de l’avènement de la « post-vérité » ont colonisé les étalages des librairies. Pourtant, malgré l’immense prolifération de titres accrocheurs sur le sujet, la thèse reste, à quelques variations près, toujours la même.
Malgré l’immense prolifération de titres accrocheurs sur la désinformation et la post-vérité, la thèse reste toujours la même.
Pour Lee Mckintyre, auteur du bestseller Post-vérité, l’origine du fléau est ancienne, « encodée dans notre cerveau au cours de l’évolution humaine : le biais cognitif »2 Dans la nouvelle économie de l’information médiée par les algorithmes, ces biais auraient eu raison des « faits » en faveur des « fake news ». Happés par des plateformes valorisant l’attention et les likes, les individus seraient désormais exposés à une information et des interactions favorisant des communautés de semblables plutôt que le débat démocratique. La sphère publique se serait par conséquent délitée en d’innombrables « tribus » autoréférentielles. Les académiques sur Bluesky et les influenceurs et influenceuses d’extrême droite sur X. À chaque sensibilité sa chaine YouTube et ses comptes Instagram. Le résultat étant, pour reprendre les termes de Jonathan Rauch, « un repli accru dans des bulles de personnes partageant les mêmes idées, créant davantage de distance et de méfiance, et favorisant une polarisation accrue ».3
Problème d’idéologie ou d’information ?
Dans cette nouvelle configuration du savoir, la capacité de s’écouter mutuellement et de résoudre des conflits par le biais de la raison laisserait lente ment place à une guerre civile numérique nourrie par l’agenda politique de quelques milliardaires. La principale victime de cette transformation de la sphère publique ne serait autre que la vérité elle-même. Ou, pour être plus précis, notre capacité à distinguer le vrai du faux. Enfermés dans des bulles sociales nourries par nos biais cognitifs, la distinction entre faits et opinions se serait lentement affaissée.4 La compétition électorale se calque alors sur la sphère numérique et récompense celles et ceux ayant le moins d’égards pour les faits.5
Dans ce contexte, le problème ne serait plus celui d’une compétition entre projets politiques relativement cohérents, mais celui des modalités de circulation de la connaissance. Comme l’écrit le journaliste américain Matt Taibbi, la politique a « cessé de porter sur l’idéologie et est de venue un problème d’information ».6 Ce ne sont plus des idées qui sont en compétition, mais les faits eux-mêmes, mis au service d’entrepreneurs et entrepreneuses politiques vendant leurs opinions sur le marché de la compétition électorale. Ils sont désormais jugés sur leur capacité à capter l’attention sur les plateformes numériques, les « likes » ayant remplacé la déontologie journalistique. Cette profonde transformation de la sphère publique ayant pour conséquence directe la délégitimation des institutions (journalistes, universitaires, experts, juges, etc.) qui autrefois arbitraient de la validité des discours dans l’arène politique. On pourrait décrire la dynamique politique présente comme résultant d’une désintermédiation de la production et diffusion de la connaissance. L’arrivée des réseaux sociaux ayant bouleversé les modalités de constitution de l’information, sapant par la même occasion la séparation entre sphère publique et privée.7 Désormais chacun peut, depuis son ordinateur, délivré de toute norme déontologique ou scientifique, livrer son propre regard sur le monde et sur les « faits ».
Les effets de la désinformation sur les dynamiques politiques contemporaines sont largement extrapolés.
Si cette interprétation (et ses variantes) recèle une part de vérité, elle n’en reste pas moins très insatisfaisante. Tout d’abord, elle extrapole largement les effets de la désinformation sur les dynamiques politiques contemporaines. Il est intéressant de noter qu’il y a peu d’éléments permettant d’établir que la désinformation ait été un élément décisif dans l’élection de Donald Trump en 2016. Comme le note une étude publiée dans la prestigieuse revue Nature, les articles sur des sites peu fiables ont représenté 5,9 % des visites des citoyens américains sur des sites d’information dans le cadre de l’élection présidentielle. Et, ajoute l’étude, lorsqu’on élargit les don nées pour y inclure la télévision, les sites de fausses informations ne représente raient « que 0,1 % du régime médiatique des citoyens américains ».8 Enfin, comme le note une autre étude, la consommation de ces informations fut très concentrée sur un groupe restreint d’électeurs et électrices ayant déjà des opinions relativement extrêmes. Ainsi, sur Twitter, 1 % des utilisateurs et utilisatrices représentaient 80 % des expositions aux sources de fausses informations.9 Si ces chiffres ne sont bien entendu pas négligeables et constituent une dynamique (croissante) qui peut légitimement inquiéter, il n’en reste pas moins qu’ils sont très insuffisants pour expliquer les profondes transformations des dix dernières années.
Les algorithmes et les biais cognitifs à eux seuls rendent difficilement compte du succès spécifique de l’extrême droite au cours de la dernière décennie.
En réalité, l’attrait d’une telle explication semble d’avantage trahir les idées politiques de ses promoteurs et promotrices. L’impensé de la majorité de la littérature sur la « désinformation » étant que si les individus avaient reçu de « bonnes » informations, le Brexit n’aurait pas eu lieu et Donald Trump n’aurait été qu’un mauvais souvenir. En portant le débat sur les « faits », cette littérature part du principe qu’une personne bien informée ne pourrait être en faveur de la sortie de l’Union Européenne. Tout sortie du cadre dans lequel a opéré la classe politique depuis 30 ans est à chercher dans une méconnaissance de la vérité et non dans un combat politique. Reformulé en ces termes, il n’est pas difficile de percevoir les limites de l’argument. Non seulement il est peu plausible que les partisans de candidats plus classiques soient d’avantage guidés par leur raison, mais en s’appuyant sur des modèles psychologisants, on peine à expliquer pourquoi certains mensonges seraient plus porteurs que d’autres. En effet, les algorithmes et les biais cognitifs à eux seuls rendent difficilement compte du succès spécifique de l’extrême droite au cours de la dernière décennie.
Ce n’est pas les algorithmes et nos biais cognitifs qui sapent la légitimité des institutions, mais c’est dans leur déclin que prospèrent des aspirations radicales au changement.
Pour saisir une telle transformation, il est nécessaire de replacer ces transformations dans leur dynamique socio-historique. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, auquel il avait participé en tant que sergent d’infanterie, l’historien français Marc Bloch s’était penché sur la genèse et la diffusion des « fausses nouvelles » ayant nourri le conflit. Si nous sommes spontanément portés à nous « tourner vers les laboratoires des psychologues », cette approche lui semblait pourtant très insuffisante. « L’erreur ne se propage, ne s’amplifie » écrit alors le fondateur de l’école des annales, « qu’à une condition : trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable ».10 Cette perspective doit par conséquent nous amener à inverser les termes de l’explication. Ce n’est pas les algorithmes et nos biais cognitifs qui sapent la légitimité des institutions, mais c’est bien dans leur déclin que prospèrent des aspirations radicales au changement. Celles-ci génèrent cependant moins un dédain vis-à-vis de la vérité, qu’une quête renforcée pour l’établir. Dans l’incapacité de faire confiance aux scientifiques ou experts mandatés de tout genre, les opinions des individus re posent de plus en plus sur une recherche personnelle.
À défaut de faire confiance aux autorités compétentes, les sceptiques déplacent simplement cette confiance vers d’autres acteurs et actrices.
Pour le dire autrement, lorsque vous pensez que le 11 septembre a été un complot organisé par le gouvernement, il est probable que vous ayez investi une partie importante de votre temps à lire toute sortes d’articles afin de déterminer, par vous-même, les faits. Bien entendu, sauf à devenir soi-même expert dans des domaines souvent très techniques, cette ambition est naturellement vouée à l’échec. À défaut de faire confiance aux autorités compétentes, les sceptiques déplacent simplement cette confiance vers d’autres acteurs et actrices (des influenceurs et influenceuses, des bloggeurs et bloggeuses, etc.). Notre présent est donc, en quelque sorte, pour citer le politologue Henrik Enroth, moins caractérisé par « une cessation de la recherche de preuves, mais [par] une recherche pathologique de celles-ci ».11 En d’autres termes, dans une société de plus en plus désintermédiée, où les individus ne sont plus membres de partis politiques, de syndicats ou d’associations, notre attitude vis-à-vis de la « vérité » s’individualise. En ce sens, les algorithmes viennent occuper le vide laissé par le déclin de l’encadrement politique et social des individus plutôt que d’en être la source.
Primat de l’expertise
Les causes de ce déclin sont complexes et s’inscrivent dans une dynamique qui s’est enclenchée dès les années 1980. Elles relèvent de transformations sociologiques profondes ayant amplifié l’individualisation et l’atomisation de la société, mais également de déceptions politiques à répétition. Le sentiment, au cours des 30 dernières années, qu’il n’y a pas de réelle alternative au libéralisme économique et que la sphère politique est impuissante face aux dynamiques globales, a accéléré la méfiance vis-à vis de ses représentants et du discours qu’ils portent. On pourrait également faire l’hypothèse que dans cette « fin de l’histoire » très technocratique, la prolifération d’experts médiatiques au tournant des années 2000, présentant leurs opinions comme la simple énonciation des faits, a largement contribué au discrédit d’une certaine forme de régulation des discours. À défaut de mener les débats sur le terrain de la politique, c’est la science elle-même qui se voit remise en question. Il n’est évidemment pas ici question de rejeter toute forme d’expertise, mais la place importante qu’elle a prise au sein du libéralisme comme substitut à la politique a semblé être davantage un problème qu’une solution.
Trump, Meloni ou Orban sont des marchands d’idéologie dans un monde de moins en moins en phase avec de la fin de l’histoire.
C’est par conséquent dans ce discrédit que naît le besoin d’autres théories pour faire sens du réel. En un sens, à l’opposé des avocats de la « crise épistémologique », la bataille des faits n’a pas remplacé celle des idées. Au fond, Trump, Meloni ou Orban sont des marchands d’idéologie dans un monde de moins en moins en phase avec de la fin de l’histoire. Leur succès renvoie moins à la crise d’une modalité de constituer la vérité qu’à celle du libéralisme lui-même et à sa capacité à imposer un narratif en phase avec l’expérience immédiate des individus. Pour des raisons tant politiques que sociologiques, les trois composantes centrales du néolibéralisme portées à différentes intensités tant par la gauche que la droite – contractualisation de sphères toujours croissantes de la vie sociale, soustraction des décisions économiques au contrôle démocratique et libre mobilité du travail et du capital – sont l’objet d’une défiance croissante.
Depuis la crise économique de 2008, tant à droite qu’à gauche, se sont cristallisées des réponses plus ou moins cohérentes visant à rencontrer politiquement cette désaffection. La gauche a focalisé son agenda sur les inégalités et le déclin de la puissance publique adossé à une critique relativement abstraite et peu claire de la globalisation. L’extrême droite s’est naturellement focalisée sur une critique moins ambitieuse de la mobilité du travail et du capital tout en offrant une réponse conservatrice aux effets de la commercialisation de la vie sociale. Plutôt qu’une politique publique expansive, elle propose alors la réaffirmation des valeurs familiales traditionnelles et de normes morales perçues comme autant de remparts à une libéralisation des mœurs qui aurait miné notre « mode de vie ». En d’autres termes, d’un côté une réaffirmation de la puissance publique au nom du commun et de l’autre, une limitation de l’immigration et des déséquilibres commerciaux au nom de la sauvegarde de « l’identité nationale ».
Giorgia Meloni peut se maintenir au pouvoir sans avoir réellement altéré les dynamiques économiques, tant qu’elle met en spectacle des actions symboliques fortes en matière migratoire ou culturelle.
Si l’option de gauche a dominé la séquence électorale faisant suite à la crise de 2008, elle a désormais cédé le terrain à celle d’extrême droite. Les raisons de cet échec sont complexes, mais on peut néanmoins noter qu’une transformation profonde de notre système économique s’expose à des contraintes politiques et institutionnelles beaucoup plus grandes qu’un discours xénophobe et une défense abstraite de l’identité. En un sens, la présidente du conseil italien Giorgia Meloni peut se maintenir au pouvoir sans avoir réellement altéré les dynamiques économiques pour autant qu’elle mette en spectacle des actions symboliques fortes en matière migratoire ou culturelle. Cela n’implique bien entendu pas qu’il s’agisse d’options cohérentes, rationnelles ou souhaitables, mais elles proposent un autre cadre pour interpréter son propre désarroi. Et si les obstacles à une solution progressiste sont effectivement plus grands, il n’en reste pas moins qu’aucun appel aux « faits », à « l’expertise » ou à la « raison » ne constitue une réponse aux dynamiques actuelles. Aucun retour à la normale ne se profile à l’horizon et la seule victoire possible vis-à-vis de l’extrême droite se situe sur le terrain idéologique. C’est à la gauche et non aux « faits » d’offrir une alternative. Mais pour cela, il est d’abord nécessaire d’accepter que la politique ne soit pas une affaire de raison, mais un combat plus fondamental à propos des normes sociales à même de nous gouverner.
Depuis la victoire du Brexit, les livres et publications à propos d’une « épidémie de désinformation » et de l’avènement de la « post-vérité » ont colonisé les étalages des librairies.
En s’appuyant sur des modèles psychologisants, on peine à expliquer pourquoi certains mensonges seraient plus porteurs que d’autres. Ce n’est pas les algorithmes et nos biais cognitifs qui sapent la légitimité des institutions, mais c’est bien dans leur déclin que prospèrent des aspirations radicales au change ment. À défaut de mener les débats sur le terrain de la politique, c’est la science elle-même qui se voit remise en question.