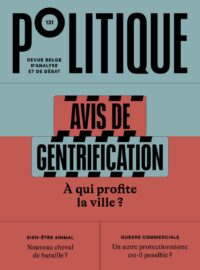Logement
Gentrification : le vernis urbain d’une violence sociale
13.11.2025

Géographe de formation, Sarah de Laet milite contre les expulsions et sillonne aujourd’hui les scènes avec une conférence gesticulée percutante, à travers son parcours résidentiel. La gentrification n’est pas un simple phénomène urbain, mais un véritable processus violent d’exclusion sociale, soutenu par des politiques publiques qui favorisent l’individualisme libéral aux solidarités populaires. Derrière ces façades rénovées et ces quartiers « revitalisés », les plus défavorisé·es sont poussé·es hors de la ville. Entretien avec une géographe qui refuse de voir la ville devenir un espace réservé aux riches.
Quel est votre parcours et quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes intéressée à la question de la gentrification ?
J’ai fait des études de géographie à l’ULB avant de commencer une thèse sur l’une des conséquences de la gentrification avec comme directeur de recherche Mathieu Van Criekingen, en particulier après avoir lu son article « Que deviennent les quartiers centraux à Bruxelles ? »1
Ayant grandi à Bruxelles dans la commune d’Ixelles où je ne pourrais plus habiter aujourd’hui, compte tenu de la hausse des loyers, la transformation de la place Flagey m’a sensibilisée à la question de la gentrification. J’ai travaillé dans le secteur associatif sur les questions de logement et la gentrification, en particulier dans la zone du canal vers la gare du Nord. Est arrivé le COVID, avec une augmentation de la précarité et des mesures absurdes comme les amendes aux personnes dans la rue.
Par la suite, j’ai rejoint le Front anti-expulsions en militant pour la suspension des loyers et des campagnes politiques contre les expulsions avec l’obtention de moratoires sur les expulsions pendant le COVID. Je travaille aujourd’hui dans le domaine de l’éducation permanente.
Pourquoi avoir utilisé la conférence gesticulée pour aborder la gentrification ?
Pour pouvoir en parler tout le temps et partout. J’avais l’impression que cela allait me permettre d’aller dans différents endroits et de tenir un discours long à un large public, sans passer par les réseaux sociaux ; une forme ludique pour faire passer un message. Tout le monde a une perception de ce qu’est la gentrification et des phénomènes qu’elle produit dans notre quotidien, avec un discours soit fataliste, soit très positif. Proposer un discours scientifique et politique demande une attention et une écoute toutes particulières ; la conférence gesticulée me semblait être le meilleur média, en particulier pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de lire des articles scientifiques, qui sont parfois assez compliqués à comprendre.
La conférence gesticulée me semblait être le meilleur média, surtout pour celles et ceux qui n’ont pas le temps de lire des articles scientifiques, parfois compliqués à comprendre.
Ayant un rapport pédagogique aux sciences humaines, je considère que produire du savoir qui n’est pas compréhensible ne sert à rien. On ne peut pas séparer l’action politique de la compréhension des processus à l’œuvre dans nos sociétés.
À qui profite la gentrification et quelle est son origine ?
David Harvey2 définit la gentrification comme un processus d’appropriation par dépossession, autrement dit la question « qui gagne ? Qui perd ? ». Quand des choses deviennent prescrites dans certains quartiers, d’autres sont proscrites. Je trouve que cette approche permet de lire à la fois la question de la revalorisation foncière, de l’augmentation des prix des loyers et à un certain niveau, la question des usages des espaces publics.
Quand des choses deviennent prescrites dans certains quartiers, d’autres sont proscrites.
Le rent gap (ou différentiel de rente), développé par le géographe Neil Smith, permet de penser ce processus. Deux stratégies non exclusives sont à l’œuvre. Premièrement, acheter un terrain où les prescriptions urbanistiques n’autorisent que la construction de petits immeubles ou des bâtiments avec des activités productives (stockage, ateliers), puis œuvrer auprès des services publics pour obtenir le droit de construire des bâtiments plus chers accueillant d’autres fonctions (bureau, logement). Deuxièmement, une autre stratégie mise sur la « revalorisation symbolique » du quartier, c’est-à-dire attendre d’un quartier qui avait une « mauvaise image » qu’il devienne « branché ». Les pouvoirs publics (parcours d’artistes, investissement dans une infrastructure culturelle, etc.), mais aussi les investisseurs privés (projet Manhattan à Bruxelles prévoyant la construction des tours WTC avec des logements de luxe) soutiennent cela.
La revalorisation symbolique est à double tranchant : les publics qui participent à l’initiation du processus sont aussi ceux qui sont éjectés des quartiers par la suite. Les étudiant·es et artistes : des groupes sociaux qui ont un fort capital culturel, mais de faibles moyens économiques.
Quelle est la différence entre gentrification et embourgeoisement ?
L’embourgeoisement ne concerne pas les quartiers populaires, mais des espaces déjà occupés par une population appartenant à la classe intermédiaire ; c’est un phénomène de renchérissement alors que la gentrification est un processus de transformation des quartiers populaires.
Si la classe intermédiaire se retrouve dans une double position : de dominante et de dominée, la classe ouvrière est toujours dans une position de dominée.
Ces deux processus évoluent ensemble : les quartiers bourgeois sont chers et non accessibles à certaines parties de la population, qui migrent alors vers les centres plus populaires, poussant les plus pauvres à se concentrer ailleurs dans la ville. Si la classe intermédiaire se retrouve dans une double position : de dominante (par rapport à la classe ouvrière) et de dominée (par rapport à la bourgeoisie), la classe ouvrière est toujours dans une position de dominée. Quelques ménages restent dans les centres anciennement populaires, mais vivent dans des conditions de plus en plus dégradées, insalubres.
Quel est le rôle des pouvoirs publics dans ce phénomène ?
Le tournant néo-libéral et la succession de plusieurs réformes en Belgique ont amené la création de la région Bruxelles-Capitale et, avec elle, la nécessité d’un autofinancement. La question devient alors : comment faire rentrer de l’argent ? Grâce à une assiette fiscale plus confortable et donc une des stratégies des majorités au pouvoir à l’époque est d’encourager et de soutenir le processus de gentrification. L’efficacité est relative, car la grande partie des ménages sont non fiscalisables (Commission européenne, étudiant·es en stage).
Ces quartiers sont des refuges, des espaces ressources avec ce que j’appelle de « petites ascensions sociales » où les communautés peuvent se retrouver dans des cafés, des marchés, etc. « Revitaliser » le quartier, cela sous-entend qu’il est mort. C’est simplement qu’il ne rentre pas dans les codes voulus et compris par les classes dominantes. Ma lecture de la politique urbanistique des villes, c’est une tyrannie des classes supérieures et des classes intermédiaires supérieures qui veulent que tout l’espace urbain leur ressemble.
« Revitaliser » le quartier, cela sous-entend qu’il est mort.
Durant quelques mois, j’ai travaillé pour l’administration publique et j’ai constaté que la classe intermédiaire supérieure, en charge des questions urbaines, se considère comme la norme. Ce qu’elle ne connaît pas ou ne voit n’a pas de valeur, seulement ce qu’elle désidérata. Je me suis retrouvée dans une discussion avec une chargée de projet sur une place de Molenbeek. L’analyse qu’elle portait sur cet espace était plus ou moins : « cette place est moche ; trop de voitures, trop de bruit, il faut faire quelque chose. » Elle négligeait la fonction que cet espace remplissait pour le quartier. Dans un article3, Mathieu Van Criekingen critique l’impasse rhé torique qui dit : « Si vous êtes contre la gentrification, vous êtes pour le pourrissement des quartiers. » Avec ce genre de discours, les pouvoirs publics se dédouanent de toutes les conséquences de la gentrification et amorcent la pompe de son accélération.
Certains événements internationaux attirent une population jeune et aisée, notamment grâce à l’exposition sur les réseaux sociaux des nouveaux lieux à la mode…
Tous les événements internationaux jouent un rôle, à travers leur médiatisation, dans l’accélération de la gentrification. Les jeux Olympiques de Paris ou le projet de faire de Molenbeek la « capitale européenne de la culture 2030 » fonctionnent comme des appels d’air pour attirer des capitaux et deviennent des prétextes pour les pouvoirs publics pour expulser les indésirables.
Installer l’annexe du centre Pompidou dans un quartier populaire ne traduit pas la volonté d’offrir la culture aux habitant·es, mais de revaloriser symboliquement un quartier populaire pour attirer des ménages à revenus plus élevés.
Avec les attentats, Molenbeek a subi une dévalorisation symbolique, ce qui a quelque part bénéficié aux pauvres qui n’ont pas vu leur loyer augmenter malgré la proximité du centre-ville. Puis tout un discours médiatique a construit la nécessité de l’action sur un espace, au nom de la sécurité et contre l’insalubrité. La volonté d’installer l’annexe du centre Pompidou dans un quartier populaire n’est pas d’offrir la culture aux habitant·es, mais de revaloriser symboliquement un quartier populaire dans l’optique d’attirer des ménages à revenus plus élevés.
Est-ce qu’il y a une dimension morale de la gentrification ?
Mathieu Van Criekingen fait une description et une analyse des mouvements de population et des rapports de privilège et de pouvoir dans une approche universitaire et scientifique ; j’ajoute à cela une composante en disant « il faut lutter contre, ne pas le faire, c’est collaborer ». L’idée du soutien d’une ville plus propre et sécurisée qu’un rapport moral rend inconditionnel ne laisse pas de place aux voix dissidentes qui essayent d’en montrer les conséquences désastreuses sur la qualité de vie des classes ouvrières.
Comment lutter contre l’extension du processus et l’installation durable des inégalités inhérentes à la gentrification ?
Il faut baisser les loyers pour que le marché soit moins tendu sur le plan économique et que les rapports de concurrence entre les humains cessent. J’irais même plus loin que ça : il y a des personnes avec qui on ne peut pas partager la ville. Une personne travaillant aux institutions européennes et qui gagne 12 000 euros par mois ne pourra pas cohabiter avec des ménages au CPAS dans la mesure où la concurrence entre elles et eux pour se loger est inégale. Comment mener une politique de la ville cohérente quand de telles inégalités entre les humains existent ?
Les discours sur la ville et les inégalités spatiales ne sont qu’une autre manière de constater les inégalités structurelles.
Une autre dimension importante est l’islamophobie. La critique ne porte plus uniquement sur la concentration de personnes pauvres, mais sur des jugements culturels, des modes de vie. On entend « il n’y a que des hommes dans ces cafés ; les femmes n’y sont pas admises ; il y a un sentiment d’insécurité… » ; on ne fait pas cette remarque aux membres du cercle de Lorraine ou aux personnes qui fréquentent un terrain de golf. Au fond, les discours sur la ville et les inégalités spatiales ne sont qu’une autre manière de constater les inégalités structurelles.
La gentrification est un phénomène spatial : c’est une visibilisation matérielle des inégalités structurelles et aujourd’hui du discours islamophobe. On vit dans un système capitaliste, inégalitaire, sexiste et raciste. On a les pieds dedans, on va se salir. Mais qu’est-ce qu’on fait avec nos mains ? Il faut sortir de l’illusion de la perfection et de la pureté ; demander aux personnes ayant besoin de plus d’espace, d’une chambre pour les enfants, de ne pas accéder à un niveau de sécurité matérielle est difficile et probablement inacceptable. Agir dans la perspective d’actions collectives est important : refuser d’inscrire son enfant dans des écoles dans lesquelles des classes de niveau existent ; accepter en tant que propriétaire, si pas de diminuer le loyer, d’au moins ne pas l’augmenter ; être solidaire avec ses voisin·es ; faire les devoirs de leurs enfants ensemble quand les voisin·es ne savent ni lire ni écrire…
Si les loyers restent bas, les habitant·es restent dans les quartiers. Ce qui les expulse, c’est l’augmentation du prix. Le co-living participe aussi à cela. Si la réponse n’est pas collective et publique, le marché continuera de flamber. De manière générale, les riches sous-occupent leur logement là où les pauvres suroccupent. Les villes sont trop denses aujourd’hui en termes de population pour laisser des logements inoccupés : on devrait pouvoir le réguler. Mais c’est impossible sans une volonté politique et un discours averti.
Propos recueillis par Frédéric Personat