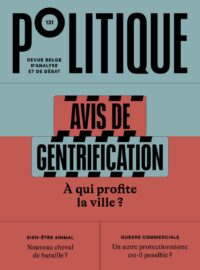Travail
IA : dégradation du travail ou grand remplacement ?
12.11.2025

Introduction des machines, automatisation, technologies de l’information et de la communication, robotisation, numérisation et aujourd’hui intelligence artificielle : toujours les mêmes débats, les mêmes paniques morales, et chaque nouvelle technologie est censée se substituer au labeur humain. Et chaque fois elle annonce la fin du travail.
Les technologies d’intelligence artificielle (I.A.), broyeuses de travail, prophétiseraient l’effondrement inéluctable de l’emploi. En conséquence, le recul de l’âge de la retraite, la suppression de l’indemnisation du chômage de longue durée, un moindre remboursement des soins de santé et la flexibilisation de l’emploi seraient nécessaires pour faire face « au gouffre » creusé dans le financement de la sécurité sociale par la suppression massive des emplois.
L’I.A. ne remplace pourtant pas l’emploi, comme le montre Juan Sebastian Carbonell, d’abord parce qu’elle ne peut exister que par le travail. Elle repose sur les données produites par les salarié·es d’entreprises, par l’activité sous-rémunérée d’une multitude de microtravailleurs et microtravailleuses précaires, qui nettoient, annotent et vérifient les données, et bien sûr par l’appropriation gratuite du travail de journalistes, écrivain·es, artistes, musicien·nes, scientifiques et de bien d’autres encore, employé·es quelque part par ailleurs. Aussi faut-il « moins se focaliser sur les emplois potentiellement remplacés par l’I.A. que sur ses effets sur la qualité de l’emploi »1.
Il faut moins se focaliser sur les emplois potentiellement remplacés par l’I.A. que sur ses effets sur la qualité de l’emploi.
La catastrophe tant de fois annoncée par les « futurologues », les cabinets de conseil et les prévisionnistes ne s’est en effet jamais produite. L’emploi a doublé en Belgique depuis la Seconde Guerre mondiale et cette augmentation de l’emploi, tout comme une diminution du temps de travail, ne s’est pas démentie tout au long de cette période. Rien ne permet de croire qu’il en serait autrement dans la décennie à venir.
Dans l’entreprise, l’I.A. n’est donc pas tant une broyeuse d’emploi qu’un outil de dégradation du travail. Le « management algorithmique », né au sein des plateformes numériques, s’est répandu ensuite dans les autres secteurs d’activité. En dictant aux salarié·es leur conduite au travail, le « taylorisme augmenté par l’I.A. », selon les termes de Carbonell, renforce le pouvoir des pa tron·nes sur l’organisation du travail.
L’IA n’est pas tant une broyeuse d’emploi qu’un outil de dégradation du travail.
Le gouvernement Arizona a fait du travail un actif stratégique de sa politique qui s’inscrit dans la logique austéritaire européenne et de sa soumission à l’injonction de Donald Trump de doubler les dépenses militaires. En conséquence, les mesures adoptées sont focalisées sur l’impératif de travailler plus longtemps, c’est-à-dire d’élargir la place quantitative du travail dans la société, sans considération de sa qualité. Travailler plus signifie plus d’heures supplémentaires, plus de temps partiel, plus de travail précaire et plus de « flexijobeurs » et « flexijobeuses » déjà actifs et actives par ailleurs. Mais surtout il faudra forcer « la mise au travail » des jeunes par le travail étudiant, des vieilles et des vieux par l’augmentation de l’âge de la retraite, des malades, des chômeurs et chômeuses et des bénéficiaires d’aide sociale en réduisant leurs conditions d’indemnisation.
L’Arizona a fait du travail un actif stratégique de sa politique qui s’inscrit dans la logique austéritaire européenne et de sa soumission à l’injonction de Trump de doubler les dépenses militaires.
Le travail est ainsi dégradé par les deux bouts : le « management algorithmique » dans l’entreprise et l’injonction à l’emploi dans la société. Les droits des travailleurs et travailleuses sont toujours au cœur du conflit du travail. Les enjeux en sont donc les modalités d’embauche et de licenciement, la détermination des salaires, le statut, c’est-à-dire les protections juridiques, de l’emploi et les conditions et l’organisation du travail.