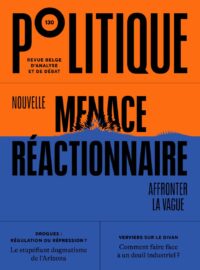Tournant autoritaire • Politique
La gauche peut-elle reconquérir l’hégémonie culturelle ?
23.07.2025

Hégémonie, théorie, projet… à l’heure d’affronter l’hiver réactionnaire, où en est la gauche en Belgique francophone ? Que doit-elle faire pour se renouveler ? Le débat qui suit entre différentes figures progressistes issues d’horizons divers illustre l’étendue du chantier.
Vous avez dit « hégémonie politique » ?
POLITIQUE Avons-nous basculé dans une hégémonie de droite ?
DANIEL ZAMORA Je n’irais pas jusque-là… Mais les dernières élections ont montré un infléchissement assez substantiel. Et sur un certain nombre de sujets, tels que le chômage ou les impôts, je pense que ce discours a une assise profonde dans la société et que sans une sérieuse remise en cause à gauche, le vent ne risque pas de changer de cap. Même les symboles historiques de la gauche, telle que la Sécurité sociale, sont souvent défendus d’une manière assez peu politique. Avec de vagues références à la solidarité, mais détachées d’un projet d’ensemble.
ARIANE ESTENNE Je pense également qu’il faut relativiser l’idée d’une hégémonie de la droite. Et il faut aussi distinguer les discours et les faits. En Belgique, nous venons d’un modèle d’État social fort. Il existe toujours une plus grande protection sociale qu’ailleurs. Mais en même temps, un glissement se produit dans les paroles, y compris dans les espaces considérés comme des bastions de gauche. Les discours se droitisent aussi dans les médias. Tout l’intérêt du sujet est donc bien d’observer ces mouvements, qui ne sont pas nécessairement unilatéraux.
C’est comme si nous étions avec nos gants sur un ring face à des adversaires qui ont des bazookas.
JÉRÔME VAN RUYCHEVELT-EBSTEIN Je suis tout à fait d’accord sur le fait que l’hégémonie est une question mouvante et que le constat dépend du cadre dans lequel on se trouve. À ce propos, Baptiste Erkes (Etopia) étudie actuellement différents terrains comme l’enseignement, la culture, le monde associatif, les médias… Il remarque que la « morale progressiste », pour le dire simplement, est encore présente, voire dominante par endroits. Étudier cela plus en détail permet d’objectiver les choses, de ne pas ressentir une panique généralisée.
Par ailleurs, on peut aussi constater que le retour de bâton – qu’il soit antiféministe, antiécologiste, opposé à la lutte antiraciste… – est la conséquence d’avancées culturelles profondes de ces vingt dernières années. En revanche, sur le volet socio-économique, j’ai l’impression qu’on a progressivement échoué : on a perdu à la fois le sens d’éléments de langage et des capacités de se représenter des enjeux collectifs, et la solidarité sous-jacente comme quelque chose de concret, de palpable.
La gauche est-elle responsable ?
JÉRÔME C’est tout l’angle du texte que j’ai récemment publié sur « les narratifs de gauche ». Mais il ne faut pas oublier l’offensive énorme du néolibéralisme et de sa production culturelle dès les années 1980 : cinéma, histoire, marketing, publicité, musique. Beaucoup de choses jouent contre nous. La récupération et la concentration des médias privés, de maisons d’édition, la politisation des algorithmes des réseaux sociaux…
C’est comme si nous étions sur un ring avec nos gants de boxe face à des adversaires qui ont un bazooka. Par conséquent, au-delà du fait qu’il faut revenir davantage sur le terrain, l’un des enjeux aujourd’hui, c’est aussi de lutter contre la privatisation des modes de production culturelle, soutenir les services publics médiatiques, les organes de régulation – notamment des réseaux sociaux –, la culture démocratique tournée vers l’intérêt général, financée par le public et non pas privatisée…
Est-ce qu’un des problèmes de la gauche n’est pas de réfléchir trop à la stratégie politicienne, en oubliant la question fondamentale de ce qu’on pense et des mots qu’on emploie pour penser ? Ne faut-il pas parler à nouveau de classe sociale, de lutte de classes, de prolétariat etc. ?
JÉRÔME Au sujet des terminologies, certaines ont permis de structurer des « narratifs » il y a un siècle. Elles ont été utiles pour faire naître une conscience de classe dans une population majoritairement analphabète. Les mots comme « conscience de classe », « lutte de classe », « prolétariat », sont peut-être encore des mots à utiliser. Mais ils sont devenus aujourd’hui connotés idéologiquement et datés, pour devenir davantage des termes analytiques utilisés par la « gauche culturelle ». En fait, il y a une étape de « mise en culture » des mots auprès des gens qu’on veut pouvoir mobiliser. On pense trop que ce qui est validé dans un milieu universitaire ou militant, édicté en vérité politique, peut être reçu directement par les personnes concernées. Alors que justement, il y a une étape de terrain, à partir des vécus et des expériences partagées. Un enjeu contemporain est de sortir les gens de chez eux et de leur isolement, leur faire prendre conscience qu’il y a des problématiques communes. Qu’il y a un système en place. Et que, par conséquent, l’une des seules solutions est de se coaliser avec des personnes qui vivent les mêmes problématiques. Et c’est à ce moment-là, dans ce vécu affectif, que peut renaître une conscience de classe et aussi les éléments de langage qui permettent de nommer les choses.
ARIANE J’ajouterais que la question est beaucoup plus globale que celle des mots employés. L’une de nos difficultés, c’est qu’aujourd’hui, la gauche commence trop souvent par se pencher sur la communication, alors qu’il y aurait beaucoup à dire et penser en amont.
Mais ne pas parler un langage commun, le fait d’une scission entre les intellectuel·les et le peuple, c’est un constat majeur.
ARIANE La réponse pour moi, c’est l’école. Si l’on considère que des concepts permettent de penser, je ne crois pas qu’il faille en changer. Il y a aujourd’hui une énorme perte de culture politique et cela ne dépend pas simplement des intellectuel·les. Elle s’apprend à l’école, dans les livres… Il y a des mots qui ont toujours fait partie de la culture commune dans les mouvements sociaux, comme « sécurité sociale » et « émancipation ». On partageait la conviction qu’ils étaient fondamentaux pour décrypter le monde. Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas d’abandonner ces mots, mais de savoir comment faire pour que tout le monde sache ce qu’ils signifient. L’enjeu, au sens large, c’est donc l’éducation populaire.
L’entre-soi a nourri une paresse sur le plan des idées. Il y a un manque de curiosité et des manières peu convaincantes de défendre certaines valeurs auprès du grand public.
DANIEL Il faut aussi rappeler que nous connaissons aujourd’hui un déclin d’affiliation syndicale et de l’appartenance à une série de groupes qui médiaient le rapport des citoyens à la politique. C’est une situation générale qui dépasse le cas de la Belgique. Cette question des mots et de leur perte de sens est aussi liée au déclin de l’encadrement politique. Mais c’est la question à un million d’euros : est-il possible de recréer l’encadrement politique du XXe siècle ? Un engagement dans un parti politique, dans les années 1960, cela structurait la vie d’une personne, comme faire partie d’une Église. C’est la condition politique qui a changé, à gauche et à droite. C’est ce qui ouvre l’espace pour « la séquence populiste » comme Arthur Borriello et Anton Jäger ont très bien pu en parler dans ces colonnes.
Quelle théorie ?
Daniel Zamora rappelle la chute de la médiation sociale, de l’intermédiation. Mais n’est-ce pas aussi une question de théorie ? Les intellectuel·les et militant·es de gauche sont-ils aussi « mauvais·es » de ce point de vue ?
JÉRÔME Au niveau intellectuel, je trouve au contraire que ça foisonne. Mais sur le terrain, parfois, on n’arrive pas à parler aux gens. J’ai fait beaucoup d’entretiens avec des affilié·es des mutualités, mais aussi des délégués syndicaux. Quand ces derniers m’expliquent la manière dont ils essaient de convaincre, c’est d’abord en recréant un lien social et affectif, un commun, en mobilisant des valeurs qui ne sont pas nécessairement perçues comme politiques. C’est le fait d’être solidaire de son voisin et de sa voisine, parce qu’ils ont connu des inondations ou vécu avec un enfant malade. C’est partir de cette morale populaire, progressiste, qui existe auprès de tout un chacun et chacune. C’est dans cette capacité à entrer en connexion émotionnelle avec les gens que la gauche est parfois mauvaise.
Quelle stratégie ?
La seule solution, c’est de réunir des gens, créer des espaces collectifs, au calme.
Nous arrivons à cette question de la stratégie, qui ressemble à un cercle vicieux. En effet, on a besoin des gens pour penser un projet, mais avec la fin de l’intermédiation, ils ne sont pas là. Mais sans projet, on ne peut pas mobiliser. Et le mouvement positif ne peut s’enclencher. Que faire ? Par où commencer ?
ARIANE La seule solution, c’est de réunir des gens. Créer des espaces collectifs, au calme. Des plus petits comités locaux de quartier aux grandes assemblées thématiques, c’est la seule chose à faire : réunir, laisser place à une conflictualité et arriver à réfléchir ensemble.
Si je vous prends au mot, plutôt que cet entretien et ce dossier, Politique devrait alors se concentrer sur l’ouverture d’un café associatif ?
ARIANE Il n’y a pas à choisir. Il y a une action conjointe à mener, pour re prendre un terme générique. Réunir des gens pour arriver à se redonner des boussoles peut prendre mille formes. Il y a toute une série de lieux et d’as sociations, dont Politique, qui peuvent aujourd’hui jouer ce rôle de refaire du collectif. Le plus important, au sujet de la stratégie, c’est la question des alliances. Dans les analyses de la défaite de la gauche, la question de travailler ensemble, singulièrement en Belgique. On doit pouvoir à la fois être multiple, proposer mille façons de faire du collectif, et à la fois travailler ensemble.
Les revendications et le plaidoyer de gauche sont généralement des réponses réactives, ce qui pose la question d’une tension fondamentale, aujourd’hui, entre des réponses centralisées et décentralisées.
JÉRÔME Je suis d’accord et c’est un peu paradoxal. On nous dit que les capacités sociales des gens et leurs aspirations ont changé, mais lorsqu’on pro pose des espaces de discussion à partir de leurs difficultés, ils viennent car il y a une aspiration. Recréer des lieux de socialisation, ce n’est pas dire : « venez pour la socialisation, pour la démocratie », comme si c’était une fin en soi. Mais « venez faire la fête », « venez passer un moment convivial » ou « venez on va aborder un problème, nous allons en dis cuter, et peut-être même le régler ». C’est frappant quand je vais en agences des mutualités quand je demande aux gens comment ils vont, ils restent à parler, tant que tu ne mets pas fin à la conversation. Parce qu’on ne leur demande jamais, parce qu’ils ne voient plus d’humains à un guichet de banque, à un guichet SNCB. Parce que les voisins et voisines ne se parlent plus. Il y a vraiment une grande demande d’empathie. Quand on parle de re déploiement sur le terrain, j’y crois vraiment, avec les publics qui ont intérêt à connecter avec des orgas progressistes. Niveau méthode, je pense notamment à côté du syndicalisme au travail, au syndicalisme de quartier, au community organizing : faire du porte-à-porte, aller dans le quartier pour demander aux gens quelles sont leurs difficultés, etc On réunit 15 personnes qui ont la même problématique. Et on enchaîne les actions collectives.
DANIEL Ce que tu décris, l’importance d’aller frapper aux portes, discuter avec les gens, participer à des choses en commun, c’est un peu ce que fait le PTB, non ?
On nous dit que les capacités sociales des gens et leurs aspirations ont changé, mais lorsqu’on propose des espaces de discussion à partir de leurs difficultés, ils viennent car il y a une aspiration.
JÉRÔME Il y a une chose que fait effectivement ce parti, c’est être sur le terrain. En se positionnant de prime abord horizontalement, pas de manière descendante avec un discours à digérer. Cette première étape de rencontre, il faut reconnaître que ce sont les seuls à le faire actuellement au ni veau des partis.
Du point de vue de la stratégie, quelle est la perspective du MOC, justement, par rapport aux partis ?
ARIANE La question qui m’importe est la façon de faire du lien avec les mouvements sociaux, comment ils s’y articulent. C’est pour moi un enjeu majeur, car il y a aussi un discours très puissant à droite, consistant à dire qu’il n’y aurait rien de légitime entre la population et les partis politiques ; tout ce qui viendrait intermédier, justement, serait « une atteinte à la légitimité des urnes ». On entendait depuis long temps ce discours à la NVA. Et c’est maintenant le MR qui le reprend, tel quel. Contre cela, les partis de gauche doivent réassurer vraiment un ancrage à travers leurs mouvements. Il y a le mouvement ouvrier en Belgique, qui est pilarisé, et puis il y a la question du PTB aujourd’hui, intéressante de ce point de vue : comment s’articule-t-il au mouvement social, et singulièrement aux syndicats ?
En conclusion, sur quoi devraient se focaliser nos lecteurs et lectrices, quel levier vous semble important pour la gauche aujourd’hui ?
ARIANE Obtenir des victoires : gagner des batailles comme des droits effectifs pour la population, la régulation des loyers, des communautés d’énergie, re nationaliser certaines industries, des actions concrètes pour regagner de la légitimité démocratique.
JÉRÔME Puisque l’on parle de lecteurs et lectrices, je voudrais justement dire que ce n’est pas juste un enjeu individuel. Sinon, on en revient au tri des déchets individuel comme solution générale pour l’écologie. C’est plutôt : quelle question dois-je me poser, dans l’espace militant, associatif, syndical, dans lequel je veux pouvoir agir, quelles questions j’amène à l’organisation ? En voici : ce que je défends a-t-il été pensé avec les publics concernés par le projet et si ce n’est pas le cas, comment reconnecter socialement avec ces personnes ? Ce type de questions me semble fondamental et il faut pouvoir le penser de manière structurelle, pour faire converger les organisations entre elles, afin de s’unir sur certains territoires, certains sujets, etc.
DANIEL La question du travail, reste et doit rester au cœur du projet de la gauche. Au cours des 20 dernières an nées, la droite a parfaitement réussi son coup d’état symbolique en inversant le discours. La gauche serait au service des « assistés » et la droite de « ceux qui se lèvent tôt ». À moins de renverser cet imaginaire, les défaites risquent de s’accumuler.