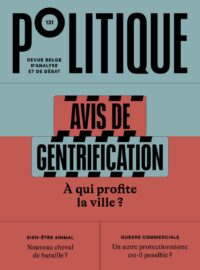Economie
La guerre commerciale, symbole d’un système en crise
17.10.2025
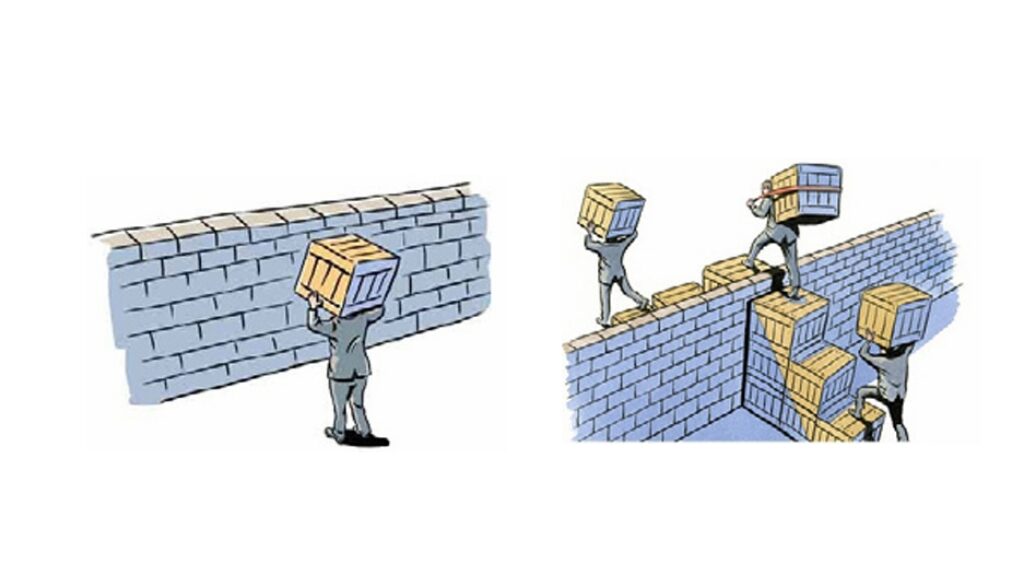
Le 2 avril 2025, le monde a plongé dans l’inconnu avec l’imposition de droits de douanes exorbitants à tous crins par les États-Unis. Si cette séquence n’augure rien de bon pour la stabilité géopolitique du monde, un regard historique nous montre qu’elle n’a rien d’inédite.
Lors de son allocution désormais célèbre du 2 avril dernier, le président américain a surpris par la sévérité des taxes douanières imposées. Évidemment, sa position était déjà connue : il fait campagne sur l’idée que le libre-échange n’a pas été bénéfique pour l’Amérique depuis l’ère Reagan. Il n’empêche que l’ampleur de ces droits de douane ainsi que l’aspect soudain de leur annonce a eu l’effet d’une onde de choc.
Bien que les conséquences concrètes à long terme de ces mesures ne puissent encore être évaluées, il est possible de regarder dans le rétroviseur et constater que nous ne sommes pas face au premier effondrement du libre-échange.
Libre-échange contre protectionnisme, un débat vieux de plusieurs siècles
Depuis le XIXᵉ siècle, de nombreuses crises ont ébranlé les fondements de l’économie mondiale. À partir de la fin des guerres napoléoniennes, un grand mouvement s’amorce, avec le Royaume-Uni comme cœur de la révolution industrielle. Afin d’écouler ses produits manufacturés, le pays doit ouvrir son économie au commerce international. Problème : cela ne plaît pas à tout le monde, notamment à la noblesse terrienne, qui tire d’énormes profits des droits de douane qui empêchent les prix de baisser, par exemple sur les céréales. De leur côté, les industriels souhaitent que leur prix soit aussi bas que possible, afin de réduire le coût de la main-d’œuvre.
À partir de la fin des guerres napoléoniennes, un grand mouvement s’amorce, avec le Royaume-Uni comme cœur de la révolution industrielle.
Ces mesures protectionnistes sont connues sous le nom de Corn Laws (les lois céréalières). Elles finiront par être abolies. Dans leur combat pour l’abolition des tarifs douaniers, les industriels trouvent des alliés inattendus, comme le philosophe Karl Marx. Dans un discours en 1847, il exprime son soutien à leur cause, estimant que la suppression de ces protections accélérera le développement de la société industrielle. Pour les historiens, elles symbolisent le moment où l’économie anglaise s’ouvre et où la domination des industriels sur les propriétaires terriens s’affirme.
En 1873, la première crise financière mondiale éclate, prenant le monde entier par surprise. Cette panique boursière fut déclenchée par une intense spéculation autour des nouvelles technologies de l’époque, le rail en tête. Elle marque la fin durable d’un système économique fondé sur le libre-échange et les guerres coloniales menées en son nom, comme les guerres de l’opium (1839-1842) ou la guerre de la Triple-Alliance contre le Paraguay (1864-1870). Évidemment, l’ouverture de l’économie britannique a pour corollaire l’ouverture d’autres marchés pour accueillir les biens exportés par les industries anglaises. Ce revers du libre-échange, on le constate aussi dans les chiffres1. Le commerce international ne reviendra à des niveaux comparables en terme de pourcentage du PIB mondial que cent ans plus tard, dans les années 1970.
La rhétorique utilisée à l’époque pour justifier les droits de douane nous semble aujourd’hui très familière : au Royaume-Uni, les produits allemands étaient accusés de faire concurrence aux produits britanniques. C’est de cette époque que datent les mentions « Made in… » sur les produits manufacturés. La plupart des économies industrielles de l’époque suivent cette tendance. C’est le début de ce que l’économiste américain Douglas Irwin appelle « the restriction period » dans l’économie américaine, une période marquée par des taux de droits de douane très élevés qui dureront des dizaines d’années. Mais ces droits de douane ne font qu’empirer la crise économique de 1873. La période de 1873 et 1896 est d’ailleurs appelée par les historiens la première « Grande dépression ».
Les mouvements coloniaux sont déjà justifiés à l’époque par l’idée de trouver des débouchés pour les pays industriels.
Paradoxalement, cette politique engendrera des « héros » du protectionnisme dont Donald Trump se revendique encore aujourd’hui, comme le président étatsunien William McKinley. La crise en Europe trouvera une solution dans la colonisation de l’Afrique et du Pacifique dans les années qui suivront. Ces mouvements coloniaux, sont déjà justifiés à l’époque par l’idée de trouver des débouchés pour les pays industriels. Cécil Rhodes, premier ministre de la colonie du Cap (actuel Afrique du Sud) et grand industriel anglais, dira notamment : « Pour sauver les quarante millions d’habitants du Royaume-Uni d’une guerre civile meurtrière, nous les colonisateurs, devons conquérir des terres nouvelles afin d’y installer l’excédent de notre population, d’y trouver de nouveaux débouchés pour les produits de nos fabriques et de nos mines. »2
Cette vague de colonisation se concluera avec la Première Guerre mondiale avec pour fond le contrôle des colonies ainsi que l’hégémonie en Europe et ailleurs.
Un deuxième effondrement du commerce international
Une deuxième crise économique mondiale mènera à un autre effondrement du commerce international et à une seconde grande dépression, mieux connue de nos jours.
En effet, lorsque la crise de 1929 éclate, un phénomène comparable se produit à celui qui a lieu après 1873, mais de manière plus rapide et plus violente. Dès 1930, les États-Unis se coupent pratiquement à 100 % de l’économie mondiale avec le Smoot-Hawley Tariff Act, qui augmente les taxes douanières pour une liste interminable de 20’000 biens distincts. Les raisons invoquées ? Protéger les entreprises et industries nationales de la concurrence étrangère. La réponse des autres pays est immédiate : ils imposent à leur tour des droits de douane sur les produits étrangers. C’est ainsi que le monde sombre une nouvelle fois dans la Grande Dépression. À l’époque, les conflits commerciaux entre les États-Unis et le Japon sont l’un des éléments qui, parmi d’autres, mèneront à la guerre du Pacifique en 1941.
Les crises successives de ces dernières années menacent désormais l’existence de ce système de libre-échange mondialisé.
À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, l’ordre mondial que nous connaissons aujourd’hui s’est mis en place. Des institutions comme le fond monétaire international (FMI), l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et la Banque mondiale sont créées pour établir un système de gouvernance mondiale du commerce international et favoriser la libéralisation des économies à travers le monde. Ce processus est ce que l’on appelle la mondialisation. Les conséquences démocratiques et écologiques de la mondialisation ont fait l’objet de nombreux débats au cours des dernières décennies, opposant progressistes et libéraux. Cependant, les crises successives qui se sont produites ces dernières années menacent désormais l’existence même de ce système de libre-échange mondialisé. L’histoire nous montre que cette éventualité est tout à fait crédible. Sommes-nous entrain d’y assister ?
Vers l’instabilité et l’incertitude
Depuis la Seconde Guerre mondiale , nous avons assisté au développement sans précédent du commerce international qui s’est accompagné d’intervention américaine en faveur de la mondialisation aux quatre coins du monde. Aujourd’hui, le libre-échange est en péril, et nous traversons une période charnière dans l’économie mondiale, comparable à celles de 1873 et de 1930. Cependant, ce n’est ni en écoutant les altermondialistes des dernières décennies ni en cédant aux revendications des Zapatistes que l’effondrement du libre-échange se produit. Ce n’est pas non plus parce que les partisans du “commerce équitable”, opposants à une mondialisation qui ruine les agriculteurs du Sud, ont gagné. Le changement de cap actuel de la première puissance mondiale n’est pas motivé par l’altruisme, mais par l’intérêt.
Certains syndicalistes américains, comme le très à gauche Shawn Fain, président du syndicat uni des travailleurs de l’automobile (United Auto Workers, UAW) soutiennent les mesures mises en place par Trump. Leur constat qu’une partie des industries a été délocalisée pour diminuer les coûts de main d’œuvre pour certaines multinationales est correct. Mais la politique de Trump n’est pas là pour s’opposer à ces groupes multinationaux. C’est même tout l’inverse. Lorsque Huawei a été banni des États-Unis ou lorsque Trump a mis en place des tarifs douaniers sur certains produits électroménagers lors de son premier mandat, c’était bien pour protéger les groupes multinationaux américains qui avaient du mal à rivaliser avec des concurrents asiatiques.
Les taxes commerciales imposées par Trump vont placer les pays du Sud dans une situation délicate, notamment ceux pour qui les États-Unis constituaient un marché d’exportation. La plupart des économies émergentes ont vu leurs monnaies s’effondrer au mois d’avril ainsi que les intérêts sur leur dette souveraine augmenter. Signe que les marchés anticipaient que ces économies allaient être particulièrement touchées.
Les crises sanitaires, climatiques, internationales de cette dernière quinzaine d’années nous plongent dans une période d’instabilité géopolitique majeure.
Cette situation s’inscrit sous le poids des crises successives qui menacent aujourd’hui les intérêts de certains pays, les États-Unis en tête. Ces crises, sanitaires, climatiques, internationales, s’enchaînent depuis une quinzaine d’années et nous plongent dans une période d’instabilité géopolitique majeure. Comme par le passé, la guerre commerciale n’est peut-être qu’une première étape vers une guerre tout court, ou en tout cas des conflits plus larges. Il importe de ne pas oublier qu’il y a une continuité entre le Trump qui annonce les tarifs douaniers et le Trump qui demande une hausse de la norme des dépenses militaires de l’OTAN deux mois plus tard aux alliés européens.