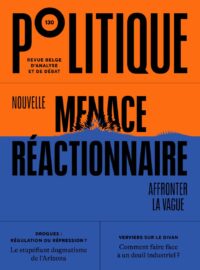arizona
Arizona et politique anti-drogues : chronique d’un échec annoncé
15.09.2025
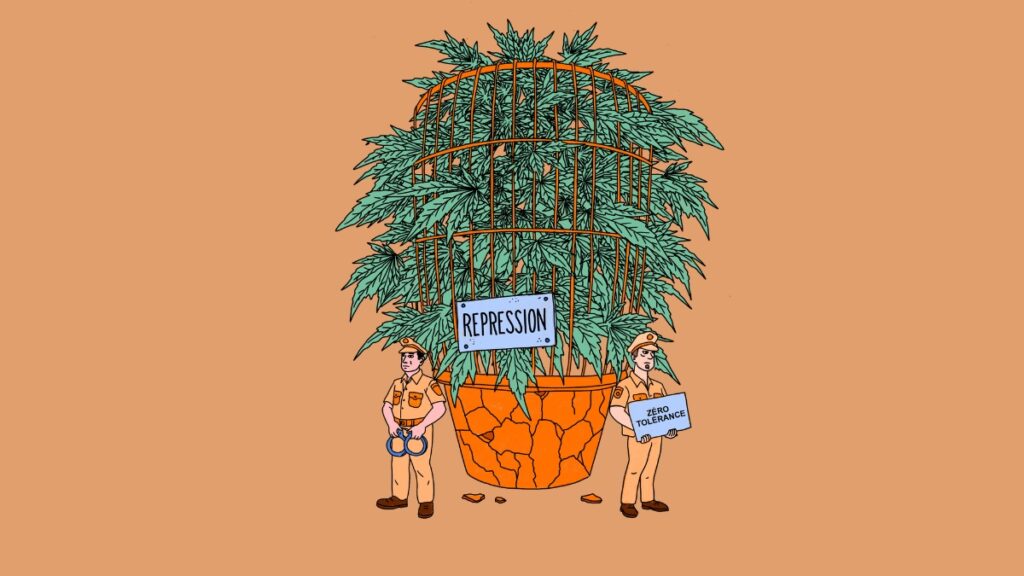
À peine lancé, le projet de l’Arizona sur la question des stupéfiants est déjà un échec. Emblématique de la méconnaissance de nos responsables politiques, il porte également en lui les germes d’une surpénalisation mortifère des consommateurs et consommatrices, au détriment de leur autonomie, de leur bien-être, et ce au plus grand profit des trafiquants.
La lecture du chapitre consacré aux drogues dans l’accord du gouvernement fédéral laissera pantois tout spécialiste : slogans creux, anathèmes indignes, propositions chimériques… Ce texte, qui entend confirmer et renforcer une politique exclusivement répressive, apparait en total décalage avec la prolifération de travaux scientifiques. Ceux-ci ont en effet démontré de longue date l’échec inéluctable de toute « guerre à la drogue ». Sans parler de la multiplication d’expériences alternatives, observées à l’étranger, qui produisent des résultats dignes d’intérêt en termes de santé et de sécurité publiques.
Cet accord de gouvernement est donc le signe d’un deuil, celui d’une gestion pragmatique et informée de la consommation de drogues, à la place : une vision idéologique et purement morale de la question. En témoigne l’une des phrases qui ouvre ce chapitre et fait office de postulat indiscutable aux yeux du gouvernement fédéral : « les drogues sont toujours nocives et il convient de communiquer en ce sens. »
Cette pétition de principe ignore pourtant une réalité encore récemment pointée par Sciensano dans son dernier rapport sur la consommation de drogues en Belgique : celle-ci est globalement en hausse, quel que soit le produit étudié.1 Or, si l’usage de drogues tend à augmenter et à se diversifier, c’est que celui-ci remplit une fonction et répond à un besoin personnel (plaisir, réconfort, tranquillité, stimulation, etc.).2 Indépendamment de la difficulté d’établir des critères objectifs permettant de qualifier une consommation comme problématique, ces études confirment également que la majorité des usagers et usagères de stupéfiants, avec certes des nuances importantes en fonction du ou des produit(s) consommé(s), ne présente pas de risque sanitaire ou sécuritaire particulier.
La confirmation d’une législation problématique
En Belgique, la prohibition fut instaurée à partir des années 1920, soit il y a plus d’un siècle, avec la loi du 24 février 1921, un texte désuet, inadapté et source d’insécurité juridique. Cette loi, historiquement votée pour lutter contre la consommation d’opium, si elle a bien entendu évolué depuis son adoption (mais toujours vers plus de répression), est jugée problématique et contre-productive par tous les acteurs et actrices de terrain, en ce compris nombre de personnes appartenant aux mondes de la justice et de la police.
Cette législation souffre de plusieurs apories faisant obstacle à une politique cohérente en matière de gestion de la consommation de produits stupéfiants. Ainsi, elle ne distingue ni les substances ni leurs usages pourtant extrêmement divers. En outre, exclusivement répressive, elle ne fournit aucun cadre juridique satisfaisant et stable aux initiatives de réduction des risques pourtant indispensables et qui ont montré, ici comme ailleurs, hier et aujourd’hui, toute leur efficacité (informations des consommateurs, testing de produit sur les sites de consommation, disponibilité d’un matériel stérile, salle de consommation supervisée, accessibilité de la naloxone pour empêcher les décès liés à une surdose, etc.).
Ces dispositifs pourront bien être envisagés par les entités fédérées au titre de leur compétence en matière de santé publique – à lire leur déclaration de politique générale respective, il nous est cependant permis d’en douter –, ils ne pourront jamais déployer leur potentiel et multiplier leurs bienfaits dans le cadre d’une politique ultra-répressive telle que celle que nous annonce l’Arizona.
Pour nos ministres, la personne qui consomme des drogues est soit un·e délinquant·e qui ne mérite aucune mansuétude,
soit un·e malade qu’il conviendrait de soigner, même contre son gré.
À l’occasion du centenaire de cette législation, une cinquantaine d’associations et des milliers de personnes se sont mobilisées dans le cadre de la campagne STOP 1921 et appellent à un profond changement de paradigme passant par l’abrogation de ce texte.3 Totalement sourd à cette mobilisation sans précédent, le gouvernement Arizona annonce la couleur : « Le gouvernement ne prendra pas d’initiative de légalisation. » Point. Cette phrase lapidaire met ainsi fin aux espoirs nés à l’occasion de cette campagne qui avait même trouvé un écho, certes timide, au Sénat dans le cadre du « Rapport d’information sur l’évaluation générale des résultats effectifs de la loi sur les drogues du 24 février 1921 quant à l’efficience des politiques en matière de drogues et plus particulièrement en matière de cannabis », dont l’une des recommandations suggérait « l’émergence d’un nouveau cadre juridique qui favorise l’égalité des citoyens devant la loi, l’accessibilité et la prévisibilité de la loi ainsi qu’une harmonisation de la politique des poursuites. » Avec l’Arizona, nous en sommes loin…
Entre culpabilisation et stigmatisation
Pour nos ministres, la personne qui consomme des drogues est soit un délinquant qui ne mérite aucune mansuétude, soit un malade qu’il conviendrait de soigner même contre son gré. Dans tous les cas, et le texte de l’accord gouvernemental alimente cette perspective, il s’agit d’une personne qu’il faut culpabiliser et stigmatiser. « Tous les consommateurs de drogue ont du sang sur les mains »4 affirmait d’ailleurs et récemment l’un des artisans de cet accord. Une phrase indigne, vécue légitimement comme une insulte par les centaines de milliers de personnes qui consomment des produits stupéfiants dont l’immense majorité n’a commis un quelconque autre délit que celui consistant à se procurer un produit arbitrairement illégal. Dans cet accord, il semble de plus en plus évident que les consommateurs et consommatrices de drogues seront à l’avenir des citoyen·nes de seconde zone dont on peut rogner les droits les plus élémentaires sans sourciller.
Ainsi, est-il prévu que la Commissaire aux drogues puisse récolter et traiter des données personnelles dont celles « provenant des services d’inspection, de la santé publique, des partenaires privés et des autres services de soutien » et ce au mépris tant du secret dû aux informations médicales et que des règles déontologiques propres aux travailleurs sociaux. Des trajectoires de soin seront imposées notamment via la généralisation des Chambres de traitement de la toxicomanie dont on sait qu’elle contribue à étendre le filet pénal, soit à insérer dans une machinerie médico-répressive sans fin (et souvent sans moyen) des personnes qui n’ont en réalité rien à y faire.5 Dernier exemple : et si les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants payaient littéralement leur peine de prison ? « Il devient », en effet, affirme l’accord « compliqué d’accepter que les deniers publics prennent intégralement en charge le coût de leur détention » et de proposer « de mettre certains détenus [dont les vendeurs de stupéfiants] à contribution pour couvrir tout ou partie du coût de leur incarcération. »
Les études confirment pourtant que la majorité des usagers et usagères de stupéfiants, avec certes des nuances importantes en fonction du ou des produit(s) consommé(s), ne présente pas de risque sanitaire ou sécuritaire particulier.
La politique exclusivement répressive portée par la coalition Arizona est, en outre, socialement discriminatoire. De longue date, la recherche criminologique a démontré que la justice pénale n’était pas neutre : elle frappe différemment les individus compte tenu, notamment de leur genre, de leur origine ethnique ou de leur condition socio-économique. Cette différence de traitement systémique est particulièrement perceptible dans le cadre des politiques criminelles visant spécifiquement les consommateurs de drogue. Sur ce point, l’accord gouvernemental creuse encore le sillon d’une répression inégalitaire en prévoyant de renforcer « le système de transaction pénale immédiate pour les consommateurs. » Ainsi, la personne nantie qui pourra payer son amende rubis sur ongle sera privilégiée par rapport aux usagers et usagères plus précaires et financièrement incapables de répondre à cette exigence.
À coup d’amalgames douteux ou de menaces délirantes, l’Arizona se donne à voir telle une machine à stigmatiser : tantôt s’agira-t-il d’« éloigner durablement de nos rues les trafiquants de drogue et autres auteurs de nuisances sans droit de séjour en Belgique » ou de « déchoir de sa nationalité » un revendeur de stupéfiants, tantôt d’enfermer les « femmes enceintes toxicomanes (…) dans des établissements de soins »…
La répression : une impasse criminelle
La « tolérance zéro », que scande l’accord gouvernemental et qui vise tout spécialement la vente et la consommation de stupéfiants, semble constituer le seul horizon de nos autorités. Le mot d’ordre reste la guerre à la drogue, une guerre menée et perdue depuis plus d’un siècle. Tout transpire l’envie d’en découdre dans cet accord aux accents matamoresques qui frise souvent le ridicule. Il est question de mailler le territoire, de plate-formes logistiques, d’infrastructures critiques, de reprendre le contrôle de nos ports, de nos aéroports, de nos gares, d’y déployer nos troupes…
Bref, d’« y mettre le paquet », si l’on osait cette expression pourtant assez fidèle aux accents virilistes de notre gouvernement fédéral. Et pour cela, tout est bon : bracelets électroniques, biométrie, drones, capteurs, et même… l’intelligence artificielle convoquée en vue de traquer les flux financiers des narco-trafiquants qui doivent déjà trembler à l’annonce du déploiement du génie informatique belge. On pourrait en effet sourire face à tant de naïveté technosolutionniste si les effets de cette surenchère coûteuse et vaine n’aboutissaient à multiplier les problèmes plutôt qu’à apporter un début de solution. Et si surtout et pour le dire crûment, elle n’avait pas, elle, du sang sur les mains…
Car loin d’être un outil performant dans la lutte contre ces réseaux, la répression contribue en réalité à augmenter l’insécurité publique comme en témoigne, de façon dramatique, la multiplication des fusillades à Bruxelles. Au quotidien, et derrière l’arbre de saisies présentées comme records et savamment mises en scène, l’essentiel des actions répressives consiste principalement à arrêter les « petits dealers » et à déplacer le phénomène géographiquement.
Ainsi, les actions coup de poing autour de la Gare du Midi ont repoussé les points de deals à Saint-Gilles et Anderlecht, des quartiers moins concernés par le phénomène, ce qui a donné lieu à une guerre des territoires violente et un environnement insécurisant pour les riverains. Car pendant que nos ministres se font les VRP des multinationales de la technosécurité, sur le terrain, certains consommateurs, certaines consommatrices et leurs proches souffrent, les acteurs et actrices de la prévention et de la santé s’épuisent et même policiers, magistrats et agents pénitentiaires cherchent en vain un sens à leur métier. Heureusement pour eux, l’on nous promet des « des prisons totalement exemptes de drogue » ! Ouf, tout va bien.
Enfin, alors que l’accord gouvernemental insiste tant et plus sur l’enjeu économique que soulève le commerce illégal de drogues – « frapper les organisations criminelles là où cela leur fait le plus mal : au portefeuille » –, il ignore pourtant une évidence rappelée récemment par l’économiste Paul de Grauwe : plus la répression augmente, plus les profits criminels sont importants.6 Ce paradoxe apparent mais que confirme l’évolution convergente des chiffres de saisies d’une part, ceux des bénéfices estimés dans le chef des producteurs de stupéfiants d’autre part, devrait à l’évidence nous mettre sur la piste d’une réorientation des budgets publics vers autre chose que cette guerre à la drogue socialement injuste, sécuritairement contre-productive et économiquement inefficace. Cet autre chose, il ne viendra pas du gouvernement fédéral.
Contre la répression, une seule solution : la régulation
Ainsi, le gouvernement fédéral s’obstine à exercer une politique aveugle et ultra-répressive, sans prendre en compte plusieurs expériences étrangères où les produits psychotropes voient leur production, leur distribution et leur consommation encadrées. C’est dans cette perspective que s’inscrit d’ailleurs le travail de la Liaison Antiprohibitionniste. En s’opposant au modèle répressif dominant et mortifère, elle a pour objectif de proposer des modèles alternatifs fondés sur un principe de santé publique et de respect des droits humains. Les exemples portugais, luxembourgeois et tchèque, parmi d’autres, sont des preuves de réussite en ce sens. En effet, la décriminalisation de la consommation a permis l’installation d’un climat plus sécure et sain pour toutes et tous et où il n’est pas question de se laisser bercer par l’illusion d’un monde sans psychotrope.