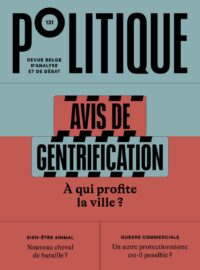Société
Matonge ne doit pas disparaître
13.11.2025

Matonge : lieu de mémoire, de vie sociale et économique, mais aussi espace de lutte de la communauté congolaise et des diasporas noires de façon générale. Derrière la vitalité du quartier se dévoile une autre réalité : celle de politiques urbaines qui, sous couvert de « revitalisation », gentrifient, remplacent et déplacent silencieusement les habitant·es historiques qui ont donné à ce quartier une âme et un nom.
L’histoire de Matonge c’est l’histoire de Bruxelles, du Congo de Lumumba et de Mobutu, de la Belgique de la Sabena (Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne) et de l’union minière. Dans les années 1960 et 1970, Matonge fut un lieu de prestige, d’organisation et de rencontre. Fréquenté par une élite congolaise qui découvre la métropole postcoloniale, par des étudiant·es, qui se mêlent aux diplomates dans les enseignes de modes, où se rencontrent musicien·nes, intellectuel·les, hommes et femmes d’affaires, et afrophiles des premières heures.
Les boutiques qui ferment à Matonge emportent avec elles le sourire des passant·es et les jobs de nombreux et nombreuses riverain·es du quartier.
Dans la dernière décennie du XXe siècle, la chute du cours du cuivre va provoquer un retentissement économique au Zaïre du Roi Léopard1. Le tissu social se modifie peu à peu, le pouvoir d’achat chute, des tensions sociales se ravivent. La petite bourgeoisie congolaise ne voyage plus et ne fait plus vivre les commerces de la chaussée d’Ixelles. L’impact ne se limite pas à l’économie congolaise. La Sabena chute au même moment. Les boutiques qui ferment emportent avec elles le sourire des passant·es et les jobs de nombreux et nombreuses riverain·es du quartier.
Diversité sous surveillance
Lieu de distinction devenu stigmatisé, Matonge a été associé à l’insécurité, ce qui a justifié de nouvelles interventions publiques, les rafles de celles et ceux qu’on a étiquetés de clandestin·es, devenues monnaie courante dans le paysage du quartier. La déstructuration du quartier a dévoyé celui-ci de sa fonction d’intégration sociale, culturelle et économique pour les nouveaux et nouvelles arrivé·es. Toutes ces différentes interactions, d’un petit monde dans le grand, faisaient de Matonge un foyer de revendications politiques et humaines. Un endroit où la nostalgie du pays se mêlait aux stratégies de débrouille.
Matonge a été associé à l’insécurité, ce qui a justifié de nouvelles interventions publiques, les rafles de personnes étiquetées de clandestin·es, devenues monnaie courante dans le paysage du quartier.
Depuis la création de la Région de Bruxelles-Capitale, ces interventions ont pris la forme d’une politique assumée de retour des classes bourgeoises au centre-ville. Embellissement des espaces publics, construction de logements moyens au détriment du logement social, incitation à l’investissement privé : autant de dispositifs qui ont transformé le quartier et poussé ses habitant·es les plus fragiles vers d’autres communes. La rhétorique de la « mixité sociale » masque cette contradiction : attirer de nouveaux et nouvelles habitant·es solvables, tout en laissant partir celles et ceux qui ont fait l’histoire du lieu.
Effacer Matonge
À cette expulsion économique s’ajoute une expulsion symbolique. Le projet de rebaptiser Matonge en « quartier des Continents », porté en 2016 par l’Association des commerçants avec l’appui de la commune, illustre cette volonté de lisser l’image du quartier pour un public international. Derrière le changement de nom se profile un effacement : celui de la mémoire congolaise, au profit d’une identité plus neutre, plus « globale », et donc plus rentable. Comme l’ont rap pelé les collectifs mobilisés, changer un nom n’est jamais un geste anodin : c’est une opération politique. Historiquement, toutes les offensives coloniales se sont accompagnées d’un travail sur les toponymes, signe d’une appropriation et d’une domination.
Derrière le changement de nom se profile un effacement : celui de la mémoire congolaise, au profit d’une identité plus neutre, plus « globale », et donc plus rentable.
La tentative de gommage du nom « Matonge » s’inscrit dans une continuité qui remonte au début des années 2000, après la mort d’un jeune surnommé Fofolo sous les balles de la police et les émeutes qui s’ensuivirent. C’est à ce moment que furent créées la « cellule de police Matonge » et l’Association des commerçants, double dispositif mêlant sécurisation et promotion de la « multiculturalité ». Dans les faits, cela a produit une frontière ségrégative entre Matonge et le quartier voisin de Saint-Boniface, plus bourgeois. Les émeutes de 2011-2012, réprimées avec une violence policière massive, ont révélé ce clivage : d’un côté, les manifestant·es congolais·es repoussé·es par gaz lacrymogènes et autopompes ; de l’autre, les consommateurs et consommatrices des terrasses branchées, comme si rien n’était en train de se passer.
La cellule de police, les caméras et les arrestations administratives ont pris le pas sur les politiques d’insertion ou de soutien durable au tissu associatif.
La gestion différenciée des tensions sociales est flagrante. Contrairement aux quartiers maghrébins de Bruxelles qui, après les émeutes des années 1990, ont bénéficié de politiques sociales structurelles, Matonge a surtout reçu une réponse sécuritaire. La cellule de police, les caméras et les arrestations administratives ont pris le pas sur les politiques d’insertion ou de soutien durable au tissu associatif. Cette approche a accentué la marginalisation de la communauté congolaise et afrodescendante, la rendant plus vulnérable face à la spéculation immobilière.
L’éviction des pratiques populaires, comme la vente de safou en rue, illustre une logique d’épuration sociale.
Le processus de gentrification est donc à la fois économique, social et politique. Il repose sur une sécurisation accrue de l’espace, une montée en gamme commerciale et une transformation symbolique visant à effacer la mémoire coloniale. Les vendeuses de rue, comme celles qui vendent le safou2, sont perçues comme incompatibles avec l’image moderne projetée pour la porte de Namur. L’éviction de ces pratiques populaires illustre une logique d’épuration sociale.
Matonge est ainsi pris dans une dynamique de blanchiment urbain, au sens propre et figuré : blanchiment des façades, mais aussi des populations. Très peu d’Afrodescendant·es y vivent encore, chassé·es par la hausse des loyers. À leur place s’installent des classes intermédiaires attirées par l’image d’un quartier « divers », mais pacifié, intégré au circuit de consommation de la Toison d’Or.
Bruxelles face à son passé
L’avenir de Matonge pose une question cruciale : s’agit-il de préserver un espace vivant de mémoire et de diversité, ou de poursuivre son effacement au profit des logiques néolibérales ? Comme l’écrivait le collectif Bruxelles Panthères le 17 juin 2016, l’opération « quartier des Continents » ne vise pas seulement à changer un nom, mais à transformer une urbanité créole et subalterne en une vitrine globalisée, lisse et rentable. Invisibiliser les populations afrodescendantes, c’est aussi invisibiliser les crimes coloniaux et leurs héritages. Le sort de Matonge illustre ainsi le malaise postcolonial de Bruxelles : une ville qui célèbre la diversité tout en la contrôlant, qui affiche la multiculturalité tout en niant l’histoire coloniale via l’éloge de celle-ci dans l’espace public. Car oui, les traces coloniales présentes dans nos rues et sur nos places publiques entretiennent la glorification de la colonisation et donc la négation de la véritable nature de celle-ci. Et ce, au mépris de la dignité humaine des diasporas africaines. Derrière les galeries, les commerces et les murs repeints, il y a des vies, des luttes et des histoires. Les reconnaître, c’est refuser que Matonge disparaisse dans le silence.
Le sort de Matonge illustre le malaise postcolonial de Bruxelles : une ville qui célèbre la diversité tout en la contrôlant.
Si l’histoire nous impose d’examiner le passé colonial qui conduit à l’existence du quartier Matonge, la lutte pour la préservation de la mémoire d’une communauté, de l’âme et l’esprit d’un quartier, n’a rien d’étrangère à l’identité de Bruxelles. Les critiques portées contre les usager·es du quartier Matonge, notamment concernant la lutte qu’ils et elles continuent de mener, ne sont pas sans rappeler la mobilisation historique des habitant·es du quartier des Marolles à l’été 1969, conduite par le curé Jacques Van der Biest, contre la stigmatisation d’un mode de vie à contre-courant des aspirations bourgeoises d’une capitale européenne qui ne veut plus regarder son passé ouvrier, et la réalité des petits boulots qui font vivre et survivre des générations entières.