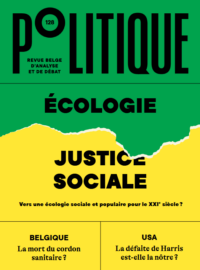Union européenne • Écologie
Pour un Green Deal aussi vert que populaire. Mettre en cohérence les politiques européennes
27.12.2024
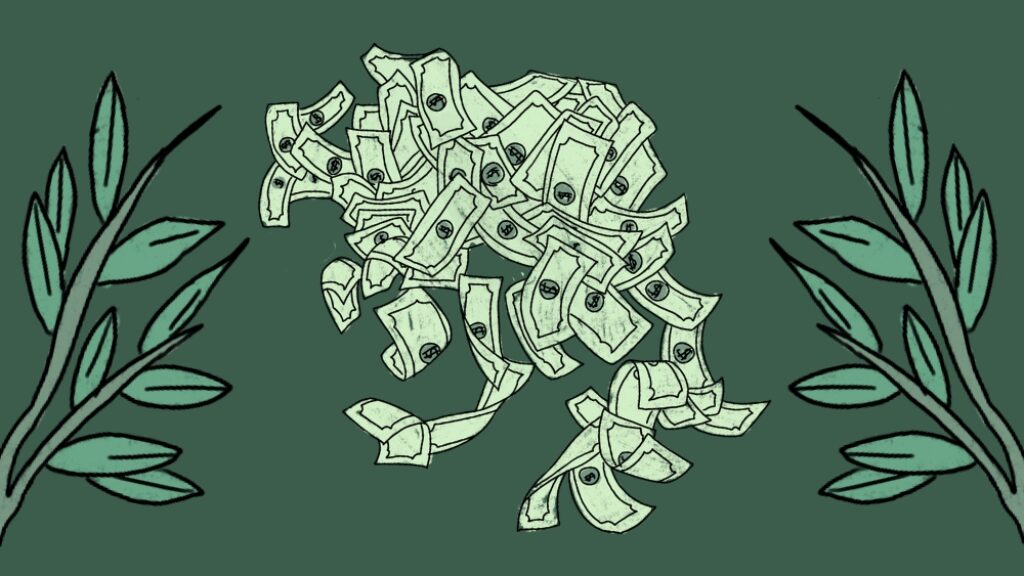
Des ferments existent pour mettre en place une politique européenne écologique, ambitieuse et populaire. Pour réussir, il faut investir et mettre en cohérence les différentes politiques européennes.
D’abord inexistant lors de l’adoption du Pacte vert européen (ou European Green Deal) en 2019, un agenda européen de transition juste a progressivement émergé les années suivantes. Depuis 2020, deux fonds ont ainsi été créés : le Fonds pour la transition juste et le Fonds social pour le climat. Le premier soutient essentiellement les régions dont l’économie sera fortement touchée par la décarbonation, tandis que le second doit permettre d’amortir les effets sociaux négatifs de l’extension du marché des émissions de carbone aux bâtiments et aux transports. Les dimensions verte et sociale sont également au premier plan pour les dépenses de la facilité pour la reprise et la résilience. Et une recommandation du Conseil (qui relève donc certes de règles non contraignantes) met en place la surveillance des politiques nationales de transition juste.
Pourtant, toutes ces initiatives laissent un goût de trop peu face à l’ampleur des enjeux. Au-delà du verre à moitié vide ou à moitié plein, comment comprendre les tensions et les incohérences de l’agenda européen de transition juste ? Après avoir fait un pas en avant, l’Union est-elle condamnée à faire deux pas en arrière dans les années à venir ? Peut-être pas !
La transition juste au risque de la « croissance verte »
À plusieurs égards, le concept et les objectifs de la transition juste semblent avoir fait leur chemin dans l’élaboration de politiques publiques de l’Union. Ursula von der Leyen, tout comme Frans Timmermans, a souvent répété que la transition ne devrait laisser personne de côté (« leave no one behind »). L’impact social de la transition verte n’est donc pas officiellement un impensé du Pacte vert, et les enjeux de légitimité politique en furent explicités dès son lancement.
Au sein du personnel politique et bureaucratique de la Commission et du Parlement européen, des réseaux se sont d’ailleurs mis en place afin de promouvoir des avancées tangibles. Avec le mouvement syndical européen, ainsi que l’aiguillon des ONG spécialisées dans le domaine environnemental et social, sans oublier l’appui d’un champ de recherche dynamique en sciences sociales, des notions telles que « la pauvreté énergétique », ou « la pauvreté en matière de mobilité » ont pu gagner une reconnaissance officielle et être mobilisées pour l’utilisation de fonds européens. Bien plus, la réflexion sur les risques écosociaux est sans doute plus avancée au niveau de l’Union que dans la plupart des États membres.
Au-delà du verre à moitié vide ou à moitié plein, comment comprendre les tensions et les incohérences de l’agende européen de transition juste ?
Pourtant, si on aimerait voir l’Union s’ériger au sommet d’un État écosocial multiniveau, on est encore loin du compte, tant le volet social du Green deal semble fragile. Davantage que de transition juste, les dirigeants européens parlent surtout d’une double transition, numérique et verte, pensée comme le nouveau moteur de la croissance européenne, à grand renfort de technologie.
Le rapport sur l’avenir de la compétitivité européenne, chapeauté par l’ancien banquier central de l’Union, Mario Draghi, reflète ce biais. Il contribuera aussi à l’accentuer, s’il sert effectivement de boussole à la commission von der Leyen II. Le rapport ne contient aucune réflexion sur le lien entre transition écologique et cohésion sociale. L’accent y est mis sur la décarbonation comme facteur de compétitivité, tandis que la cohésion sociale est évoquée de manière superficielle et en creux, exclusivement comme étant dépendante de la compétitivité et de la croissance, et menacée par leur faiblesse.
Union illégitime et fronts antiécologiques
Ces tensions reflètent les contradictions internes qui travaillent l’Union. D’une part, on observe l’émergence relative[1]ment rapide d’une communauté épistémique établissant des connaissances et des concepts sur les risques écosociaux et la nécessité d’y remédier. D’autre part, l’agenda européen de transition pâtit d’un déficit patent de légitimité politique.
L’Union semble bien mal équipée pour affronter l’ampleur des enjeux redistributifs. Alors que le Fonds pour la transition juste comme le Fonds social pour le climat ont fait l’objet de marchandages acharnés entre contributeurs et bénéficiaires nets du budget européen, le fossé est voué à se creuser à l’avenir. Avec l’accélération du changement climatique, le sud du continent ne pourra échapper à l’effondrement et la désertification qu’avec une aide financière massive de ses voisins du Nord.
Quant aux enjeux de stratification et d’intersectionnalité qui tiraillent les sociétés européennes, ils commencent à peine à être abordés. Mais entre des catégories trop étroites (les travailleurs de secteurs industriels hautement carbonés) ou trop larges (tous les citoyens vulnérables), le discours européen peine à définir une cible et à s’adresser à des groupes sociaux qui pourraient constituer une base sociale sur laquelle s’appuyer pour avancer dans la transition juste.
Sur le plan des instruments de politique publique, le Pacte vert s’était appuyé essentiellement sur des outils réglementaires. Or, l’Europe doit s’accompagner d’une Europe des moyens.
Parce qu’elle est trop velléitaire, la politique européenne de transition juste tombe donc sous les coups des oppositions, qui se déploient essentiellement sur trois fronts. En premier lieu, le front capitaliste, celui des dirigeants libéraux et conservateurs qui aimeraient, avec l’idée de « pause » (évoquée par Emmanuel Macron et Alexander De Croo), mettre un coup d’arrêt aux ambitions du Green deal; un deuxième front est celui, populaire, des gilets jaunes et des agriculteurs, qui se sentent sacrifiés sur l’autel de la transition, sans compensation financière effective face aux multiples risques qui les atteignent ; le troisième est le front réactionnaire, emmené par les partis d’extrême droite, qui voient dans le dénigrement systématique de l’écologie un nouveau terrain de jeu pour attiser les angoisses sociales et se hisser au pouvoir.
Les avancées à portée de main
Après un premier élan entre 2020 et 2024, les vents politiques semblent désormais contraires pour creuser le sillon européen de la transition juste. Pourtant, certaines avancées salutaires sont à portée de main. Ainsi, sur le plan de la gouvernance, on voit poindre une intégration des responsabilités portant sur l’économie, l’environnement et le social. À cet égard, la nomination d’un commissaire pour une « transition propre, juste et compétitive » pourrait paraître positive pour l’avenir.
Du point de vue légal et financier, l’Union aurait toutes les cartes en main pour lancer un fonds de soutien aux services d’intérêt général propres et justes en matière de transport, d’énergie, de santé ou de logement.
Sur le plan des instruments de politique publique, le Pacte vert s’était appuyé essentiellement sur des outils réglementaires. Or, l’Europe des normes doit s’accompagner d’une Europe des moyens. Les négociations sur le prochain budget pluriannuel de l’Union (à partir de 2027), qui s’ouvriront l’année prochaine, pourraient être une opportunité de rationaliser les fonds européens, dont beaucoup se recoupent dans le soutien aux objectifs verts et sociaux, prenant alors la forme d’un saupoudrage de moyens.
D’un point de vue légal et financier, l’Union aurait, par exemple, toutes les cartes en main pour lancer un grand fonds de soutien aux services d’intérêt général propres et justes en matière de transport, d’énergie, de santé ou de logement. Une telle initiative aurait d’autant plus de sens que les investissements nationaux seront inévitablement contraints à la modération dans les prochaines années par la réinstauration de règles de discipline fiscale limitant les déficits.
De manière plus fondamentale, les responsables politiques européens, à Bruxelles et dans chaque capitale, doivent réfléchir à la cohérence des politiques européennes. Avancer sur le terrain de la transition verte sans réformer en profondeur les objectifs de la Politique agricole, de la Politique commerciale et de la Politique de concurrence communes est un non-sens, comme le pointent de manière aussi vigoureuse que pertinente les agriculteurs et agricultrices qui se sont encore mobilisés récemment.