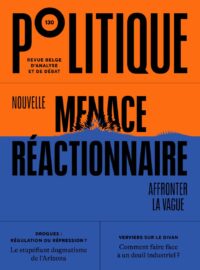Société
Drogues en Belgique. L’herbe est-elle plus verte dans le jardin des voisins ?
15.09.2025

Alors que le gouvernement fédéral belge persiste à mener une politique répressive mortifère et contre-productive en matière de stupéfiants, depuis plusieurs années, d’autres États expérimentent des alternatives au modèle de la « guerre à la drogue ». Dépénalisation des produits et de certains comportements, inscription de cette politique sous l’angle de l’accompagnement social et de l’accès aux soins, projets pilotes de distribution contrôlée d’héroïne, création d’un marché privé du cannabis etc. Petit tour d’horizon de ces expériences innovantes qui devraient inspirer nos autorités, en compagnie de Sandro Cattacin, professeur de sociologie à l’Université de Genève et de Flavia Purdela, sociologue et coordinatrice de la Liaison antiprohibitionniste.
Pour qualifier les politiques alternatives à la « guerre à la drogue », on observe dans la littérature scientifique et les discours militants une diversité de notions, comme la « dépénalisation », la « criminalisation » ou encore la « régulation » et la « libéralisation ». Ces termes sont-ils synonymes ou renvoient-ils à des modèles différents ?
Sandro Cattacin : Effectivement, dans la littérature, ces termes sont parfois utilisés comme synonymes. L’on peut cependant et d’une part, associer les termes « dépénalisation » et « décriminalisation » – ce dernier étant plutôt l’usage en langue anglaise – qui relèvent du vocabulaire juridique et qui traduisent une volonté de limiter, d’une manière ou d’une autre, l’application des lois pénales aux usagers et usagères de stupéfiants et, d’autre part, les notions de « régulation », de « réglementation » ou de « libéralisation » qui, plus politiques, visent quant à elles les questions d’accès aux produits, leur disponibilité sur le marché, les modalités de leur distribution ou de leur vente…
Généralement, les responsables politiques évitent d’employer le terme « libéralisation » perçu comme trop laxiste et privilégient la « régulation » ou la « réglementation ». En pratique cependant et dans le contexte d’une économie capitaliste, aucune « libéralisation » totale n’existe car la vente de tout produit, quel qu’il soit, fait toujours l’objet de règles. Ceci dit, derrière ces étiquettes génériques, il existe toute une série de nuances et de modèles singuliers. On peut plus ou moins dépénaliser en distinguant les produits, les quantités, certains usages ou en substituant les sanctions administratives aux peines pénales. Et s’agissant des modèles de régulation, là aussi, on constate une diversité de politiques, certaines privilégiant un accès médical aux produits quand d’autres reposent sur l’encadrement d’un marché privé (par exemple en matière de cannabis dans plusieurs États des États-Unis d’Amérique).
Flavia Purdela : On note parfois une nuance entre la « dépénalisation » qui est limitée à une diminution de la sévérité des peines prévues pour les comportements liés aux stupéfiants (consommation, possession, culture, …) d’une part et la « décriminalisation » qui, elle, renvoie à la suppression de toute sanction pénale pour ces mêmes comportements d’autre part. Attention, même dans un régime reposant sur la « décriminalisation », les substances et leur consommation ou possession peuvent rester illégales ; simplement, on ne leur appliquera plus une sanction pénale. Dans un système de « régulation », ces produits sont légalisés et une série de règles encadre la culture, la fabrication, le transport, la teneur, le prix, la commercialisation ou encore la disponibilité de certaines drogues.
Peut-on exemplifier ces notions en pointant certaines expériences emblématiques menées dans différents États ?
FP : L’International Drug Policy Consortium, vaste réseau mondial qui rassemble plus de 190 partenaires associatifs militant pour une approche non pénale des stupéfiants, a recensé une trentaine d’expériences nationales de décriminalisation.1 Un exemple de décriminalisation assez net est celui du Portugal qui, depuis 2001, vise tous les stupéfiants sans exception mais en prévoyant, à titre indicatif, des quantités autorisées, produit par produit (25 grammes de cannabis, 2 grammes de cocaïne, 1 gramme d’héroïne…) qui sont présumées renvoyer à une consommation personnelle. Au-delà de ces quantités, des poursuites pénales sont possibles ; en deçà, seule une amende administrative mais surtout une recommandation de prise en charge thérapeutique peuvent être prononcées.
Attention aussi aux décriminalisations en trompe-l’œil. Ainsi, en Russie, depuis 2004, le Code pénal a été modifié pour en théorie dépénaliser l’ensemble des stupéfiants. Mais les quantités autorisées sont très faibles (2 grammes de cannabis ou 0,5 gramme de cocaïne, par exemple) et l’arbitraire de la police ainsi que la sévérité des magistrats font que les prisons russes demeurent peuplées de consommateur·icess de stupéfiants (ainsi, on estime à plus de 100 000 le nombre de condamnations pénales prononcées chaque année pour simple possession ou consommation).
La seule modification des textes légaux sera insuffisante, il est donc tout aussi décisif de sensibiliser les institutions policières et judiciaires aux effets pervers de la « guerre à la drogue » et aux bénéfices que présentent les alternatives moins répressives.
SC : L’exemple du Portugal est en effet parlant car il témoigne d’une approche médicale à la consommation des stupéfiants envisagée comme un problème de santé publique. Quand une personne consommatrice de stupéfiant est contrôlée au Portugal, elle est invitée à contacter une « commission de dissuasion » de la dépendance aux drogues qui lui proposera un suivi thérapeutique. Après, le fait de ne pas entamer une telle démarche n’emporte en pratique aucune sanction mais la personne fait l’objet d’un enregistrement policier et demeure dans des banques de données. Mais insistons : seule la possession d’une quantité déterminée est dépénalisée ; la production et la vente demeurent interdites et pénalement sanctionnées.
FP : Le modèle portugais qui envisage l’usager·e comme une personne malade à ce titre enregistrée est d’ailleurs fort critiqué par les associations de terrain… Aussi, il reste possible de sanctionner administrativement, par une amende, une personne qui persisterait dans son refus de solliciter les commissions de dissuasion. On notera qu’en République tchèque, pays qui a également initié, dès 1990, une politique de dépénalisation de tous les produits sur la base de quantités autorisées, ce type d’injonction ou de recommandation thérapeutique n’existe pas mais l’État a massivement investi dans les services de réduction des risques et dans l’accompagnement social et sanitaire des usager·es. Cette politique a permis de diminuer, de façon spectaculaire, le taux d’infection au VIH (parmi l’un des plus bas d’Europe) des personnes qui s’injectent des produits psychotropes.
SC : On peut comparer le modèle portugais avec celui de la Suisse où la « dépénalisation » est aussi et largement acceptée socialement et politiquement. Par contre, il n’est pas question d’envisager les consommateur·trices d’abord comme des personnes malades ou marginales, car la consommation relève de l’autonomie ou de l’hygiène personnelles et participe du bien-être individuel. La prise en charge médicale est donc volontaire et procède d’un choix conscient. La politique suisse est sur ce point pragmatique : le cannabis, massivement consommé et entré dans les mœurs, a fait l’objet d’une dépénalisation nationale. Pour le moment, des débats ont lieu au Parlement fédéral pour envisager un système de vente contrôlée du cannabis à la suite de projets pilotes menés dans sept villes. C’est d’ailleurs le cadre légal qui a évolué, systématiquement par des expérimentations en milieu urbain, depuis la crise de l’héroïne durant les années 1980.
Ces expérimentations et leur évaluation ont permis l’introduction d’une politique de réduction de risque, un accès contrôlé à l’héroïne ou encore la mise ne place de salles de consommation. Ces politiques ont permis d’agir en anticipation sur l’arrivé de nouvelles substances comme le fentanyl. Un autre exemple est le Crack qui, par exemple, à Genève, a donné lieu à l’installation d’infrastructures de réduction de risque.2
Dans d’autres villes, par exemple à Zurich ou à Bâle, à proximité de ces salles de consommation à moindre risque, des projets pilotes de zones de tolérance pour le micro-deal, où la police n’intervient pas, sont actuellement en cours et offrent déjà des résultats probants en termes de sécurité publique et de diminution des nuisances liées au trafic. On peut également mentionner l’existence dans plusieurs cantons des programmes de préscription d’héroïne, sous contrôle médical et financés par l’État (et qui se prolonge même jusque dans les maisons de repos) ou encore des recherche sur les thérapies utilisant des psychédéliques. Le fédéralisme offre sur ce point plus de souplesse car il permet plus facilement d’expérimenter des projets pilotes initiés par les entités décentrées et autonomes.
Le droit pénal n’est jamais une réponse adaptée aux questions sociales et sociétales.
FP : En Belgique, on en est encore loin (rires) ! J’ai plutôt le sentiment qu’actuellement, notre système fédéral constitue un obstacle, notamment dans l’organisation d’un lobby national autour de cette question ou la structuration, par-delà la frontière linguistique, d’un réseau de consommateurs et consommatrices unifié.
Justement, est-ce que les consommateurs et consommatrices sont parties prenantes des expériences pilotes menées dans les pays que vous venez d’évoquer ?
FP : En tout cas, si l’on revient sur les États qui ont procédé à une dépénalisation sur la base de quantités autorisées, l’on note que la plupart du temps, ces quantités ne renvoient pas aux habitudes de consommation des usager·es qui n’ont pas été associé·es à la réflexion ; en résulte un décalage problématique entre le terrain et ce que prévoient les textes. En Belgique, la parole des usager·es est aujourd’hui limitée à quelques groupes de paroles mis en place par certaines associations de terrain. Mais leurs réflexions ne se situent pas au niveau des politiques publiques ou pénales… Cependant, les choses pourraient évoluer à l’avenir : à Bruxelles, des discussions sont actuellement en cours au sein du réseau et avec les consommateurs et consommatrices en vue de faire émerger un groupe d’usager·es de drogues qui serait indépendant de toute institution ou service.3
SC : Je peux mettre en évidence le plan crack mis en place par le Canton de Genève qui a très largement reposé sur la prise en compte des besoins et des attentes des consommateurs et consommatrices. Je dois sur ce point souligner l’excellent travail de l’association Addiction Suisse4 qui a multiplié les rencontres avec les usager·es de crack dont les fruits ont alimenté l’élaboration de ce plan. De façon plus générale, l’un des avantages des politiques de dépénalisation, et plus encore de régulation, est en quelque sorte de permettre une libération de la parole des usager·es. En Suisse, on constate la multiplication de groupes d’usager·es qui réfléchissent ensemble à leur consommation, qui font preuve de solidarité et de réflexivité… On constate que la dépénalisation permet ainsi l’émergence de mobilisations a priori impossibles car portées par des personnes au départ stigmatisées et peu prises en considération.
Quels sont les réseaux qui au niveau international militent pour le développement de ces modèles alternatifs au « tout répressif » ?
FP : J’ai déjà évoqué l’International Drug Policy Consortium qui est sans aucun doute le réseau international non gouvernemental le plus actif sur cette question. Au Royaume-Uni, on peut citer la Transform Drug Policy Foundation5 qui milite pour une régulation de toutes les drogues. En Belgique, au-delà des services de première ligne qui peuvent être plus ou moins sensibles au développement de modèles alternatifs mais qui n’ont pas nécessairement ni les moyens, ni les ressources pour réellement militer sur ce sujet, il y a bien entendu La Liaison du côté francophone qui milite sur ce sujet depuis sa création en 1989 et l’association Smart on Drugs du côté flamand qui fut, elle, fondée en 2018.6 Mais l’une des évolutions les plus spectaculaires observées ces dernières années est qu’au sein même des Nations Unies qui sont à l’origine des principales conventions qui charpentent la politique répressive menée au niveau mondial, on note des voix discordantes et des appels de plus en plus insistants à une politique alternative…
SC : En 2011 a été constitué la Global Commission on Drug Policy7 à l’initiative de plusieurs personnalités politiques éminentes, dont d’anciens responsables des Nations Unies comme Kofi Annan ou Louise Arbour ou chef·fes d’État, comme la Néo-zélandaise Helen Clark, le Chilien Ricardo Lagos ou la suissesse Ruth Dreifuss. Ce groupe plaide explicitement pour la remise en question des conventions onusiennes qui obligent les États à adopter une politique répressive vis-à-vis des drogues et pour un changement de paradigme passant par une dépénalisation généralisée des stupéfiants. La légitimité de ce groupe est très importante puisque ces personnalités politiques peuvent dire qu’elles ont expérimenté la « guerre à la drogue » et qu’elles l’ont définitivement perdue…
On notera aussi au niveau du Conseil de l’Europe le Groupe Pompidou8 qui a été fondé en 1971 et qui historiquement, visait à promouvoir la coopération des États membres en matière de lutte contre le trafic international de stupéfiants mais qui infléchit progressivement sa position et milite actuellement pour que les droits humains soient au cœur des politiques publiques en la matière. Enfin, on ne doit pas négliger le rôle de la société civile et des milieux académiques. Par exemple en Suisse, le think tank Penser la Suisse9 dont je suis actuellement le vice-président et qui rassemble plusieurs professeur·es de sciences sociales et humaines a été très actif sur la question du cannabis et j’ai la faiblesse de croire que les deux ouvrages10 que ce think tank a édités sur cette question a aussi influencé l’évolution de la politique suisse.
Le 21 mars dernier, à l’Assemblée nationale française, Marine Le Pen déclarait que « tous les pays qui ont légalisé le cannabis sont revenus sur leur décision ».11 Cette affirmation est-elle vraie ?
FP : C’est faux. À ma connaissance, seuls deux territoires sont revenus en arrière après avoir expérimenté un modèle alternatif. L’Oregon a initié une politique de dépénalisation de toutes les drogues en 2021 mais n’a pas accompagné cette initiative d’un renforcement des services sociaux et sanitaires. Avec la pandémie de covid 19 et la crise du fentanyl, la consommation notamment de rue a explosé et les autorités sont revenues en arrière. En Colombie-Britannique, au Canada, les autorités qui avaient expérimenté une politique de production contrôlée de produits stimulants sont revenues en arrière sur la pression de la population qui s’est droitisée sur cette question. Mais il s’agit des deux seuls exemples.
Plus généralement, la possibilité ou non de revenir en arrière est notamment fonction des modalités juridiques qui encadrent ces alternatives : si celles-ci sont inscrites dans la loi, elles présentent une certaine stabilité et sont davantage à l’abri de réformes, par exemple en cas de changement de majorité politique.
SC : Et en Suisse, quand ces alternatives sont le produit d’une votation populaire, il est évidemment très compliqué de revenir en arrière ! Ce que montre l’exemple de l’Oregon ou d’autres États américains, par opposition au modèle canadien, c’est qu’une politique de régulation qui repose uniquement sur la création d’un marché privé n’est pas souhaitable : un modèle commercial agressif qui envisage les psychotropes comme n’importe quel produit peut aboutir à une augmentation de la consommation ce qui n’est évidemment pas le but recherché. En Suisse, le projet en cours d’une vente contrôlée de cannabis intègre cette donnée et prévoit, à ce stade, la création d’un marché particulier où, par exemple, la publicité ne sera pas autorisée, où les produits dérivés et attractifs, notamment aux yeux des jeunes (bonbons ou boissons au cannabis), seront interdits…
En Belgique, la Liaison antiprohibitionniste a-t-elle un modèle alternatif privilégié ? Quel serait à ses yeux le modèle étranger le plus intéressant ?
FP : Le point de départ de toute réflexion menée par La Liaison est que le droit pénal n’est jamais une réponse adaptée aux questions sociales et sociétales. Cela vaut pour les stupéfiants mais aussi pour d’autres questions, comme celle du travail du sexe, par exemple. Donc, La Liaison plaide pour une décriminalisation totale de toutes les drogues. Mais cela ne suffira pas… Et donc, à terme, nous plaidons pour un modèle de vente régulée des produits et soutenons par principe toute initiative en ce sens. Nous militons ainsi pour une approche pragmatique du phénomène, qui colle aux réalités de terrain et qui se départit de toute considération morale ou idéologique.
Mais attention, toute réflexion doit à nos yeux intégrer le point de vue des usager·es: « Nothing about us without us » est ainsi notre mot d’ordre. En outre, toute dépénalisation doit s’accompagner, comme en République tchèque, d’un soutien renforcé aux services sociaux et sanitaires mais sans verser dans le paternalisme et l’injonction aux soins comme c’est le cas au Portugal. Enfin, sachant que la seule modification des textes légaux sera insuffisante, il est tout aussi décisif de sensibiliser les institutions policières et judiciaires aux effets pervers de la « guerre à la drogue » et aux bénéfices, notamment en matière de sécurité publique, que présentent les alternatives moins répressives.
Propos recueillis par Julien Pieret