Politique
Un état en mutation depuis 50 ans
01.04.2022
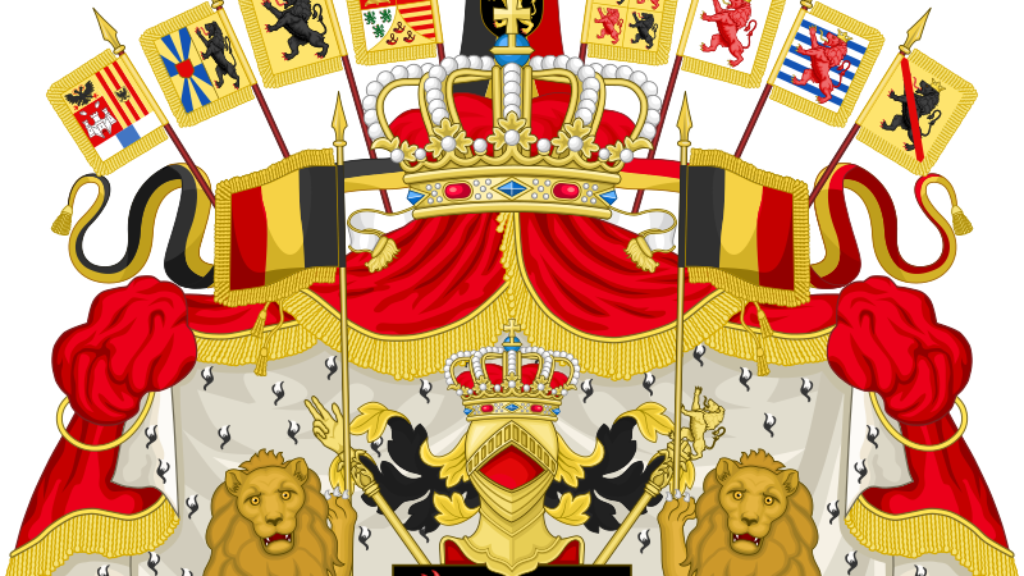

1930. Malgré la crise économique qui commence à toucher le pays, le centenaire de la Belgique est célébré avec faste dans toutes les communes du Royaume. En outre, une grande exposition internationale présente au monde les réalisations du petit État à l’existence jugée improbable par bien des contemporains lors de sa fondation un siècle plus tôt. L’exposition du centenaire de l’indépendance nationale est organisée sur deux sites : à Liège se déroule l’exposition internationale de la grande industrie, des sciences et applications, et de l’art wallon ancien, tandis qu’à Anvers se tient l’exposition internationale coloniale, maritime et d’art flamand. Ce partage en deux lieux, décidé par le gouvernement en 1926, constitue l’une des premières reconnaissances symboliques de l’existence de deux grandes communautés dans le pays, et contraste avec le choix qui avait été fait en 1880 de célébrer le cinquantenaire principalement dans la capitale, en un lieu qui en a conservé le nom.
Dans dix ans, que fera-t-on pour commémorer le bicentenaire de la Belgique ? Hormis l’annonce de la création, en 2016, d’une fondation Belgæ Patria par des « descendants des fondateurs du pays » afin de préparer dignement la célébration de cet anniversaire, mais dont on n’a guère de nouvelles depuis[1.www.lalibre.be, 15 novembre 2016. Le site www.1830-2030.be créé à l’époque ne semble plus accessible.], rien ne semble annoncer de grandioses préparatifs. Et pour cause. Dans une Belgique qui se cherche en vain un gouvernement majoritaire et un tant soit peu stable depuis plus de 600 jours, l’incertitude quant à l’avenir du pays est palpable.
Cette coexistence de deux communautés linguistiques – certains diront de deux peuples –, au sein d’un même État, qui selon Jules Destrée n’ont de Belges que le nom, a fini par plonger le pays dans un processus de réforme institutionnelle sans fin. « A fini » car la bourgeoisie francophone a retardé la reconnaissance des droits des classes inférieures et des Flamands (les deux se recoupant pour une large part de la population), renforçant ainsi la détermination autonomiste de ceux qui, en Flandre, ne se sentaient pas les bienvenus dans le cadre belge : songeons que la traduction officielle en néerlandais de la Constitution n’a été promulguée qu’en 1967…
Ce n’est qu’au terme d’un siècle de lutte que le mouvement flamand a atteint une partie de ses objectifs. Un mouvement flamand dont Xavier Mabille écrivait à propos du développement à la fin des années 1850 : « Délibérément ou non, consciemment ou non, l’action et les positions du mouvement flamand étaient une mise en cause de la politique de centralisation, tandis que, délibérément ou non, consciemment ou non, les positions du gouvernement de l’époque en constituaient une défense .[2.X. Mabille, Nouvelle histoire politique de la Belgique, Bruxelles, Crisp, 2011, p. 141.] »
Avec le recul, l’histoire institutionnelle de la Belgique apparaît en effet d’abord comme le produit des revendications flamandes et des compromis conclus avec la minorité francophone qui a adopté une posture de résistance. Le mouvement wallon, dont l’essor est plus récent et dont les revendications se sont émoussées après la crise économique des années 1970, ou les revendications germanophones, voire bruxelloises, plus récentes, bien qu’elles ne soient pas négligeables, n’ont pas joué le rôle moteur du mouvement flamand – ou pas de manière aussi continue. Ayant été politiquement dominée pendant 150 ans, la majorité flamande du pays a néanmoins conservé les attitudes d’une minorité persécutée, déterminée à faire valoir ses droits. Quelle que soit la portée des accords conclus en termes de réforme institutionnelle, il semble qu’il y ait toujours un « après », un approfondissement du processus dont on peut aujourd’hui légitimement se demander s’il s’arrêtera avant le démantèlement pur et simple de la Belgique.
1950-1960, un pays deux fois fracturé
La Première Guerre mondiale joue un rôle ambivalent pour le mouvement flamand. Tandis qu’elle permet l’affirmation de celui-ci, tant dans les rangs de l’armée belge que, différemment, dans le cadre de la politique menée par l’occupant allemand, et qu’en résulte la création du premier parti portant des revendications autonomistes (le Frontpartij), elle jette aussi le discrédit sur une partie de ce mouvement, considéré comme traître à la patrie belge. Néanmoins, durant les années 1930, une série de lois sur l’emploi des langues consacrent progressivement l’unilinguisme en Flandre et en Wallonie : en matière administrative et dans l’enseignement (1932), en matière judiciaire (1935), et à l’armée (1938).
Après la Seconde Guerre mondiale, le combat pour l’égalité de la langue néerlandaise se mue graduellement en une lutte pour l’autonomie des Flamands. Des congrès wallons visent aussi à obtenir une autonomie, pour des motifs davantage socio-économiques. Si, dès 1948, est créé le Centre Harmel, ses travaux, et en particulier son rapport final, publié en 1958, ne déboucheront pas immédiatement sur des réformes : les énergies sont alors mobilisées par la question scolaire, dans ce qui apparaît rétrospectivement comme la dernière grande crise politique engendrée par le clivage philosophique. Il faut attendre encore une décennie pour que la réforme de l’État revienne de façon décisive à l’agenda politique.
Les premières années d’après-guerre sont aussi marquées par deux autres moments majeurs de tension : la Question royale, qui met le pays au bord de la guerre civile[3.L’expression est choisie à dessein, tous les résistants n’ayant pas rendu leurs armes cinq ans auparavant…] ; la « grève du siècle », à l’hiver 1960-61, qui paralyse le pays et fait tomber le gouvernement, sans toutefois parvenir à empêcher l’adoption des réformes contestées. Ces deux épisodes font apparaître une fracture importante entre la Flandre et la Wallonie, Bruxelles se rapprochant davantage de cette dernière en termes politiques. Notons qu’ils mettent au moins autant en opposition les zones où la classe ouvrière est politiquement organisée (Anvers, Gand, les zones industrielles des provinces de Hainaut ou de Liège) et les zones plus conservatrices du pays (généralement plus rurales).
1962, la frontière linguistique, une matrice
Très rapidement après, la question communautaire, qui est encore vue plutôt sous l’angle d’une « question linguistique », va produire une législation linguistique et administrative qui, rétrospectivement, apparaît comme le canevas sur lequel vont se déployer les futures institutions réformées. Préalablement, sous la pression d’un mouvement flamand qui connaît un renouveau[4. Cf. G. Deneckere, B. De Wever, « Le mouvement flamand dans la rue : un mouvement de masse ? », in J. Faniel, C. Gobin, D. Paternotte, Se mobiliser en Belgique. Raisons, cadres et formes de la contestation sociale contemporaine, Louvain-la-Neuve, Academia-L’Harmattan, 2020, p. 228-230.], le volet linguistique du recensement décennal a été abandonné. L’agglomération bruxelloise ne s’étendra plus au-delà des 19 communes, une extension atteinte en 1954 en application des résultats du recensement de 1947. En 1963, la volonté du Premier ministre, Theo Lefèvre (PSC), de rattacher à Bruxelles six communes de la périphérie où la population francophone est importante se heurte à un veto flamand catégorique. En conclave à Val Duchesse (déjà…), les francophones cèdent aux exigences flamandes. Pour préserver l’unité du pays, sans doute, mais aussi parce que, pour la majorité d’entre eux – les Wallons –, les frontières de Bruxelles ne valent pas une crise politique ; cette attitude se répétera plus tard[5.Sur les rapports, complexes, entre mouvement wallon et mouvement bruxellois, cf. C. Kesteloot, « De la liberté linguistique au fédéralisme : les débuts du FDF », in V. Dujardin, V. Delcorps, FDF 50 ans d’engagement politique, Bruxelles, Racine, 2014, p. 51-64.]. À la même période, une loi crée deux instituts de radiotélévision autonomes[6. Loi organique des instituts de radio-télévision belge du 18 mai 1960 (Moniteur belge, 21 mai 1960).], premier pas vers l’autonomie culturelle des deux Communautés. L’unilinguisme de la Flandre et de la Wallonie, le bilinguisme de l’agglomération bruxelloise limitée à 19 communes, le tracé de la frontière linguistique et la liste des communes à facilités sont arrêtés en 1962-63. Ces éléments ne bougeront plus. Sans doute leur importance cruciale pour l’avenir n’a-t‑elle pas été clairement perçue par les contemporains.
1968, ça se passe à Louvain
En 1968, tous les regards sont tournés vers Paris. Sauf en Flandre, où l’on regarde surtout vers Louvain. Après plusieurs années d’agitation, la volonté flamande de généraliser l’usage du néerlandais dans l’université convainc les évêques flamands de la nécessité de déplacer la section francophone et déchire le Parti social-chrétien (PSC-CVP). Le gouvernement social-chrétien/libéral de Paul Vanden Boeynants est le premier d’une longue série à tomber sur un conflit communautaire. Dans un contexte marqué par l’émergence de la Volksunie (VU), tous les acteurs politiques flamands s’unissent autour de la revendication de flamandisation de l’université de Louvain. Toujours en 1968 est fondé le Rassemblement wallon (RW), dont le premier objectif est de « stopper la marée flamande et sa volonté de domination » : on est dans une attitude de réaction plus que de revendication propre.
Tandis que le PSC-CVP est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-71 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral.
1970, l’entame du processus
La Constitution, qui depuis son adoption en 1831 n’a guère été modifiée que pour élargir le droit au suffrage, va entrer dans un processus de réforme dont on ne soupçonne pas alors qu’il va en fait devenir semi-permanent. Dans un contexte où la balance économique entre les Régions vient de s’inverser au profit de la Flandre, les Wallons s’inquiètent d’une politique économique menée au niveau national qui ne correspond pas aux besoins de leur région dont l’outil industriel est vieillissant, tandis que les Flamands poursuivent leur entreprise de réhabilitation de la langue néerlandaise au sein de l’État et réclament l’autonomie culturelle qui leur permettra de lui donner sa juste place. C’est le gouvernement Eyskens IV qui est à la manœuvre, présentant au Parlement le résultat de longues négociations entre les partenaires sociaux-chrétiens et socialistes de la coalition. Dans un premier temps, c’est la revendication culturelle flamande qui est prise en compte, puisque sont créées les Communautés culturelles française et néerlandaise, qui jouissent de compétences en matière culturelle et en ce qui concerne l’emploi des langues.
De façon non moins importante pour l’avenir, l’organisation du Parlement et du gouvernement (national) sont également modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés linguistiques : les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, et certaines lois dites spéciales devront désormais recevoir la majorité dans chacun de ces groupes pour être adoptées (tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat et en plus des deux tiers dans chaque assemblée) ; la procédure de la sonnette d’alarme est également instituée, ainsi que la parité linguistique au sein du Conseil des ministres. Cette première réforme de l’État consacre dans les faits le face-à-face des Flamands et des francophones. Il faut d’ailleurs attendre trois ans de plus pour que naisse une troisième entité : la Communauté culturelle allemande.
Bien que la création des Régions soit prévue à l’article 107quater de la Constitution, elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Il faut attendre la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove, pour voir apparaître trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement (national).
1978, l’échec du Pacte d’Egmont et des Accords du Stuyvenberg
Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977) qui, complété par les Accords du Stuyvenberg (1978), aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. Ce Pacte avait été négocié par le formateur du gouvernement, Leo Tindemans (CVP), qui avait arraché un accord institutionnel aux présidents des partis de la future majorité, en ce compris ceux du FDF et de la VU. Toutefois, cette dernière n’est pas unanime à appuyer la position de son président, Hugo Schiltz. Le mouvement flamand est bientôt vent debout contre les concessions faites aux francophones de la périphérie et, sous la pression du Comité anti-Egmont créé pour l’occasion au sein de ce mouvement ou davantage en raison de calculs politiques[7. G. Deneckere, B. De Wever, op. cit., p. 232.], L. Tindemans choisit de démissionner. Si, depuis 2007, il est surtout devenu difficile de former un gouvernement, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, il était compliqué de le maintenir en selle.
À côté de la problématique des francophones de la périphérie, et de celle des Fourons, la difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.
1980, les décrets ont force de loi
C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le troisième gouvernement dirigé par Wilfried Martens (CVP), unissant sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux (francophones et flamands dans chaque cas) et disposant d’une majorité des deux tiers dans les deux chambres, va réussir à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État.
Le CVP, alors premier parti flamand, compte un nombre important de militants du mouvement flamand ; en outre, l’action de la VU attise sa détermination communautaire. Du côté francophone, c’est le PS, lui aussi dominant dans son espace électoral, qui, de toutes les familles politiques traditionnelles, porte le plus la revendication régionaliste ; ses liens avec la FGTB wallonne renforcent la tendance régionaliste en son sein. CVP (puis CD&V) et PS ont été au centre de toutes les réformes de l’État.
Celle de 1980 organise les Régions flamande et wallonne, ainsi que leurs institutions ; elle laisse toutefois la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Elle organise également les Communautés, qui ne s’appellent plus culturelles, mais sont rebaptisées Communauté flamande, française et germanophone. Les parlements (qu’on appelle alors les conseils) sont composés de membres de la Chambre des représentants et du Sénat (sauf à Eupen), alors que les gouvernements des Communautés et des Régions (appelés à cette époque exécutifs) sont constitués de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national.
Les compétences des Communautés et des Régions sont définies par la loi spéciale du 8 août 1980 qui demeure, aujourd’hui encore, la pierre d’angle de l’architecture institutionnelle de la Belgique.
C’est en 1980 que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques du futur État fédéral : le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets (l’une ne prime pas les autres), la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions avec la fusion des organes et budgets de la Communauté et de la Région flamandes, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux entités fédérées.
1988-89, la Région bruxelloise sort du frigo
Déjà traversé de fortes tensions, et ayant fait face à une opposition syndicale vigoureuse (surtout de la part de la FGTB), le gouvernement Martens VI (sociaux-chrétiens/libéraux) tombe à son tour sur une question linguistique : Fourons. Le gouvernement Martens VIII (CVP/PS/SP/PSC/VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui était alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Elle est préparée par celui qui succèdera plus tard à W. Martens, Jean-Luc Dehaene (CVP).
Cette troisième réforme de l’État règle certaines questions à caractère linguistique, notamment en matière électorale, pour les « abcès de fixation communautaire » que représentent Fourons ainsi que les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise (et, dans une moindre mesure, Comines-Warneton) : on parle de « loi de pacification communautaire ».
Autre volet important de cette phase de réforme, des compétences importantes sont transférées aux Régions et aux Communautés, en particulier l’enseignement. Quelques années plus tôt, le PSC avait recalé cette réforme, craignant pour l’enseignement catholique francophone ; la modification de la Constitution pour y intégrer l’esprit du Pacte scolaire de 1958 lèvera cette réticence. Ce transfert gonfle considérablement le budget de chaque Communauté. Les francophones découvriront quelques années plus tard qu’ils ont bien mal négocié la loi spéciale de financement, qui les mettra aux abois face à de nouvelles demandes flamandes. Quant à elles, les Régions flamande et wallonne héritent en particulier des « secteurs nationaux » (charbonnages, construction et réparation navales, verre creux d’emballage, textile et sidérurgie). Il s’agit certes de secteurs où le mouvement wallon, à caractère plus économique, souhaitait pouvoir mener une politique autonome. Ce transfert résulte aussi du refus flamand de continuer à payer pour les secteurs industriels wallons en perte de vitesse, exprimé non seulement par des figures politiques importantes (Luc Van den Brande, CVP, qui sera ultérieurement ministre-président flamand), mais aussi par une partie de l’opinion publique, y compris dans les rangs de la démocratie-chrétienne.
Enfin, l’architecture institutionnelle prend alors quasiment son caractère actuel. En échange de la création des institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, les francophones acceptent la surreprésentation des néerlandophones au sein de celles-ci. La troisième Région du pays est dotée d’une assemblée parlementaire élue dès 1989 au suffrage universel, dont les membres sont répartis en deux groupes linguistiques, et d’un organe exécutif paritaire. Trois commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : la Commission communautaire française – Cocof, la Commission communautaire flamande – VGC, et la Commission communautaire commune – Cocom.
Si les termes officiels ne le disent pas, il devient clair pour beaucoup que la Belgique a désormais basculé vers un système fédéral, articulant une autorité nationale, des Communautés et des Régions disposant chacune d’une large autonomie.
1993, une nouvelle Belgique est née
La réforme de 1988-89 devait connaître des prolongements. Ils seront mis en œuvre au terme d’un dialogue de Communauté à Communauté, organisé par le premier gouvernement Dehaene (CVP/PS/SP/PSC). Reflet de la difficulté de conclure désormais des compromis ? C’est le moment où les accords institutionnels prennent le nom du saint du jour où ils ont été conclus.
L’accord dit de la St-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L’accord de la St-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre le PS, le PSC et Écolo, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes institutions francophones. En proie à des difficultés financières, la Communauté française pourra transférer l’exercice de la compétence – mais pas la totalité du budget correspondant – à la Région wallonne, d’une part (qui ne l’exercera que sur la partie francophone de son territoire, pas en région de langue allemande), et à la Cocof, d’autre part (qui ne l’exercera que sur les institutions francophones présentes à Bruxelles, pas sur les institutions néerlandophones ou bilingues), essentiellement dans des matières de nature culturelle ou personnalisable. Il a été fait un grand usage de ces transferts, ce qui a accru l’asymétrie entre entités apparue dès 1980.
La quatrième réforme de l’État proclame officiellement le caractère fédéral de la Belgique, que l’article premier de la Constitution définit désormais comme « un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». Cette révision constitutionnelle s’accompagne d’une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l’impression qu’une nouvelle Belgique est née. Désormais, les députés flamands et les députés wallons sont aussi élus directement ; seule l’assemblée de la Communauté française est composée de manière uniquement indirecte. Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat et le nombre de députés fédéraux et de sénateurs ; le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.
Aboutissement d’une volonté de clarification du territoire en trois Régions unilingues (allemande, française et néerlandaise) et d’une Région (bruxelloise) bilingue, la province de Brabant est scindée en deux au 1er janvier 1995 ; le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n’appartient désormais plus à aucune province. Dans certains domaines toutefois (électoral ou judiciaire), le maintien au sein de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde des 19 communes bruxelloises et de 35 communes du Brabant flamand (dont 6 à facilités) continuera à faire parler de lui.
La réforme institutionnelle de 1993 est bouclée sur un malentendu. Du côté francophone, il est largement entendu que cette réforme donne son visage définitif à la Belgique : pour preuve, l’intitulé des deux lois du 16 juillet 1993 « visant à achever la structure fédérale de l’État ». Du côté flamand, c’est beaucoup moins net. Reflétant une opinion largement répandue en Flandre, J.-L. Dehaene déclare à plusieurs reprises que « le fédéralisme est un processus évolutif par définition ». La volonté d’obtenir une autonomie accrue – voire l’indépendance – subsiste au sein d’une frange importante de la classe politique flamande. En 1999, le Parlement flamand adopte cinq résolutions pour l’avènement d’une Belgique qu’on pourrait qualifier de confédérale[8. Sur ces résolutions, cf. G. Pagano, « Les résolutions du Parlement flamand pour une réforme de l’État », Courrier hebdomadaire, Crisp, n° 1670-1671, 2000.]. Devant le refus francophone d’approfondir les compétences communautaires et régionales, les Flamands vont s’attacher à obtenir la correction de ce qu’ils considèrent être des anomalies dans le dispositif existant : les communes à facilités et l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
2001, rien n’est achevé
En 1989-90 puis en 1994-96, les mobilisations des enseignants et des étudiants contre les économies pratiquées par la Communauté française butent sur le refus du monde politique francophone de retourner négocier avec les partis flamands un meilleur financement de cette institution, de peur que ceux-ci n’exigent en échange de nouveaux transferts de compétences. Échaudés par les résolutions du Parlement flamand de 1999 qui les confortent dans leur position, les partis francophones ne veulent pas entendre parler de réformes institutionnelles quand le premier gouvernement Verhofstadt (libéraux/socialistes/écologistes) est mis en place en 1999. Par ailleurs, l’absence des sociaux-chrétiens permet de mettre à l’agenda d’autres dossiers (éthiques, en particulier). Toutefois, l’institutionnel ne peut être complètement mis au frigo, et une cinquième réforme de l’État sera réalisée, la plus modeste sans doute, opérée sans toucher à la Constitution mais en modifiant uniquement des lois et lois spéciales.
Les accords du Lambermont, conclus le 16 octobre 2000 et le 23 janvier 2001, organisent le transfert aux Régions de compétences en matière d’agriculture, de commerce extérieur et de pouvoirs locaux (en ce comprises la loi communale et la loi provinciale). La réforme prévoit également un refinancement des Communautés et une augmentation de l’autonomie fiscale des Régions. En outre, l’organisation et le fonctionnement des institutions bruxelloises sont modifiés en application de l’accord du Lombard, conclu le 29 avril 2001, qui conforte la représentation garantie des néerlandophones dans la Région bruxelloise.
Dans la foulée de cette réforme, en 2002, les circonscriptions électorales sont redessinées : elles correspondent désormais aux limites provinciales à la notable exception de celle de Bruxelles-Hal-Vilvorde. La scission de cette circonscription devient une revendication flamande de premier plan, appuyée par des mobilisations de la société civile, qui va peser sur la vie politique des années 2000 et conduire à la sixième réforme de l’État.
2010, le blocage
Cette question cause d’abord l’échec d’un autre accord institutionnel sous le gouvernement Verhofstadt II (2003-2007). Elle complique ensuite la formation d’un gouvernement par Yves Leterme en 2007 après avoir donné un succès électoral historique au cartel que son parti, le CD&V, a formé avec la petite N-VA. Enfin, elle provoque la chute du second gouvernement Leterme (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH), en 2010, et permet à la N-VA de devenir le premier parti flamand – et du pays – lors des élections anticipées qui s’ensuivent. Il faudra plus d’un an pour surmonter la crise politique et négocier une sixième réforme de l’État approuvée par huit partis (socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes) mais pas par la N-VA, malgré les revendications de celle-ci que cet accord réalise. L’accord finalement obtenu est beaucoup plus large que la question de la scission de BHV. De nouvelles compétences, dont les plus importantes sont les allocations familiales, sont transférées aux Communautés et à la Cocom. Les Régions héritent de compétences supplémentaires concernant principalement le marché du travail, la sécurité routière, les loyers, la politique des grandes villes et certaines matières fiscales : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Elio Di Rupo (PS), négociateur de cette réforme et bientôt Premier ministre, soutiendra qu’avec l’accord du 11 octobre 2011, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.
Néanmoins, même s’il faudra du temps aux entités fédérées, Flandre comprise, pour « digérer » cette importante réforme, la scission de BHV tant réclamée passe presque inaperçue en Flandre lorsqu’elle est votée et on devine bien, du côté francophone, que la sixième réforme ne sera pas la dernière. D’autant qu’elle laisse, comme les précédentes, des incohérences et des sources de tension et de blocage dans la répartition des compétences entre les entités.
Cette réforme est complétée par l’accord de la Ste-Émilie, conclu entre partis francophones le 19 septembre 2013 afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. C’est ainsi que les allocations familiales sont transférées à la Région wallonne pour les habitants de la région de langue française.
2020, le blocage (bis)
Quoique initialement qualifiée de kamikaze, la coalition gouvernementale (N-VA/MR/CD&V/Open VLD) mise en place par Charles Michel (MR) après les élections de 2014, très déséquilibrée linguistiquement et nettement marquée à droite, surmonte tensions internes et contestation (syndicale, en particulier) jusqu’aux élections communales et provinciales d’octobre 2018. L’absence de volet institutionnel au programme du gouvernement ainsi que son très mauvais résultat à ce scrutin convainquent la N-VA de l’intérêt de se reprofiler durement sur la question de l’immigration. Elle finit par quitter le gouvernement Michel I le 9 décembre 2018 après un bras-de-fer sur le pacte onusien dit de Marrakech. Incapable de dégager une majorité politique de rechange, C. Michel présente la démission de son gouvernement au roi, qui l’accepte le 21 décembre. Il est toutefois décidé, sans que l’opposition crie au scandale, de ne pas convoquer immédiatement l’électeur et d’attendre la date prévue pour les élections multiples, le 26 mai 2019, pour renouveler la Chambre.
Ce scrutin sanctionne durement la coalition sortante et, plus largement, tous les partis traditionnels, et complique fortement la mise en place d’une nouvelle coalition, notamment en raison du progrès du VB et du PTB. Une coalition majoritaire devrait nécessairement associer le PS et la N-VA ou accepter d’être minoritaire dans l’un des groupes linguistiques. On a passé neuf mois à tenter tantôt la première option (la Bourguignonne), tantôt la seconde (la Vivaldi), sans succès. La crise du Covid-19 est venue temporairement arrêter ces efforts et susciter une fragile union sacrée autour du second gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès (MR). Las, à l’été venu, aucune solution durable ne se dessine pour un gouvernement de plein exercice et majoritaire capable de conduire la relance du pays après la crise économique et sociale du coronavirus. La Belgique traverse la plus longue crise politique de son histoire. Deux clivages principaux sont à l’œuvre, socio-économique et institutionnel. Et même le troisième, philosophique, refait parfois surface avec le retour du débat sur l’avortement.
Et demain ?
« La perte de souveraineté qu’a connue ce pays n’est pas uniquement due aux structures transnationales qui ont été créées au-dessus de la Belgique, mais également à l’institutionnalisation politique des sous-nations qui se sont développées en son sein. » La Belgique de 2020 est un État qui a vu ses compétences s’évaporer tant vers le haut (Union européenne) que vers le bas. Quelle plus-value reste-t‑il à l’Autorité fédérale ? Il n’existe aujourd’hui aucun consensus quant à l’avenir de la Belgique. Et même la gestion de la crise du coronavirus ne semble pas avoir réussi à démontrer l’intérêt du niveau national.
Depuis 50 ans, la mise en place de nouvelles institutions a mobilisé une grande partie de l’énergie politique et des ressources collectives. Le bilan des « dommages collatéraux » de cette très longue réforme de l’État devra un jour être tiré. Ce que fait craindre la persistance du conflit communautaire, ce n’est peut-être pas tant la régionalisation de nouvelles compétences ou le passage à une forme de confédéralisme que l’instabilité permanente qui, d’une part, donne lieu à des crises politiques de plus en plus longues et, d’autre part, mobilise des énergies qui pourraient être mieux utilisées ailleurs.
Mouvement wallon et renardisme
Permanent syndical socialiste actif dans la métallurgie liégeoise, André Renard joue un rôle important dans la Résistance et crée une organisation anarcho-syndicaliste qui participe à la création de la FGTB en 1945. Au sein de celle-ci, il fait adopter en 1954 et 1956 des résolutions réclamant des réformes de structure à caractère anticapitaliste. Il milite également pour l’autonomie wallonne. Leader de la grève de 1960-61 contrarié par l’attitude de ses camarades du Nord et de la CSC dominée par ses dirigeants flamands, il en ressort encore plus déterminé à faire avancer le fédéralisme et, en mars 1961, quitte ses fonctions de numéro deux de la FGTB puis crée le Mouvement populaire wallon (MPW). Celui-ci, qui n’est ni un parti ni un syndicat, a vocation à apporter un soutien populaire à la cause wallonne que le mouvement wallon historique n’avait guère. A. Renard meurt inopinément en juillet 1962, à 51 ans.
Des partis communautarisés
Bien avant que la Belgique perde son caractère unitaire sont apparus des partis politiques communautaires. Après le Frontpartij puis le VNV (d’extrême droite) dans l’entre-deux-guerres, un représentant de la Christelijke Volksunie entre au Parlement en 1954. Devenu VU, ce parti passe de 5 députés en 1961 à 21 en 1971. Du côté francophone, cette période est marquée par la création du Front démocratique des francophones (FDF, initialement Front démocratique des Bruxellois de langue française), qui naît dans un contexte de résistance aux lois linguistiques de 1962-63 et incarnera la résistance de Bruxelles et de sa périphérie contre la logique territoriale flamande, puis du RW. Plus récemment, flamingant et d’extrême droite, le Vlaams Belang (VB) apparaît en 1978 sous le nom de Vlaams Blok. Tandis que l’implosion de la VU en 2001 donne naissance à la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), qui est le premier parti flamand depuis 2010.
À côté de l’existence de partis dont la dimension régionaliste ou communautaire constitue le cœur du programme, et qui ont d’emblée pour vocation naturelle de ne se présenter aux suffrages que d’une partie de l’électorat, les partis politiques traditionnels – social-chrétien, libéral puis enfin socialiste – vont se scinder sur une base linguistique. Si, durant les années 1970 et 1980, le PSC et le CVP, le PRL et le PVV, le PS et le SP demeurent relativement proches, et n’envisagent pas de participation gouvernementale nationale en l’absence du parti frère, graduellement, les liens se distendent et les programmes, les stratégies et les appellations évoluent de façon divergente. En 2008, le gouvernement fédéral Leterme I embarque le PS mais pas le SP.A, qui préfère l’opposition. En 2014, Charles Michel ne parvient pas à convaincre le CDH de participer à la « Suédoise » alors que le CD&V la rejoint. En Région bruxelloise, le MR a basculé dans l’opposition dès 2004, tandis que l’Open VLD est toujours au pouvoir.
Les liens plus serrés entretenus par Ecolo et Agalev (qui sont nés séparés et ne résultent pas d’une scission), puis Groen, et l’existence de partis de gauche radicale unitaires, en particulier le PTB, constituent des exceptions sans grande conséquence dans le paysage politique belge d’aujourd’hui. La quasi-absence de partis nationaux susceptibles de réaliser une synthèse des aspirations des différentes régions et communautés du pays en leur sein, une caractéristique que l’on ne retrouve pas dans les autres États fédéraux, est peut-être la plus grande source de fragilité du système belge.
Voir aussi S. Govaert, « Les partis sont-ils solubles dans l’État fédéral ? » dans ce dossier.
Le sort de la minorité germanophone
Territoires octroyés à la Belgique après la Première Guerre mondiale, en guise de dédommagement pour les destructions infligées par l’armée allemande, ces quelques 850 km² constituent depuis 1963 une région linguistique où l’allemand est la langue officielle. Ses habitants n’ont toutefois guère revendiqué d’autonomie institutionnelle lors des premières phases de la réforme de l’État et ont parfois été marginalisés lors des réformes institutionnelles. C’est ainsi que les mécanismes organisant l’équilibre linguistique entre francophones et néerlandophones ignorent l’existence des germanophones (il en est ainsi de la parité obligatoire au sein du gouvernement fédéral : cette disposition interdirait-elle à un germanophone de devenir ministre fédéral, Premier ministre excepté ?).
Les institutions de la Communauté germanophone sont issues d’un processus de réforme de l’État né d’un conflit linguistique auquel elle n’était pas partie prenante. Cependant, les germanophones de Belgique ont été les premiers, dès 1974, à élire leur assemblée, et ils sont devenus politiquement la minorité la mieux protégée au monde. Songeons qu’ils envoient un député au Parlement européen, élu avec moins de 15 000 voix, alors qu’il en faut plus de 200 000 pour décrocher un siège quand on se présente dans le collège électoral français, ou a fortiori néerlandais. L’approfondissement de la réforme de l’État a fait de la Région wallonne, et non plus de l’Autorité fédérale, l’interlocuteur de premier rang des germanophones. Cette évolution a contribué à développer le sentiment autonomiste dans la Communauté, qui est incarné notamment par le succès du parti ProDG, auquel appartient l’actuel ministre-président, Oliver Paasch. Les transferts de compétences depuis la Région wallonne ont aujourd’hui fait de la Communauté germanophone une entité fédérée hybride aux larges compétences.
Les réformes institutionnelles, « c’est des trucs de politiciens ! »
S’il est habituel d’observer que des transformations politiques répondent à des mutations sociétales, il est fréquent d’entendre ou de lire qu’en Belgique, les réformes institutionnelles ont été décidées par les politiques sans consulter les citoyens. C’est évidemment faire bon marché tant des programmes avec lesquels les partis se présentent devant l’électeur que de l’existence de multiples groupes de pression, jouissant d’un véritable soutien populaire, et en particulier de ceux qui ont incarné les revendications du mouvement flamand et, dans une moindre mesure, du mouvement wallon – à cet égard, l’absence d’un mouvement bruxellois à caractère régionaliste jusqu’aux années 2010 a peut-être pesé dans la prise en compte tardive de l’identité régionale spécifique.
Toutefois, structures institutionnelles et opinion publique sont dans un dialogue. Progressivement, les institutions régionales sont devenues l’interlocuteur politique (et administratif) principal du citoyen, après la commune. Les médias ont resserré leur focale sur la dimension communautaire, évoquant par exemple l’enseignement et la culture dans un horizon strictement monocommunautaire. Il ne fait pas de doute que, globalement, les réformes de l’État successives ont écarté plutôt que rapproché l’une de l’autre les deux grandes communautés belges, dans un mouvement souvent qualifié de centrifuge.
(Image de la vignette et dans l’article sous CC-BY-SA 3.0 ; sceau de l’État belge réalisé en 2013 par Sodacan et Katepanomegas.)
