Stratégie • Idées
Hégémonie et stratégie anticapitaliste
24.08.2021

À propos de Erik Olin Wright, Stratégies anticapitalistes pour le XXIe siècle, paru en français en octobre 2020.
Repenser la stratégie socialiste par la combinaison de plusieurs voies d’action, tel fut l’objectif du dernier ouvrage de Erik Olin Wright, entre utopies et optimisme. Une lecture critique de ces propositions pointe la crise pourtant systémique du capitalisme et interroge par ce biais les rôles de l’État, jusqu’à lui permettre de s’affirmer comme un agent de l’écosocialisme.
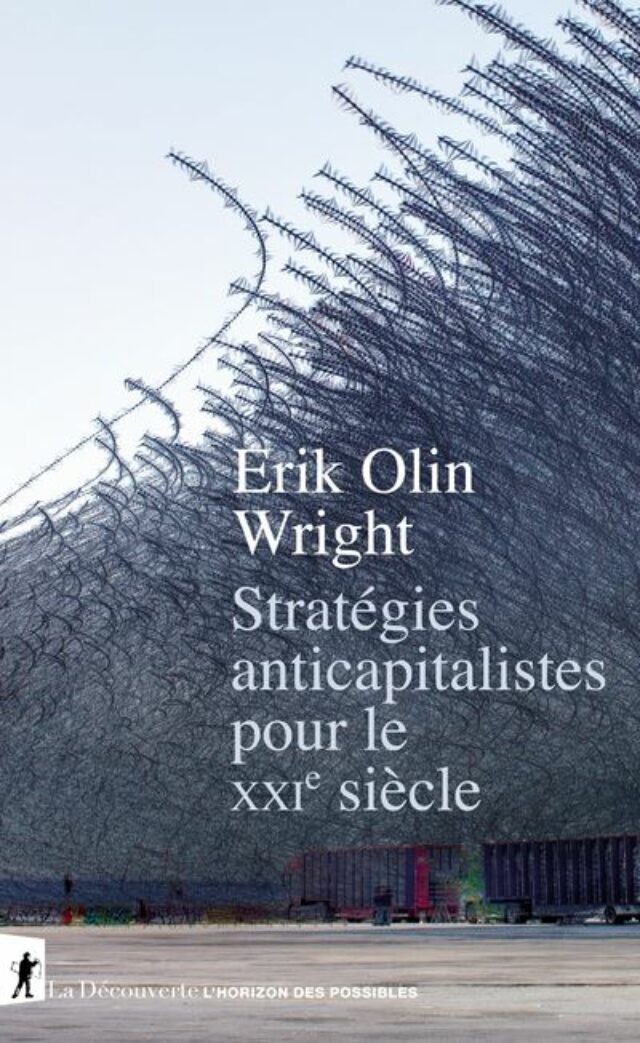
There is an alternative : tel est le mot d’ordre, à rebours du célèbre Tina thatchérien, qui commande l’ultime ouvrage d’Erik Olin Wright, rédigé peu avant qu’il ne soit emporté par une leucémie1. Élaborer une alternative anticapitaliste suppose deux choses. Il faut d’abord imaginer, concevoir une telle alternative sous la forme de projets vivants de transformation sociale, déjà observables dans le monde existant, ce qu’il appelle des « utopies réelles » (objet de son livre précédent, best-seller au titre éponyme2. Mais il faut aussi une stratégie pour faire triompher une telle alternative sur le plan politique – stratégie anticapitaliste que Wright ne renonce pas à placer sous l’égide du socialisme3.
Bonne nouvelle : les intellectuels progressistes réinvestissent enfin la question de la stratégie politique, qu’ils avaient désertée pendant des décennies4. Sous cet aspect, nous ne sommes plus foucaldiens, et c’est heureux5. Mais si Wright, sur le théâtre des opérations, est un éclaireur d’exception dont les vues sont toujours pertinentes, il pêche par là où nombre de stratèges ont subi de cuisantes défaites : l’optimisme. Optimisme revendiqué, du reste : à la formule fameuse de Gramsci – « allier le pessimisme de l’intelligence et l’optimisme de la volonté » – il objecte que « nous avons besoin au moins d’un peu d’optimisme de l’intelligence6. Le problème, c’est que pour adhérer à la stratégie wrightienne, il faut beaucoup d’optimisme. À mon sens, trop. Examinons cela.
Un pluralisme stratégique
Wright distingue cinq stratégies anticapitalistes possibles : (1) écraser le capitalisme en profitant de ses crises systémiques (c’est la voie révolutionnaire prônée par Marx, Lénine et Cie) ; (2) le démanteler par des réformes progressives, en utilisant le pouvoir d’État (le programme standard de la social-démocratie) ; (3) le domestiquer en neutralisant ses méfaits par la régulation et la redistribution (l’État social et son triptyque « sécurité sociale + services publics + droit du travail ») ; (4) lui résister par des luttes syndicales et des mouvements sociaux (via la grève, la manifestation, etc.) ; enfin (5) le fuir en expérimentant, dans ses failles, des modes de production ou de vie non capitalistes (coopératives, « zones à défendre », etc.).
Toutes ces stratégies ont été expérimentées au XXe siècle, et toutes ont échoué. Mais pour le XXIe siècle ? Wright exclut la première, la voie révolutionnaire de type léniniste, qui ne lui semble ni praticable ni souhaitable. Restent les quatre autres. L’originalité de Wright est de ne pas privilégier une voie unique, mais de les combiner toutes les quatre en vue « d’éroder » le capitalisme tant par le « bas » que par le « haut » : par le « bas », à travers les mobilisations et les initiatives horizontales de la société civile (résister et fuir) et par « en haut », grâce à l’action verticale de l’État (démanteler et domestiquer). Je ne peux que marquer mon accord avec ce pluralisme stratégique, qui rejoint ce que j’appelle pour mon compte le « théorème de Machiavel » et qui énonce en substance que nous avons besoin à la fois d’interventions étatiques, pour contrer la toute-puissance des marchés, et de mouvements sociaux, pour bousculer l’appareil d’État7. La stratégie de l’érosion répond à cette double logique : maîtriser les marchés par l’État et maîtriser l’État par la lutte démocratique. Je partage également l’appel de Wright, déjà relayé, à faire preuve « d’un peu d’optimisme de l’intelligence ». Deux observations justifient, selon lui, cet optimisme.
D’une part, la société n’est pas – et ne sera jamais – purement capitaliste, car bien d’autres façons d’organiser l’économie se combinent toujours, dans des proportions variables, avec la logique du profit et de l’accumulation : services publics, régulations étatiques, production domestique, économie sociale et solidaire, économie collaborative, etc. Un ensemble socio-économique n’est pas un organisme unique, mais ressemble plutôt à un écosystème naturel (Wright choisit l’exemple du lac) composé de parties qui interagissent mais sont librement connectées. La stratégie de l’érosion consiste donc, expose-t-il, à « introduire les variétés les plus vigoureuses et émancipatrices de l’activité économique non capitaliste dans l’écosystème du capitalisme », en vue de le transformer en un écosystème de type socialiste8.
D’autre part, Wright se départit de la vision anarcho-marxiste qui ne voit dans l’État qu’un pur instrument de reproduction du capitalisme. Même s’il est incontestable que les institutions étatiques sont contrôlées par des élites liées à la classe capitaliste, et que leur pente naturelle est de mettre en œuvre des politiques pro-capitalistes, l’État est, lui aussi, un système d’appareils hétérogènes et souvent contradictoires, qui doit répondre à des demandes sociales elles-mêmes contradictoires9. S’il y est poussé par des mouvements démocratiques puissants et imaginatifs, l’État peut domestiquer le capitalisme, par la régulation et la redistribution, voire le démanteler, par l’introduction de règles favorisant le « pouvoir social », c’est-à-dire l’auto-organisation économique de type coopératif, mutuelliste, associatif, etc.
Je m’accorde à nouveau volontiers avec lui sur ces deux points cruciaux : (1) toute économie est mixte, toute société est hybride, composée d’éléments capitalistes mais aussi non capitalistes ; (2) si l’État n’est certes pas neutre dans le conflit entre pouvoir capitaliste et pouvoir social, du moins est-il en position de tiers, doté d’une capacité d’intervention que la mondialisation capitaliste, contrairement à ce que l’on dit, n’a pas annihilée. Il existe donc bien, au niveau économique comme au niveau politique, des opportunités de résistance et d’alternative au capitalisme.
Le capitalisme en crise
Mais là où l’optimisme du sociologue américain n’est plus tenable – et l’amène à prôner des politiques qui ne peuvent, finalement, que faire le jeu du capitalisme lui-même –, c’est dans la façon dont il sous-estime la gravité et la nature même de la crise dans laquelle se trouve désormais plongé le capitalisme. Le présupposé des thèses de Wright, c’est que le capitalisme est certes un ordre profondément injuste (eu égard aux valeurs d’égalité, de liberté, de démocratie et de solidarité10 et manifestement traversé par des contradictions majeures, mais qu’il reste malgré tout fondamentalement stable et cohérent. Les métaphores dont il fait usage pour décrire le capitalisme en témoignent : qu’il s’agisse de l’écosystème aquatique (dans lequel il faudrait introduire des « variétés non capitalistes »), de l’édifice (qu’on voudrait « éroder ») ou encore du jeu (où « jouer des coups » correspond aux stratégies « d’en bas », et « changer les règles », aux stratégies « d’en haut »11. Toutes ces métaphores renvoient l’image d’un capitalisme somme toute fonctionnel, dont la dynamique historique est vouée soit à se reproduire indéfiniment, soit à se métaboliser en une société (plus ou moins) socialiste.
Cependant, ce que nous vivons actuellement, c’est une crise systémique du capitalisme. Une crise qu’il est impossible, selon moi, de lire dans les termes d’une alternative morale entre deux écosystèmes, deux édifices socio-économiques, mais qu’il faut appréhender comme une bifurcation historique entre, d’un côté, une fuite en avant mortifère dans le chaos néolibéral et, d’un autre côté, la restauration des conditions élémentaires d’un monde commun viable. L’enjeu, autrement dit, n’est pas d’éroder le capitalisme, mais de sortir d’un dérèglement civilisationnel qui menace aujourd’hui tout édifice, tout écosystème. Plongé dans ses utopies, Wright passe, selon moi, à côté des deux contradictions systémiques où se trouve le capitalisme en ce début de XXIe siècle. La première contradiction découle du mode d’exploitation qu’il a mis en place, et le pousse à exercer une pression à la baisse sur les salaires et à accélérer la numérisation et l’automation de la production, alors même qu’il a besoin d’une demande solvable pour vendre ses marchandises. La « solution » à cette contradiction, on le sait, c’est l’endettement généralisé des ménages et des États, qui entraîne lui-même, non seulement des crises financières chroniques, mais aussi la déconstruction accélérée des institutions de la société salariale et de la citoyenneté sociale.
La seconde contradiction découle de ce que le capitalisme est aussi un mode de destruction, du fait qu’il ne peut poursuivre sa logique d’accumulation, comme le dit Marx, « qu’en ruinant en même temps les sources vives de toute richesse : la terre et le travailleur12. Avec les effets massifs du réchauffement climatique, de la pollution de l’air et de l’épuisement des ressources naturelles, l’anthropocène13 n’est désormais plus un risque à prévenir mais une catastrophe qui a déjà eu lieu, et dont il s’agit dorénavant de traiter les conséquences gigantesques en termes d’accès aux biens essentiels et à la santé. Intégrer la soutenabilité dans nos stratégies politiques est une nécessité et une urgence – or, significativement, cette valeur n’est presque pas évoquée par Wright dans le chapitre 2, consacré aux fondations morales du socialisme.
Wright ne semble pas voir dans ces deux énormes défis des menaces sur la civilisation elle-même, mais plutôt de belles opportunités historiques. Le réchauffement climatique, explique-t-il, « réclamera une expansion massive des biens publics fournis par l’État14 » : grands travaux publics, planification, hausse d’impôts, etc. À le lire, la tendance est inexorable, qui verra l’État stratège se substituer au marché en matière environnementale.
Les effets de la numération et de l’automation sur l’emploi, et la précarisation et la marginalisation croissantes d’une part de la population, pousseront ensuite, selon lui, les États à « prendre au sérieux la possibilité de changer plus fondamentalement le lien entre l’emploi et les moyens d’existence, en créant un revenu de base inconditionnel (RIB)15 ». Ce RIB est sans conteste la mesure-phare de son ouvrage. Il en attend trois effets majeurs : (1) l’atténuation de la pauvreté, (2) l’autocréation d’emploi (jardiniers, petits agriculteurs, artistes) et (3) la stabilisation de la consommation – ce qui explique, de son propre aveu, que le RIB soit « une option politique attractive pour les élites capitalistes » elles-mêmes16.
Ici se révèlent toute la candeur et toute la fragilité de la stratégie anticapitaliste de Wright : il attend « l’érosion » du capitalisme de mesures politiques de nature à le renforcer et à le stabiliser ! Ainsi le RIB, nous dit-il, « permettra aux travailleurs de refuser l’emploi capitaliste » au profit d’activités plus épanouissantes17, mais il « subventionnera aussi, en un sens, le travail précaire des entreprises capitalistes, en particulier dans l’économie des petits boulots18 ». Contradiction ? Non, simplement la conséquence de la logique « symbiotique » propre à Wright, et qui repose sur la conviction excessivement optimiste que si vous plongez des « variétés non capitalistes » dans l’écosystème capitaliste, celui-ci va spontanément évoluer dans le bon sens, celui du socialisme. C’est aussi, du reste, ce qui ressort des autres grandes « utopies réelles » proposées dans l’ouvrage : l’extension du pouvoir des salariés dans l’entreprise capitaliste ; la promotion de l’économie sociale et de l’économie coopérative de marché ; la transformation du secteur bancaire en service public – tous projets qui montreraient, selon Wright, que « le contraste entre capitalisme et socialisme n’est pas purement dichotomique19 »…
Impossible ici, pour moi, de suivre le professeur américain. Impossible de le suivre sur le RIB – erreur stratégique majeure d’une certaine gauche, inconsciente du fait que la mise en place d’un tel dispositif se fera forcément au détriment des institutions de l’État social (sécurité sociale, droit du travail, salaires, services publics). Impossible aussi, plus globalement, de partager la croyance de Wright selon laquelle le capitalisme est un écosystème qui crée (ou laisse le « pouvoir social » créer) en son sein même les conditions de son propre dépassement. Une croyance, somme toute, fidèle au marxisme originel…
Les leçons du XXe siècle
Ce qu’il y a de plus pertinent chez Wright, répétons-le, c’est l’idée que toute stratégie anticapitaliste conséquente doit associer « les stratégies par le bas, issues de la société civile, de résistance et de fuite, à des stratégies par le haut, mises en œuvre par l’État, de domestication et de démantèlement20 ». Mais à « l’optimisme de l’intelligence » qui sous-tend sa vision du XXIe siècle, on préférera les rudes leçons, trempées dans le tragique XXe siècle, de Karl Polanyi et d’Antonio Gramsci.
De Polanyi, on doit retenir que le capitalisme n’est pas un écosystème, mais un désencastrement de l’économie qui aboutit à la destruction du Travail, de la Terre et de la Monnaie, autrement dit à la destruction de tout écosystème, de tout édifice civilisationnel, et que le « contre-mouvement » de la société pour résister à ce désencastrement ne fait souvent qu’empirer les choses, comme ce fut le cas avec le fascisme21. On peut se demander si un scénario analogue ne se rejoue pas aujourd’hui, avec la mutation accélérée du néolibéralisme en un populisme que je qualifie de néo-fordiste et de post-démocratique. Il est néo-fordiste car il promet à la classe moyenne consumériste, en échange de l’abandon des protections de l’État social, des « transferts cash » sous forme d’emplois à bas salaire, d’allocations familiales ou de revenus minimums (d’où le succès du RIB à droite). Il est post-démocratique car il propose aussi à la classe moyenne – du moins à sa frange sexiste et xénophobe – de faire barrage aux revendications d’égalité provenant des mouvements féministes ou décoloniaux et de se débarrasser de l’État de droit au profit d’une gouvernementalité de plus en plus ouvertement autoritaire22.
La priorité stratégique aujourd’hui est de faire barrage à ce populisme porteur de barbarie, en lui opposant une alternative socialiste – ou plutôt écosocialiste – crédible et désirable23.
De Gramsci24 on retiendra que l’enjeu de toute stratégie politique reste la lutte pour l’hégémonie – soit la capacité politique d’un groupe social d’imposer ses intérêts et ses valeurs comme référence commune à l’ensemble des protagonistes25. Si une contre-hégémonie socialiste requiert de maîtriser les marchés par l’État (stratégie de domestication et de démantèlement) et de maîtriser l’État par la lutte démocratique (stratégie de résistance et de fuite), la question centrale est de savoir quels acteurs collectifs sont susceptibles de constituer un tel « bloc historique ». Le chapitre le plus décevant du livre de Wright est le dernier, précisément consacré aux « agents de la transformation ». Ce chapitre élude complètement la question de l’hégémonie. Mais sans doute est-ce là l’aboutissement logique de tout le parcours intellectuel d’Erik Olin Wright, qui l’a vu évoluer, selon son ami Michael Burowoy, « d’une analyse de classes sans utopie à une utopie sans analyse de classes26. »
À nous, dès lors, de trouver la juste dose « d’optimisme de l’intelligence » à insuffler dans nos stratégies politiques, si nous ne voulons ni désespérer de l’avenir ni nous bercer d’illusions…

